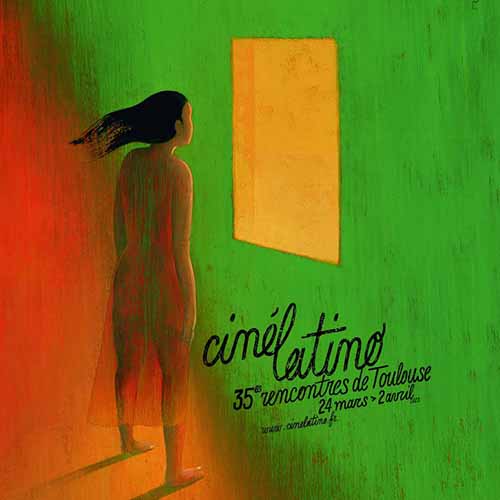Étiquette : études sur le genre
-
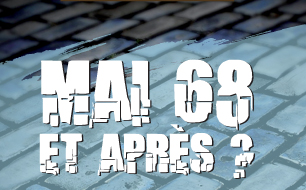
L’année 68 des femmes : 1968, de grands soirs en petits matins. Nouvelles explorations de l’événement / LUDIVINE BANTIGNY
1968 était la première année du monde
-

Épistémologie féministe : le mirage de la connaissance objective / María Luisa Femenías
Conférence organisée par le Réseau Arpège sous la responsabilité scientifique de Michèle Soriano (Centre d’Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines (CEIIBA), Université Toulouse Jean Jaurès, 10 février 2017.
-

Les excès du genre : concept, image, nudité / Geneviève Fraisse
Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, a publié de nombreux ouvrages relatifs à la généalogie de la pensée féministe ainsi qu’à la controverse sexe/genre d’un point de vue épistémologique et politique.