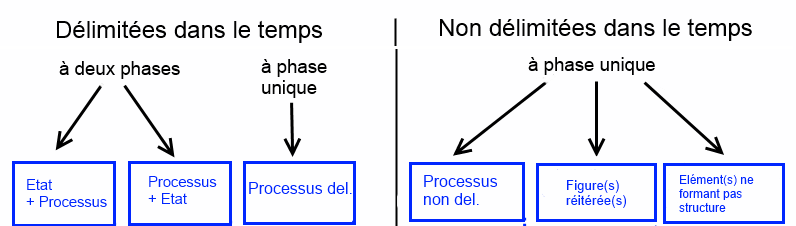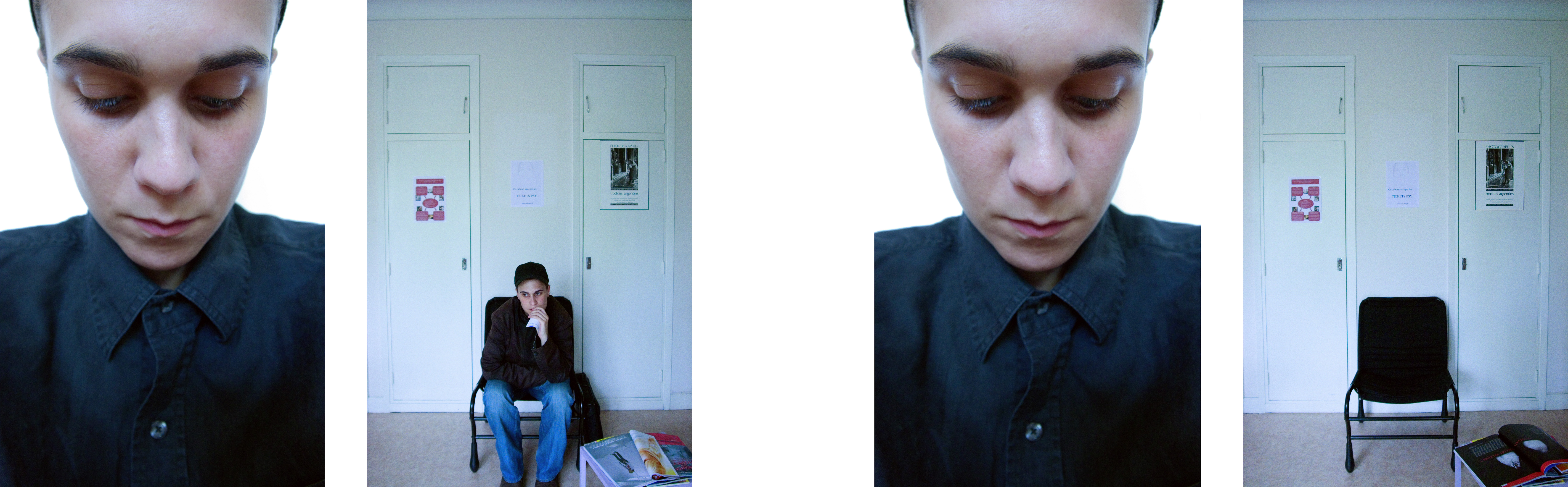Franck David
PRAG, Université Bretagne Sud de Lorient
franck.david@univ-ubs.fr
Pour citer cet article : David, Franck, « Territoires urbains dans la chanson. », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°7 « Territoire et intermédialité », automne 2016, mis en ligne en 2016, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2018/01/09/la-ville-contemp…ite-au-generique/>.
Télécharger l’article au format PDF
Résumé
Aborder la chanson avec les outils de la géographie socio-culturelle permet d’y chercher les représentations et les pratiques socio-spatiales qui s’y déploient. Intermédiale, la chanson enregistrée est diffusée à large échelle et de plus en plus accompagnée d’images qui conditionnent sa réception par le public. À la fois mode d’expression et vecteur de la culture populaire, elle se prête tout à fait à l’étude des rapports entre les habitants et leurs territoires. Dans un monde devenu majoritairement urbain dans la manière d’habiter (se loger, travailler, se distraire, se déplacer) les territoires de la ville ne sauraient échapper à la chanson française contemporaine. Référents identitaires, ils représentent un enjeu en terme de légitimité et de notoriété pour les artistes. Territoires du quotidien, ils apparaissent aussi comme éléments de reconnaissance d’un public en quête de références et de modes. À travers quelques morceaux choisis, les territoires urbains de la chanson révèlent à la fois des lieux et les ressorts d’une identité à plusieurs échelle, qui sait s’accommoder de la diversité.
Mots-clefs: chanson – territoire – ville – géographie
Abstract
If you approach singing with the tools of sociological and cultural research, you can look for the social and spatial representations and practices it displays. Being intermedial, recorded songs are broadcasted on a large scale, increasingly mixed with images that determine the way the audience receive it.
In the same time a medium of expression and a vector of the popular culture, the recorded song is completely appropriate for relationships studies between inhabitants and their territories. In a world which became mainly urban, the territory of the city won’t escape to the contemporary French song. Through some picked songs, we’ll see how urban territories of songs can reveal places and resorts of a plural identity, which manages with diversity.
Sommaire
1. Chanteurs des territoires urbains : la ville comme territoire d’identification
2. Chanter les territoires urbains : la ville entre réalités géographiques et représentations
Conclusion
Bibliographie
« Territoire et intermédialité », l’un des deux termes au moins est un appel à la géographie ; le second, une invitation à la rencontre et au dialogue des disciplines. En 2013 a ouvert au cœur de Tokyo un nouvel espace muséographique, l’Intermédiathèque, (qui publie la revue Intermedia, en collaboration avec le Musée des Confluences à Lyon). Résolument novateur, il offre un regard neuf sur des objets jusque-là limités à un seul registre (ethnographique) en leur appliquant un changement de perspective, où la valeur d’usage est mise en concurrence avec l’esthétique. Appliquée au territoire, concept polysémique cher aux géographes1, l’intermédialité permet de s’inscrire dans le tournant culturel opéré depuis les années 1980-1990 au cours desquelles la géographie s’est emparée de la culture à la fois comme champ de recherche et comme démarche (Claval, Staszak, 2008). Empruntant de nouveaux chemins pour appréhender l’espace des sociétés « le géographe peut envisager la musique et les pratiques musicales comme des géo-indicateurs de l’organisation des lieux » (Raibaud, 2009). Edgar Morin avait souligné déjà le caractère multidimensionnel de la chanson, produit de la culture de masse, et relevé son intérêt pour les sociologues (Morin, 1965) ; à sa « double substance : musicale et verbale », il ajoutait « l’arrangement et le rythme [qui] s’insèrent dans des genres, des styles et des modes ». La « cantologie » ayant trouvé sa place à l’université de Valencienne (Hirschi, 2008), il semble opportun de l’exposer au regard et à l’ouïe du géographe. Du fait de son infinie variété, de sa diffusion par les médias en association étroite avec la figure de l’interprète de plus en plus médiatique, la chanson s’inscrit dans un processus de déterritorialisation. Produit culturel de masse, elle multiplie les acteurs et les lieux entre la composition, l’enregistrement, l’édition puis la diffusion en spectacle vivant ou dans les médias. Les échelles s’emboîtent, qui construisent l’aire de la notoriété. Les enjeux sont économiques mais aussi culturels et identitaires. La chanson se prête particulièrement à une approche intermédiale du territoire des géographes, en particulier défini comme « auto-référence » à travers sa charge symbolique et sa valeur emblématique : « le groupe s’affiche par le territoire qu’il revendique, par les représentations qu’il en construit et communique » (Debarbieux, 2003, p. 912). Dans un monde sous influence urbaine (96 % de la population française selon M. Lussault), il est naturel de chercher à comprendre comment l’urbanité des territoires transparaît dans la chanson.
Pour circonvenir le sujet, une sélection partielle et forcément hasardeuse de morceaux s’impose, avec la volonté de rester dans le domaine de la chanson française contemporaine (July, 2012) telle qu’elle émerge avec l’essor des médias de masse depuis les années 1960. Les artistes ou les titres cultivant une certaine urbanité, entendue comme rapport intime à la ville, ont constitué le corpus de cette étude, avec la présence de deux figures tutélaires, d’une part Renaud (Séchan), de l’autre Fabien Marsaud alias Grand Corps malade (GCM). D’autres grands noms les rejoignent, soit du fait de la notoriété de certains titres (Gainsbourg « New York USA », Dutronc « Il est cinq heures Paris s’éveille »), soit en raison de l’attachement géographique à une ville (Toulouse et Marseille plus particulièrement). L’hypothèse postule que certains artistes cultivent une forme d’urbanité, et s’efforcent en termes de légitimation d’apparaître en phase avec une perception de la ville censée incarner la modernité et, plus simplement, la mode.
L’approche d’un sujet aussi vaste est ainsi pensée dans une double perspective : d’une part les territoires urbains comme terrain d’identification pour les interprètes qui mettent en scène leur propre « urbanité » ; d’autre part les territoires urbains révélés par les compositions à travers les images et le vocabulaire employés.
1. Chanteurs des territoires urbains : la ville comme territoire d’identification
Les questions de l’identification des populations à un territoire – à plusieurs échelles – et conséquemment de l’identité des territoires ont animé les débats géographiques des années 2002-20062. Dans le cas de la chanson, les interprètes s’efforcent de construire une identification au monde de la ville et à des cultures proprement urbaines, qui constitue un enjeu dans leur quête de notoriété. Cette identité urbaine soigneusement cultivée repose aussi bien sur l’image véhiculée par les médias que sur les sons et les thèmes abordés.
1.1. Qu’est-ce qu’une image « urbaine » ?
Loin des clichés du folklore régional ou des musiques « traditionnelle », associées à tort ou à raison au monde rural, les interprètes de la scène française contemporaine entretiennent une image d’urbain. Toutes les formes de productions visuelles – officielles ou relevant de la sphère prétendument privée – photographies, visuels des pochettes de disque, clips qui accompagnent les titres, mettent en scène les interprètes à travers des codes que l’on peut qualifier d’urbains. Ceux-ci les associent non seulement à la ville, mais à la « grande ville », une métropole régionale, la capitale voire une ville-monde. Dutronc et Gainsbourg cultivent dès leurs débuts l’héritage du Saint-Germain-des-Prés des années cinquante, dans lequel bouillonnait la vie nocturne. La chemise et le costume sont portés avec plus ou moins de négligence mais toujours en référence à des codes vestimentaires identifiés. De la même manière mais dans un autre registre, Renaud en gavroche, pantalon de cuir et veste en jean puis blouson noir sur ses trois premiers albums soigne particulièrement son identification aux quartiers populaires (Copans, 2014). GCM adopte sur ses deux premiers albums un style « urban », conforme aux quartiers dont il se veut porte-parole et au public auquel il s’adresse ; tee-shirt, jean, veste zippée, baskets.
A partir de ces codes visuels, les interprètes s’inscrivent spontanément dans un registre urbain, qui se construit, aussi et surtout, autour d’une identité sonore.
1.2. Un son « urbain »
Du point de vue acoustique, la musique traduit l’appartenance aux territoires urbains à travers trois dimensions : le genre musical, les accents de l’interprétation et la langue utilisée.
Les territoires tels qu’ils apparaissent en filigrane à travers notre sélection traduisent une appartenance assez large aux cultures urbaines, sans qu’on puisse les ranger dans le cadre étroit des « musiques urbaines » (rap, hip hop). Néanmoins, la chanson française contemporaine se décline dans des sous-ensembles incluant le blues ou le jazz pour Nougaro, le pop rock et même le bal musette pour Renaud, le rock festif alternatif pour Mano Negra ou les Ogres de Barback, le reggae ou le ragga pour Zebda et Massilia Sound System, une forme de rap pour les Fabulous Trobadors, le slam pour Grand Corps Malade. Cet éventail de styles, loin d’être exhaustif, s’apparente aux territoires qui sont ceux de la production culturelle, à savoir les territoires urbains. Quelques mesures suffisent pour les assimiler musicalement à des cultures urbaines.
Certains ajoutent un fond sonore directement puisé dans les bruits de la ville, fragments du paysage sonore (Shaffer, 1977), pour inscrire davantage le processus de production dans l’ambiance même de la ville ; Mano Negra pour une atmosphère de bistrot dans « Paris la nuit » (King of Bongo, 1991) ou GCM dans « Saint Denis » (Midi 20, 2006).
La langue et sa musicalité permettent également d’inscrire géographiquement l’interprète dans des territoires. L’identité sonore d’un interprète ou d’un groupe repose non seulement sur son registre musical mais aussi sur des intonations, des formes de prononciation et une manière de chanter la langue. L’accent pose d’emblée la manière d’assumer ou de revendiquer une origine géographique. On retrouve là les efforts de certains pour cultiver leur identification à la capitale. L’opposition entre un « J’aime les filles » légèrement ampoulé de Dutronc et « Camarade bourgeois » aux voyelles posées dans les aigus par Renaud fixe nettement un positionnement social mais aussi un ancrage géographique ; d’un côté les beaux quartiers de la rive gauche, de l’autre les faubourgs populaires parisiens auxquels l’un et l’autre s’identifient et cherchent leur public. Ce qui n’empêche pas Dutronc dans « Cactus » ou « Et moi et moi et moi » de jouer largement sur l’aigu propre à l’accent du titi parisien. Si Claude Nougaro, tôt installé à Paris, n’a pas cultivé son accent toulousain, c’est peut-être dans un souci d’intégration, pour ne pas être catégorisé comme « provincial ». A l’inverse des groupes « régionalistes » comme Zebda, Fabulous Trobadors ou Massilia Sound System revendiquent sans détour leur origine géographique – toulousaine et marseillaise – et des accents intégrant des influences d’Europe du sud et du Maghreb. Toulouse et Marseille font ainsi figures de creuset où le melting pot à la française est mis en avant. Dans le morceau « 3-0 » où les Ogres de Barback invitent huit groupes à chanter un couplet sur leur ville, la dimension phonique des accents joue pleinement le jeu de l’identification. Le cas du slam de GCM est singulier dans le sens où la scansion et la rythmique du phrasé sont primordiales. Comme dans le rap, la diction participe très largement d’une identité sonore s’inscrivant dans les musiques « urbaines ». Fabien Marsaud, qui a popularisé le slam auprès des médias et du grand public, a beaucoup joué de son talent et de sa voix au service d’un propos articulé et intelligible, de surcroît dans une langue « des quartiers » travaillée avec soin.
Car le registre de langue utilisé dans la chanson n’est pas le moindre des facteurs d’identification géographique. Quand l’occitan ou le provençal sont convoqués par les Fabulous Trobadors, Zebda ou Massilia Sound System, les deux capitales régionales de la langue d’oc surgissent spontanément dans l’imaginaire. Ces groupes ont construit leur notoriété d’abord localement avant de trouver un public bien au-delà de leur ville d’origine. Pour ces deux formations, il y a eu dès le départ une volonté d’aller à rebours d’une perception « rurale » des langues régionales, taxées de « provinciales », voire de dialectes ou même de patois. Juliette dans « Chanson, con ! » (Bijoux et babioles, 2008) commence ainsi : « Je suis née à la capitale, c’est pourquoi je parle pointu ». Et elle enchaîne : « Mais quand je vais au Capitole, à Jolimont, aux Trois-Cocus, Toulouse appelle son accent ; même le mien, de fabrication. On finit ses phrases en chantant, et « con » c’est la ponctuation ». Le fait de décliner ces accents dans un registre de musiques urbaines procède d’une revendication identitaire assumée. Le recours à l’argot parisien par Renaud participe du même mouvement. Les accents de la chanson populaire trouvent désormais leur place dans un univers culturel urbain et cosmopolite. S’y ajoutent éventuellement l’usage d’un vocabulaire ciselé fait de langage familier – parfois vulgaire ou grossier – ou des mots empruntés à des dialectes et à des langues étrangères pour marquer, comme avec l’accent, la dimension multiculturelle des grandes villes. GCM clame dans « Je viens de là » (Enfant de la ville, 2008) : « Je viens de là où le langage est en permanente évolution, verlan rebeu argot, gros processus de création ».
L’urbanité des interprètes se construit ainsi en termes d’identité sonore, en complément du soin accordé à l’image. Les thèmes abordés achèvent de les ériger en acteurs des territoires urbains.
1.3. Des thèmes « urbains », la ville comme décor
Le chanteur chante aussi la ville, la sienne mais plus généralement celles qui ont nourri des émotions et une histoire personnelle. Parfois ce sont des évocations génériques d’un monde urbain difficilement localisable. Mais la ville de l’attachement, celle de l’intime et des souvenirs, celle des lieux et des quartiers, fait l’objet de toutes les attentions de ceux qui mettent en avant leur identité urbaine. Les territoires urbains de la chanson relèvent alors aussi bien de l’ambiance que des paysages, des scènes de vie que des lieux. La dimension sociale du propos croise des références géographiques plus ou moins précises.
Quand le jeune Serge Gainsbourg chante en 1958 pour son premier album « Le poinçonneur des Lilas », il se place dans la ville, souterraine et sans horizon, des couloirs du métropolitain. En 1965 il est pourtant « Sorti du trou » et a trouvé son public. Mais lorsqu’il interprète son titre pour une émission télédiffusée, il apparaît sur le plateau devant une photographie servant de toile de fond et représentant une station du métro parisien3. Dans son sixième album Percussions (1965) il peut assumer sa fascination pour les gratte-ciel de Manhattan dans « New York USA ». Alors qu’il n’a jamais mis les pieds outre-Atlantique (Dicale, Tardy, 2012, p.26) il s’inspire des gratte-ciel repérés dans un magazine. Pour la télévision encore une fois, il pose devant une image de building et, souvent filmé de dos, chante seul et en play-back4. Dans le portrait qu’il dresse de lui-même autant que de New York, la modernité et l’audace architecturale l’emportent sur toutes les autres considérations. A travers un inventaire du top ten de l’époque il s’associe subtilement avec New York et sa skyline. Pour Dutronc dans « Il est cinq heures, Paris s’éveille » en mars 1968, à mille lieux de la contestation qui éclatera deux mois plus tard, Paris est abordée à travers un certain nombre de clins d’œil voire de clichés. La chanson prend le parti d’une totale légèreté et participe par son succès à la construction d’un imaginaire parisien auquel l’interprète est définitivement lié.
Nougaro, Zebda ou les Fabulous Trobadors chantant Toulouse s’attardent à la fois sur les clichés – la « ville rose » ne manque à aucune des chansons – et sur les brassages culturels et ethniques comme éléments de diversité. L’âme et l’identité des quartiers (Minimes, Arnaud Bernard) connus le plus souvent des seuls habitants, le disputent aux hauts-lieux (la Garonne, le Capitole) qui en revanche parlent davantage aux visiteurs. Comme Massilia Sound System avec Marseille, ou GCM avec Saint-Denis, les territoires urbains mis à l’honneur dans le répertoire favorisent un ancrage géographique. L’enjeu est la conquête d’un public local, majoritairement urbain, avant une notoriété nationale, voire internationale.
Mais la chanson traduit aussi une perception des territoires urbains à travers les textes eux-mêmes, dont l’étude fournit au géographe une matière précieuse.
2. Chanter les territoires urbains : la ville entre réalités géographiques et représentations
L’approche géographique de la chanson passe naturellement par l’étude des textes, des registres de langue et, pour le géographe, du lexique utilisé pour désigner la manière d’habiter poétiquement le territoire. Les territoires urbains qui s’y révèlent s’élaborent d’abord en contrepoint de la ruralité. Néanmoins, ils forgent une image fidèle de ce que signifie « habiter la ville ».
2.1. Chanter la ville et l’habiter
« Enfant de la ville » de l’album éponyme de GCM, outre son titre, semble un cas pertinent pour dégager les caractéristiques géographiques des territoires urbains dans une démarche inductive. Son texte propose en effet une déclinaison de la notion « habiter » au sens de la phrase de F. Hölderlin que M. Heidegger a rendu fameuse : « L’humain habite en poète ». Les géographes s’en sont emparés pour définir « habiter » comme la spatialité des acteurs caractérisée par une forte interactivité avec l’espace dans lequel ils évoluent. Il s’agit donc de découvrir, dans l’explicite autant que dans l’implicite, comment s’élabore un portrait de ville, un rapport aux territoires urbains pensé en termes de médiance : « […] à savoir que l’existence humaine couple nécessairement deux moitiés : un corps animal et un milieu éco-techno-symbolique, lequel en est le corps médial. » (Berque, 2003, p.599). Une telle démarche s’apparente aussi à la manière dont J.F. Staszak a abordé la peinture de Gauguin pour en faire une étude géographique (Staszak, 2003). Les territoires urbains, qui procèdent à la fois d’expériences et de représentations, autorisent une définition de l’urbain tel qu’il est pensé et mis en mots par l’auteur et tel qu’il sera reçu et imaginé par le public.
Les descriptions adoptent le point de vue de l’habitant dans une perception des paysages au niveau du sol en une perspective horizontale, avec une part importance accordée à la dimension sociale, voire sociétale. Tout juste la verticalité est-elle convoquée en contre-plongée pour accentuer la démesure monumentale. La ville est rarement embrassée d’une hauteur ou même vue à la verticale malgré la familiarité des cartes, des plans de transport en commun ou plus récemment des images satellitales, simple décor d’où l’habitant serait absent. Chanter la ville, c’est aussi une manière de l’habiter.
2.2. L’antithèse d’un monde rural censé incarner la « nature »
La ville, comme territoire d’identification et d’auto-référence, se définit d’abord par ce qu’elle n’est pas : la campagne. Dans les textes étrangement proches des débuts de Renaud « Amoureux de Paname » (1975) et de GCM « Enfant de la ville » (2008), l’évocation du territoire urbain commence par la campagne. Le monde rural, idéalisé, semble accréditer l’urbanité des auteurs qui accumulent les clichés. S’adressant d’emblée aux écologistes (ringards) représentant la jeunesse des années soixante-dix, Renaud lance avec malice : « Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des p’tits moutons, des feuilles de vigne et des p’tites fleurs… » . Trente ans plus tard c’est dans des termes proches que Fabien Marsaud déclame « Si la campagne est côté face, je suis un produit du côté pile ». Mer, plage, horizon, gazon, verdure, forêt, plantent le décor ; respirer un air meilleur, écouter le bruit du vent, marcher pieds nus dans l’herbe haute résume les actions. La campagne se limite à des éléments paysagers présentés de manière avenante. Tout juste conclut-il sur son propos introductif par « Mais la nature nourrit l’homme », fonction primitive sans doute un peu naïve pour le géographe qui cherche en vain les circuits de production et de transformation des matières premières issues de l’agriculture et de l’élevage. Dans les territoires urbains tels que la chanson les dépeint, la campagne mythifiée est végétale (forêt-arbres, herbe-verdure, plus rarement des champs ou des haies), minérale (eau, rivière, sources, montagne ou colline) et accessoirement animale (oiseaux et mammifères sympathiques affublés du qualificatif « petit » comme le mouton ou le lapin). Les usages sont essentiellement récréatifs (promenade, méditation) et rarement économiques (agriculture et élevage, toujours extensifs), les nuisances inexistantes (calme, bon air, sécurité). Nature rêvée, comme celle de Gauguin vis à vis de la Bretagne ou des îles Marquises (Staszak, 2003), l’image de la campagne dans la chanson mériterait à elle seule une étude. Toujours est-il que les territoires de la ville apparaissent en contrepoint, a priori moins agréables et pourtant revendiqués…
2.3. Les formes d’une ville
« Enfant de la ville » scruté avec une grille de lecture géographique dresse un portrait signifiant de ce que sont aujourd’hui les territoires urbains.
 À l’inverse des paysages ruraux, les territoires urbains dans la chanson mettent en scène des milieux fortement artificialisés où le regard butte sur des horizons fermés, par des murs ou par un ciel toujours brumeux. Construits, bâtis, bétonnés et goudronnés, ils figurent une ville très éloignée de l’exigence urbanistique des trames vertes (végétales) et bleues (l’eau) censées entretenir la présence et la circulation des espèces. La ville est ainsi d’abord appréhendée par les matériaux qui servent à la construire. Chez Renaud « le béton, c’est mon paysage » (« Amoureux de Paname »). Gris, il connote négativement les grands ensembles. GCM nuance : « Je dis pas que le béton c’est beau, je dis que le béton c’est brut. Ça sent le vrai, l’authentique […] Quand on le regarde dans les yeux, on voit bien que s’y reflètent nos vies » (« Enfant de la ville »). La brique au contraire introduit la couleur, rouge ou rose, véhiculant une image positive, en particulier pour Toulouse dont elle signe l’identité. L’acier ou le verre, quasi absents, montrent un désintérêt relatif pour la dimension architecturale du bâti. Si Renaud aime la tour Eiffel autant que la tour Montparnasse, il n’en précise pas les matériaux. Les descriptions du sol ne sont pas en reste. Le bitume, l’asphalte ou le macadam rejoignent le béton dans une forme d’opprobre alors que le pavé, à l’instar de la brique, est plus poétique et chargé de l’histoire des révoltes parisiennes. Les territoires urbains dans la chanson dessinent donc des paysages faisant largement appel à des représentations presque aussi stéréotypées que pour la campagne.
À l’inverse des paysages ruraux, les territoires urbains dans la chanson mettent en scène des milieux fortement artificialisés où le regard butte sur des horizons fermés, par des murs ou par un ciel toujours brumeux. Construits, bâtis, bétonnés et goudronnés, ils figurent une ville très éloignée de l’exigence urbanistique des trames vertes (végétales) et bleues (l’eau) censées entretenir la présence et la circulation des espèces. La ville est ainsi d’abord appréhendée par les matériaux qui servent à la construire. Chez Renaud « le béton, c’est mon paysage » (« Amoureux de Paname »). Gris, il connote négativement les grands ensembles. GCM nuance : « Je dis pas que le béton c’est beau, je dis que le béton c’est brut. Ça sent le vrai, l’authentique […] Quand on le regarde dans les yeux, on voit bien que s’y reflètent nos vies » (« Enfant de la ville »). La brique au contraire introduit la couleur, rouge ou rose, véhiculant une image positive, en particulier pour Toulouse dont elle signe l’identité. L’acier ou le verre, quasi absents, montrent un désintérêt relatif pour la dimension architecturale du bâti. Si Renaud aime la tour Eiffel autant que la tour Montparnasse, il n’en précise pas les matériaux. Les descriptions du sol ne sont pas en reste. Le bitume, l’asphalte ou le macadam rejoignent le béton dans une forme d’opprobre alors que le pavé, à l’instar de la brique, est plus poétique et chargé de l’histoire des révoltes parisiennes. Les territoires urbains dans la chanson dessinent donc des paysages faisant largement appel à des représentations presque aussi stéréotypées que pour la campagne.
- Les fortes densités de population
Le territoire de la ville s’assimile aussi à de fortes densités. GCM évoque la foule, les gens en mouvement, le nombre. Rapportés aux constructions, l’entassement et l’exiguïté traduisent la pression foncière et la question du logement, qui arrive bien avant les autres fonctions de la ville (le travail, les loisirs, ou les commerces). Presque toujours les logements collectifs (appart’, HLM, cité…) masquent la réalité des lotissements pavillonnaires et de la maison individuelle, sans doute moins conformes aux représentations que les artistes mobilisent pour accréditer leur urbanité. Les territoires urbains sont aussi ceux de la promiscuité dans ses aspects positifs : le groupe, les sociabilités et leurs lieux, notamment les cafés très présents dans la chanson (Mano Negra « Paris la nuit » – King of Bongo, 1991 – évoque la fin des bistrots parisiens) ; les aspects négatifs ne sont pas éludés à travers l’entassement ou « Les embouteillages » chantés par le parisien Sanseverino dès son premier album Le tango des gens en 2001.
- Les mobilités
La mondialisation des territoires urbains accorde de plus en plus de place à la question des mobilités et des réseaux. GCM évoque les quais, le métro, et donne à entendre le signal sonore du tram circulant dans Saint-Denis (« Saint-Denis », midi 20, 2006). Les peintres impressionnistes avaient été fascinés par le chemin de fer et les gares, tout comme les frères Lumières. La chanson cherche à son tour dans ces lieux de départ les thèmes de l’évasion, de la séparation ou des retrouvailles ; Barbara en 1964 chante « La gare de Lyon » et Zebda dédie un texte à la gare de Toulouse « Matabiau » (Le bruit et l’odeur, 1995). L’aéroport d’Orly, mis à l’honneur dans La Jetée de Chris Marker (film mythique de 1962) a inspiré aussi Gilbert Bécaud et Jacques Brel. Logiquement, les réseaux de transports dédiés aux mobilités internes aux territoires urbains ou externes, tournés vers d’autres villes, trouvent une place à la mesure de leur emprise spatiale et sociale. Les boulevards et le périphérique parisiens sont souvent mis à l’honneur autant pour la circulation que pour leur symbolique, tout comme le métropolitain pour ses lignes ou ses stations devenue des lieux emblématiques de la capitale.
- Cultures et hauts-lieux, la diversité créative et patrimoniale des territoires urbains
Alors que le monde rural est censé incarner la nature, les territoires urbains seraient ceux des cultures. Nombreux sont les exemples qui prolongent les deux axes esquissés par GCM quand il aborde d’une part les cultures propres à la ville, pratiques culturelles innovantes et à la rencontre des influences (slam, hip hop, carrefour culturel), d’autre part la dimension symboliques et identitaires des hauts lieux (Belleville, Broadway…). Les pratiques culturelles propres aux territoires de la ville sont récurrentes dans la chanson, qui en est une composante essentielle. De la nuit parisienne qui s’achève à cinq heures quand Paris s’éveille (Dutronc), à la piste du Louxor de Philippe Katerine en passant par les bistrots de la Mano Negra, les territoires urbains sont ceux de la fête et du spectacle. A ces pratiques festives s’ajoutent les lieux patrimoniaux, convoqués pour inscrire la chanson dans des référents culturels communs. A Paris la tour Eiffel, la tour Montparnasse, le métro parisien le disputent aux quartiers : grands boulevards, Belleville, Saint-Denis, La Villette, Mouffetard, Bastille, les gares, jusqu’aux Champs Elysées de Joe Dassin ; à Toulouse le Capitole, Matabiau, les Minimes ou Arnaud Bernard. La dimension monumentale est évoquée dans une vision sensible des territoires urbains qui sont ceux de l’attachement. Nougaro parle de l’église Saint Sernin qui éclaire; au village l’église est plutôt celle qui sonne les heures et rythme le temps mais, dans la ville rose, elle a revêtu l’habit de lumière et participe de la mise en scène des monuments historiques. Dans « 3-0 » des Ogres de Barback, Paris s’identifie à la France et son arrogance de capitale, Rennes à la douceur de son climat et à ses nuits agitées, Bordeaux à son vin et son histoire troublée, Toulouse à sa brique et son parler occitan, Marseille à son port et son accent provencal, Lyon à sa confluence et sa chimie, Strasbourg à sa gastronomie et son dialecte et enfin Lille à son passé populaire et minier mis en regard avec ses ambitions européennes. Le dernier couplet interprété par la fratrie des Ogres commence « Après cet air géographe… ». Le rapprochement pourrait sembler facile mais en réalité le portrait dressé n’est pas tout à fait dissocié des réalités géographiques d’une France urbaine.
- Déviances et nuisances, la ville canaille
Jamais très éloignés des hauts-lieux, les territoires des cultures populaires, parfois interlopes, ne sont pas en reste. Car la ville est aussi un territoire d’errance. Les artistes, et notamment les chansonniers des cabarets, ont durablement marqué la tradition gouailleuse et irrévérencieuse de la chanson populaire (Le bon roi Dagobert brocardait Louis XVI). Travestis et streaptiseuses de Dutronc, délinquants et loubards de Renaud ou « bons coups » de GCM peuplent sans surprise les territoires urbains de la chanson avec leurs larcins; et qui ne connaît pas Gérard Lambert ? Enfin la ville est nuisances. Le texte de GMC qui nous sert de guide marque de ce point de vue l’inflexion des années 2000 avec l’entrée en scène des préoccupations environnementales. Déjà en 1530 Clément Janequin donnait à « Ouyr les cris de Paris ». La pollution sonore est devenue préoccupation, au côté des autres formes de dégradation de l’environnement. GCM, entre « claque-sonne » et « odeurs d’essence », se fait l’interprète de territoires urbains désormais soumis aux exigences de l’Agenda 21.
Conclusion
Comment la chanson française contemporaine rend-elle compte d’un mode d’habiter devenu majoritairement urbain ? Pour les interprètes, les territoires de la ville constituent à la fois leur terrain, où ils se produisent et cherchent un public, et leur terreau, source d’inspiration et d’identification. Ils usent donc des représentations traditionnelles qui confinent parfois aux stéréotypes pour que le tableau qu’ils dressent garantisse une certaine légitimité auprès des différents acteurs (diffuseurs, promoteurs, public) majoritairement urbains. En fonction du genre musical, l’identification porte tantôt sur les lieux centraux, reconnus par tous, tantôt sur des quartiers plus marginaux connus des seuls habitants. Les formes de la ville chantée correspondent néanmoins à des réalités que la géographie se surprend à mettre en évidence. Avec ce pas de côté, cette approche d’un objet a priori fort peu géographique, la chanson dessine des représentations qui disent aussi comment le public se construit une géographie imaginaire des territoires urbains. Qui s’est perdu au milieu des tours de Manhattan a pu entendre résonner « Oh, c’est haut ! », qui s’est trouvé devant le Capitole a fredonné « Ô Toulouse » avec émoi. La chanson participe aussi de la manière de s’approprier les territoires de la ville, entre mythe et réalité.
Bibliographie
BERQUE Augustin, « Médiance », in Lévy J., Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2003, 1034 p.
BERQUE Augustin (dir.), L’habiter dans sa poétique première. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, Editions Donner Lieu, 2008, 400 p.
BERU Laurent, « Le rap français, un produit musical postcolonial ? », Volume !, 2009, 6, 1-2, 18p.
CLAVAL Paul, STASZAK Jean-François, « Où en est la géographie culturelle ? », Annales de géographie, 2008, nº660-661, 5 p.
COPANS Johana, Le paysage des chansons de Renaud, Paris, L’Harmattan, 2014, 628 p.
DEBARBIEUX Bernard, « Territoire », in Lévy J., Lussault M., Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2003, 1034 p.
DICALE Bertrand, TARDY Hervé, New York en 50 chansons, 2012, Tana Editions, 144 p.
HIRSCHI Stéphane, Chanson : l’art de fixer l’air du temps – de Béranger à Mano Solo, 2008, Paris, Les Belles Lettres – Presses Universitaires de Valencienne, « Cantologie », 298 p.
JULY Joël, « Chanson française contemporaine : état des lieux », Revue critique de fiction contemporaine, 2012, [en ligne], consulté le 31/01/2016.
MEYRAN Régis, « Les musiques urbaines, ou la subversion des codes esthétiques occidentaux », EspacesTemps.net, Travaux.
MORIN Edgar, « On ne connaît pas la chanson », Communications, 1965, 6, 10 p.
RAIBAUD Yves (dir.), Comment la musique vient au territoire ? Paris, L’Harmattan, 2009, 316 p.
SHAFER Raymond Murray, Le paysage sonore, le monde comme musique, 2010 (The Tuning of the World, 1977), Marseille, éditions Wild Project.
STASZAK Jean-François, Géographies de Gauguin, Paris, Bréal, 256 p.