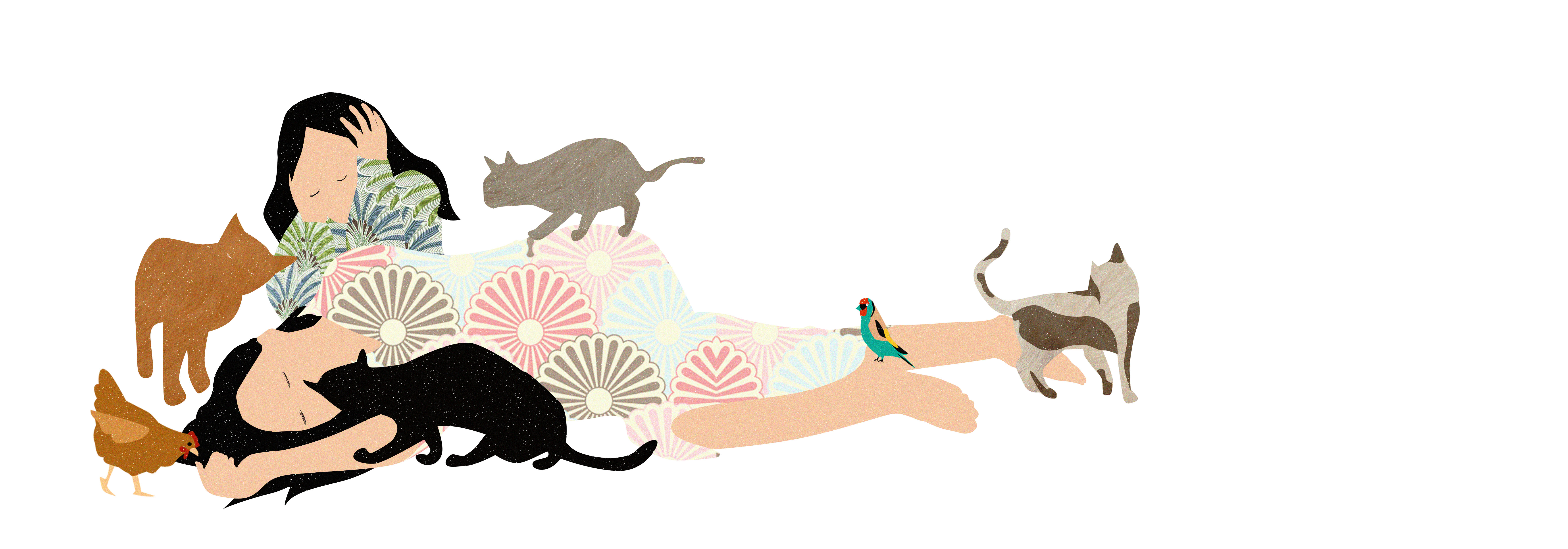Aurélie FATIN
Aurélie Fatin est plasticienne et doctorante en arts plastiques au Laboratoire LLA-CREATIS (UT2J). Elle enseigne également au département Arts plastiques-Design. Sa thèse porte sur la notion d’intermédiaire dans les dispositifs artistiques contemporains, elle y interroge les notions d’écart, de rapport à l’autre, de réception.
aureliefatin@gmail.com
Pour citer cet article : Fatin, Aurélie, « Lieux de l’œuvrer, œuvre(s) du lieu », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°9 « Lieux et non-lieux : liens au corps », printemps 2018, mis en ligne le 28/03/2018, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2018/01/09/lieux-de-loeuvrer-oeuvres-du-lieu/>.
Télécharger l’article au format PDF
Résumé
Cette réflexion retrace l’itinéraire de l’œuvre et de son processus d’effectuation depuis l’atelier jusqu’aux différents lieux de monstration traversés et habités. Elle s’appuie sur la pensée du philosophe Michel Guérin, plus particulièrement son concept de topoïetique et propose une lecture du lieu de l’œuvre comme parergon.
Mots-clés : Atelier – Installation – Œuvre – Œuvrer – Corps – Atopie – Espace – Lieu – Nomadisme – Parergon – Topoïetique – Organique
Abstract
This thinking retraces the itinerary of artwork and process of making from the studio of artist to places of exhibition that it inhabit and cross. It is based on the thought developped by the philosopher Michel Guérin, especially the concept of « topoïétique » and offers an approach of place of artwork as a paregon.
Keywords: Studio – Worshop – Art installation – Artwork – Body – Space – Place – Nomadism – Organic
Sommaire
Introduction
1. Pour une définition de l’atelier
2. Les lieux de la praxis
3. Parergon
4. L’installation, une forme transposable, transportable, fragmentable, hybride ?
5. Quand l’œuvre fait de tout lieu son lieu propre, se l’approprie
Conclusion
Notes
Bibliographie
Webographie
Introduction
Toute œuvre naît dans un lieu, y prend corps, vient s’y incarner : œuvre littéraire, œuvre plastique ou encore musicale. Si elle n’émane pas que de l’espace qui a accueilli son créateur lors de sa gestation, il n’en reste pas moins que sa naissance a eu lieu quelque part avant de migrer. En effet, toute création est amenée à des déplacements et traverse donc divers lieux1. Le tout premier de ces lieux, et non le moindre, c’est l’atelier. Reste cependant à savoir à quoi tient cet atelier ? À y regarder de près, le terme, pourtant commun, revêt nombre de réalités. Mon objet ici, ne sera cependant pas d’en faire un inventaire exhaustif mais bien de prendre appui sur ce lieu comme originaire de l’œuvre – puisqu’il la voit naître – et ainsi d’envisager les relations qu’entretiennent certains dispositifs plastiques avec les lieux qu’ils traversent.
Cette réflexion sera menée à l’aune d’une pratique plastique personnelle envisagée au prisme des références artistiques qui l’ont nourrie et la nourrissent toujours et en relation avec la philosophie pragmatique développée par John Dewey. En 1934, paraît en effet aux Etats-Unis, L’art comme expérience. Le philosophe y développe une vision de l’art basée sur l’expérience esthétique, tant celle du créateur que celle du spectateur ou regardeur… La pensée du philosophe est nourricière au sens où elle propose une esthétique toute pragmatique qui a le mérite de remettre en cause un certain nombre des mythes qui ont cours encore aujourd’hui. Pour n’en citer que quelques-uns, ceux du génie artistique, de la muséification, ou encore du statut de l’œuvre, feront partie des aspects traités dans cet article, où j’entends aborder les œuvres non pas seulement en tant que fin, résultat, mais aussi et surtout comme processus d’effectuation, comme faire, comme œuvrer. En effet, nous nous situerons ici dans une démarche où la recherche théorique et la pratique sont inextricablement liées et résonnent l’une avec l’autre.
Pour terminer cette introduction, précisons que notre champ de recherche s’attachera plus spécifiquement au médium — ou genre — de l’installation. Car c’est ici la question que nous voulons aborder : quelles sont les relations spécifiques de l’installation aux lieux et que cela nous révèle t-il d’un rapport contemporain au lieu ?
1. Pour une définition de l’atelier
Des ateliers des siècles passés, qui rassemblent maîtres et apprentis, au lieu des mondanités et du travail artistique figuré par Gustave Courbet dans son Atelier du Peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique et morale, en passant par le cabinet de travail solitaire, l’atelier à demeure ou encore la quasi entreprise où l’artiste conçoit, reçoit, collabore (Andy Warhol et la Factory, l’Olafur Eliasson Studio, l’Acconci Studio pour ne citer qu’eux), ce lieu qu’est l’atelier existe par et pour l’artiste et l’œuvre qu’il y déploie. Il recouvre ainsi autant de physionomies que l’artiste revêt de figures. Il n’y a alors pas une mais des définitions de l’atelier, chacune aussi singulière que la pratique qui s’y enracine et s’y tisse au fil des années.
Cependant, et malgré la diversité des modèles que nous pourrions dégager, tentons une caractérisation : l’atelier a toujours été et est toujours un lieu où se cristallisent la création, l’artiste, l’œuvre et le monde extérieur2. Cela nous permet de montrer en quoi la dénomination et le modèle d’atelier choisi par l’artiste nous informent sur son processus d’effectuation. Le lieu de l’œuvrer a donc une influence sur l’œuvre, au sens de production mais aussi au sens d’un ensemble de productions. Nous choisirons alors de considérer l’atelier comme le lieu — premier ou non — où se joue la praxis3. Nous insistons sur le terme « jouer », car cette praxis n’a pas seulement lieu, mais se donne aussi à voir dans ce lieu de l’œuvrer.
S’il pourra peut-être paraître vague, partant de la diversité des modèles et tentant de les rassembler tous, ce postulat présente l’avantage d’envisager aussi l’atelier comme un lieu que l’artiste occuperait temporairement voire de manière très éphémère, mais dans lequel il aurait un jeu à jouer, celui de sa pratique. En d’autres termes, l’atelier n’est pas seulement un luxe, un refuge, un espace dans lequel l’artiste se retire loin du monde et crée d’une manière toute détachée de ce dernier, mais un lieu dans lequel il éprouve le monde, c’est-à-dire, où il expérimente son être au monde par le lieu qu’il occupe, habite, interprète. L’atelier n’a donc rien d’anodin dans une pratique artistique car, ainsi que l’écrit Elisabetta Orsini dans l’ouvrage qu’elle consacre à l’atelier, « [la] pièce du moi et l’espace tangible de l’atelier d’art – se superposent pour former une unique configuration spatiale, qui les rend inséparables4.» Ce lieu où s’expérimente la pratique a une influence indéniable sur la production.
En 1973, à la mort de son mari, Louise Bourgeois investit la totalité de la maison qu’ils ont achetée ensemble des décennies auparavant comme atelier et crée ce qui est considéré comme sa première installation, La destruction du père (1974). Cette propagation de l’œuvre à l’ensemble de l’espace de la maison semble apporter une première respiration spatiale à l’artiste. De cette superposition entre espace de vie et espace de travail, l’artiste gardera le rapport aux différentes pièces de la maison (Red room parent’s, 1994), et la relation au lieu habité sera présent matériellement par l’intégration d’objets quotidiens, ordinaires et personnels (vêtements, flacons de parfum, mobilier). L’échelle de ses œuvres ne changera pourtant de manière significative que dans les années 80 lorsqu’elle installe son atelier dans une ancienne manufacture de tissu. Elle peut enfin donner à sa pratique les dimensions architecturales longtemps désirées : « Je voulais constituer un espace réel dans lequel on puisse entrer et se déplacer5 » dit-elle en effet. C’est suite à ce déplacement que prend naissance la série des Cells. Ces environnements clos sur eux-mêmes, réalisés entre 1989 et 2008, au sein desquels on peut parfois pénétrer, sont révélateurs du lien étroit que l’artiste entretient avec la maison comme espace clos, confiné. Ces lieux où se fait le travail créateur impactent donc la pratique et les formes qui en découlent. Ce sont ces contraintes inhérentes au lieu qui, au sein d’une pratique personnelle, viennent informer les productions.
Mes installations subissent ou, plus exactement, elles « font avec » le lieu. En effet, ma pratique actuelle prend appui à l’origine dans un studio de quinze mètres carrés. Dès lors, les contraintes imposées par le lieu modèlent une certaine forme installative : suspendues à une mezzanine, et tendues entre les murs de cet « atelier » qui est aussi mon lieu de vie, mes premières installations sont de simples parois qui scindent l’espace. Puis j’accède à un atelier dédié à la seule pratique. Ce qui se met alors peu à peu en place, ce sont des installations qui s’étendent dans les trois dimensions et qui s’installent de manière proliférante dans l’espace mais aussi dans la durée. Cette durée permet l’appropriation. Je m’installe donc et me sers de l’espace comme support et comme cadre. Un autre point pourtant impose ces contraintes : mon atelier est un lieu de passage ; les uns entrent, les autres sortent, sans discontinuer, puisque l’atelier que j’occupe est encore le chemin le plus court pour aller au leur. Mes installations se développent alors comme des espaces de protection, cabanes, tentes, antres précaires, refuges fragiles. Pourtant, à mesure que je m’installe, l’habitude étant prise, les passages sont de plus en plus fréquents. Mon travail s’en voit affecté, plus rien n’avance, plus rien ne naît… Il me faut alors intégrer à ma démarche cette contrainte, l’envisager comme génératrice de sens et de forme. Je conçois En découdre : faire peau neuve→Habitat, comme un processus né de la contrainte que m’impose ce lieu si particulier. Le lieu, avec ses caractéristiques spatiales, physiques, les contraintes qu’il impose humainement vient alors informer – au double sens de donner du sens et de faire forme – l’installation. Les personnes qui passent sont en effet invitées à porter un coup de ciseaux dans les fripes que je porte dans l’atelier, venant ainsi tester les limites du lieu à soi, et le développement des stratégies quant au lieu subi. L’atelier est filmé, le processus de création mis en scène.
Le corps s’assimile à l’atelier, traversé voire envahi par la présence de l’autre, qui n’est pas toujours le bienvenu et finalement agresse. La production qui en découle est alors significative du corps pénétré, agressé, perturbé : l’installation se compose d’un assemblage sommaire (sutures et épinglage) de lambeaux de vêtements, et c’est le rapport à l’atelier qui est formalisé, car :
[…] pénétrer dans [l’atelier] ne signifie pas seulement venir se heurter au corps de l’artiste, pénétrer dans le champ d’action de ses mouvements physiques, mais aussi entrer dans l’œuvre, en interférant avec le geste qui la produit. Si l’espace de l’atelier arrive à coïncider avec le corps de l’artiste, envahir le périmètre de la pièce équivaut à s’avancer outre les confins de l’épiderme […] et à s’enfoncer dans son corps6.
Le lieu, le corps de l’artiste, ainsi que la pratique et les productions qui en émanent entretiennent des liens étroits, qui sont parfois à la limite de l’adhérence. Le lieu, a fortiori celui où naît et se déroule la création, a toujours partie liée avec la production artistique à laquelle il a permis d’avoir lieu et de prendre corps. Cela nous amène cependant à poser la question suivante : l’œuvre, en tant que résultat d’un œuvrer, est-elle attachée au lieu qui l’a vu naître ou est-elle transposable ?
2. Les lieux de la praxis
Dès lors que l’atelier est envisagé comme le lieu de la praxis, il peut être partout. Dans son article « Les ateliers d’artistes au Moyen Âge : entre théorie et pratiques », Sophie Cassagnes-Brouquet souligne que l’atelier est, dès l’époque médiévale :
À la fois, cellule de base de la création et espace de formation des artistes, cette conception doit aussi composer avec la mobilité des artistes. En effet, si certains créateurs passent toute leur carrière dans la même ville, voire dans la même boutique, les ateliers sont aussi très souvent itinérants, en particulier pour les métiers de la construction tels que la maçonnerie, la sculpture et la peinture murale. La définition de l’atelier devient alors beaucoup plus ambiguë puisque, pour certains auteurs, elle s’associe à celle de chantier, par essence mouvant et temporaire7.
Ceci nous montre alors que la pratique peut se déployer dans d’autres espaces que l’atelier, c’est-à-dire dans le cadre de chantiers, ce qui n’est pas sans résonance avec de nombreuses pratiques contemporaines qui prennent corps dans d’autres lieux, d’autres espaces. Aux chantiers qu’évoque Sophie Cassagnes-Brouquet, on peut associer des lieux autres : musées, galeries, sites naturels et urbains font aussi office d’ateliers externalisés. Nous nous inscrivons alors dans le sillon de la topoïétique8, concept forgé par l’ajout ou plus exactement par la mise en évidence de la dimension topique de l’analyse poïétique. Selon cette approche, développée par le philosophe Michel Guérin, « [bien] penser (ou penser complètement), la « poïétique » suppose qu’on prenne en charge la considération topique, non comme un caractère adventice, mais comme un trait essentiel de la poïesis9.»
Jusqu’ici notre réflexion s’est orientée toute entière autour de la question du processus d’effectuation, de l’acte créateur et du rapport au lieu où celui-ci s’origine, l’atelier. Ce dernier, tout à la fois mental, physique, émotionnel, social, est en effet, le lieu au sein duquel l’artiste crée. Or, « [créer] veut dire : donner lieu [au lieu]10». Ce qui nous laisse à penser l’itinérance des « œuvres », c’est-à-dire leur déplacement, leur potentiel d’appropriation d’espaces successifs : de l’atelier aux espaces d’exposition et de monstration, les œuvres, (tout du moins la plupart) sous l’impulsion d’une réalité indéniable qu’est le « marché de l’art » et la nécessité de la monstration, sont déplacées, replacées et recontextualisées. Comment alors ne pas penser à une certaine dénaturation ? Puisqu’en effet, toute œuvre est produite au sein d’un lieu qui devient son lieu propre, c’est-à-dire un espace qu’elle s’approprie tout en s’en imprégnant, se peut-il alors qu’elle ne soit pas arrachée à sa vérité ou tout du moins amputée d’une partie de celle-ci lorsqu’elle est déplacée ? Dans les années 70, Buren déclare :
Il n’y a plus d’architecture propre à la peinture/à l’œuvre d’art (il n’y a plus d’histoire propre à la peinture/à l’œuvre d’art) qui puisse se concevoir sans passer obligatoirement par l’architecture propre au lieu où elle est exposée. D’où l’impossibilité de concevoir une œuvre en dehors du lieu où elle sera exhibée. D’où l’inutilité de l’atelier d’artiste et l’absurdité de sa survivance11.
Pour l’artiste, qui à l’époque débute sa carrière, toute œuvre, doit être in situ. C’est-à-dire pensée pour un lieu à l’exclusion de tous les autres. Cette dimension est parfaitement illustrée par T III 3312, une série d’affichages sauvages réalisés en avril 1968, à Paris « sans invitation, ni support de galerie13 » car elle perd alors sa vérité, son sens, laisse une partie de son histoire, de ce qu’a voulu l’artiste, en se déplaçant. Dans cette optique en effet, l’œuvre n’est pas transposable. Ou si elle l’est, cela entraîne la nécessité que les lieux d’exposition soient tous strictement identiques, mais alors s’attacher au lieu du faire, et faire avec n’aurait plus aucun sens.
Soulignons que la prise de position de Buren s’inscrit dans les courants qui agitent les années 60 : les artistes occidentaux inscrivent leurs démarches dans des « zones intermédiaires entre l’art et la vie14 » questionnant à la suite des avant-gardes du début du siècle la frontière entre un art sacralisé par l’institution muséale et un art qui s’inscrit dans l’espace au sens large (nature, espace public, etc…). Buren théoricien, remet en cause l’autonomie de l’œuvre d’art et proclame donc que l’art doit être in situ ou ne doit pas être, et que son atelier est la rue. Compte tenu de la carrière de l’artiste aujourd’hui, on s’interroge cependant… Nous pouvons nous rassurer par la révision qu’il fait lui-même de cette obligation dès 1975, à la faveur de ses Cabanes éclatées : il admet en effet la possibilité de « travaux situés », c’est-à-dire d’œuvres qui peuvent se déplacer, être réinstallées ailleurs, sans pour autant que l’environnement s’en voit ignoré. Mobiles, donc, ce ne sont pas pour autant, apprend-on sur le site consacré à la Monumenta de Buren (2012), « des œuvres qui peuvent s’accrocher “n’importe où” insiste Daniel Buren, et on retrouve là sa lutte contre la “soi-disant autonomie de l’œuvre d’art” ; il y a bien une règle du jeu à suivre et un type d’espace à adopter, ce sont des travaux mobiles dont on peut voir différentes combinaisons, différentes versions15».
Si la position du Buren des débuts est louable, elle n’en reste cependant pas moins discutable : l’artiste accédant rapidement à la notoriété peut en effet se permettre de telles affirmations péremptoires et exclusives quant à ce qu’est ou doit être l’œuvre. Il nous semble cependant plus pertinent de suivre la voie ouverte par Michel Guérin, parce que nettement moins sclérosante et normative. Le philosophe affirme en effet :
L’œuvre, sans doute, “fait symbole”. Toutefois, les parties qu’ainsi elle rassemble ne sont pas contiguës mais continues, ce qui signifie qu’elles appartiennent au même tout vivant de l’œuvre, loin qu’elles s’y trouvent juxtaposées comme des corps étrangers. L’œuvre se met en œuvre (en place) en tant qu’elle s’approprie un espace qui ne lui préexiste pas, mais qu’elle produit en se produisant elle-même. Toute création dans l’espace est inséparablement espace de création et création d’espace16.
Il nous semble, en effet, que cette assertion est particulièrement riche lorsque l’on choisit de s’attacher à la forme de l’installation, puisque peuvent alors être envisagées les reconfigurations, déconstructions, reconstructions. Mais nous allons y revenir. Pour le moment, et à la lumière des propos de Buren, auxquels nous n’adhérons pas, il nous reste à envisager alors quel rôle joue le lieu originaire dans l’œuvrer.
3. Parergon
Que ce soit à demeure ou dans un espace qui lui est dédié, la pratique existe aussi autrement que dans l’esprit de l’artiste : sur des croquis, plans, carnets, à l’extrême, dans les accidents, rebuts, travaux en cours, objets récupérés et qui s’intègrent ou non à ce qui est finalement montré, c’est‑à-dire l’œuvre, au sens de résultat d’un œuvrer. Ce qui se met en place dans l’œuvre, c’est toujours un monde, que l’artiste/l’œuvre emmène, un monde qu’il/qu’elle donne à voir, un univers singulier qui se construit. Tatiana Trouvé nous dit d’ailleurs : « Même si je pense qu’il n’y a pas à proprement parler une méthode de travail, cela n’existe pas. Pour moi le travail ne repose pas sur l’invention d’une méthode mais sur la constitution d’un univers17. » Ce que l’œuvre renferme, c’est bien l’œuvrer, le faire et le vécu. Ni intérieur ni extérieur, l’atelier, le lieu de la praxis, le lieu où l’installation se met en place, est alors parergon, au même titre que le cadre l’est pour une peinture, ou encore comme le sont le titre et le discours sur l’œuvre en général.
Développé par Derrida, dans La Vérité en peinture, le parergon sert à donner lieu à l’œuvre. Il « vient contre, à côté et en plus de l’ ergon, du travail fait, du fait, de l’œuvre mais il ne tombe pas à côté, il touche et coopère, depuis un certain dehors, au-dedans de l’opération. Ni simplement dehors ni simplement dedans. Comme un accessoire qu’on est obligé d’accueillir au bord, à bord. Il est d’abord l’à-bord18. » Il fixe l’œuvre et, en même temps, la met en mouvement. Michel Rémy, citant Derrida, nous éclaire19 : « (le parergon) se détache à la fois de l’ergon (ou œuvre) et du milieu « comme une figure sur un fond ». Mais, continue (Derrida), « il ne s’en détache pas comme l’œuvre. Elle se détache aussi sur un fond. Le cadre parergonal se détache, lui, sur deux fonds, mais par rapport à chacun de ces deux fonds, il se fond dans l’autre20. »
L’analyse dérridienne s’applique en tout premier lieu à la peinture, mais il nous semble que le concept est pourtant tout à fait opératoire s’agissant de comprendre l’installation. C’est bien dire aussi quelle est l’implication particulière du lieu dans les installations. Ni simplement sujet, moyen ou terrain de l’expérience plastique, le lieu tout à la fois intérieur et extérieur, s’il est contenu dans l’œuvre, contient tout autant l’œuvrer. Il existe néanmoins différentes manières d’impliquer le/les lieux dans l’œuvrer et de le/les donner à voir dans leur aboutissement. Notre attention s’attachera essentiellement à des installations qui entrent en résonance avec des productions personnelles du point de vue de leur caractère organique, ceci passant par l’utilisation de « solides souples », des matériaux qui ont « pour propriété essentielle une flexibilité permanente qui permet de les assembler par intrication mutuelle. On les utilise en plaques (écorce, cuir, tissus réunis par des liens) ou en éléments allongés (lamelles, brins et fils) dont l’enchevêtrement assure la cohésion. Ils sont tous empruntés aux solides fibreux […]21».
4. L’installation, une forme transposable, transportable, fragmentable, hybride ?
Comme nous l’avons souligné, la terminologie de Buren comporte un aspect relativement réducteur ou (dé)limitant. Sa définition de l’œuvre comme devant être in situ ou ne pas être, si elle porte en elle toute l’ardeur qui agita le milieu artistique des années 60 et 70, apparaît cependant assez discriminante, voire normalisante car excluant un grand nombre de créateurs et de productions de la sphère — (con)sacrée — de l’Art. En revanche, la notion de « travail situé » peut, elle, être opératoire, mais avec précaution : les contraintes que Buren y accole n’ont effectivement pour but que de qualifier ses propres productions. Or, il semblerait que tout travail soit situé, d’autant plus lorsque nous parlons d’installations car, ainsi que le souligne Itzhak Golberg22 :
L’espace de l’installation n’est pas uniquement envisagé littéralement dans sa qualité première, physique. Il s’agit de réfléchir sur la notion de lieu ou de site à travers l’ensemble des paramètres, réels ou imaginaires, qu’il réunit afin d’arriver à ce que Georges Didi-Huberman définit comme l’invention du lieu et où écrit-il « l’extension visible de l’espace fait place, désormais, à l’intensité visuelle d’un lieu23 ». L’installation devient une « œuvre d’art plastique qui n’est pas définissable en termes de ses dimensions ostensibles et mesurables, mais plutôt en termes d’une somme de relations éphémères, intangibles et inextricables qu’elle forge avec l’environnement24 ». On pourrait même parler d’une « anthropologie de l’espace » qui réunirait des études portant d’une part sur l’espace comme produit, et sa production ; d’autre part sur l’usage, les aspects pratiques et symboliques, producteurs eux aussi d’espaces, ou plutôt de lieux, de territoires25.
Il sera alors peut-être pertinent, afin de se prémunir de toute assignation plus ou moins asphyxiante quant au processus créatif, de se rapprocher de la posture barthésienne d’ « atopie » qu’il définit ainsi : « L’atopie, Fiché : je suis fiché, assigné à un lieu (intellectuel), à une résidence de caste (sinon de classe). Contre quoi une seule doctrine intérieure : celle de l’atopie (de l’habitacle en dérive). L’atopie est supérieure à l’utopie (l’utopie est réactive, tactique, littéraire, elle procède du sens et le fait marcher)26 ».
Ce qu’il faut entendre là, c’est la dimension proprement créative et le refus de s’assigner à un lieu, une place qui restreignent, cloisonnent. Car dès lors qu’il s’agit de réfléchir à ce que nous nommons « installation », catégorie qui « décloisonne les disciplines et brouille la séparation entre le cadre muséal et l’espace de la vie27 », la posture barthésienne d’atopie semble de mise. En effet, par son caractère mobile, hybride, fragmentable :
Cette technique ou ce genre entretient des liens avec tous les développements artistiques qui traversent le paysage esthétique de la seconde partie de XXè siècle. […] l’installation additionne ses exigences propres aux modifications apportées par les diverses avant-gardes. Ce cousinage, pour ne pas dire ces relations incestueuses, entre l’installation et les différents mouvements avec leur principes constitutifs, ne facilite pas sa définition. […] Dans la veine de l’éclatement des catégories artistiques, l’installation ne constitue pas un genre en soi, mais témoigne de l’hybridation des pratiques plastiques28.
Notre approche s’attachera donc plus à l’utilisation de certains matériaux, envisagés dans leur potentiel plastique et les effets engendrés par celui-ci, qu’à une typologie d’installation. Prenant comme point d’achoppement ma propre pratique et les productions qui en découlent, force sera de constater qu’il s’agit bien souvent de « faire atelier » avec le lieu qui accueille ces productions afin, en définitive, de pouvoir faire corps avec, y adhérer : je m’y installe pendant plusieurs jours, tente de m’approprier l’espace, de le faire mien par l’adaptation du dispositif au lieu. J’y tisse des toiles, des réseaux, ou plutôt les étend, forme, déforme, reforme des membranes, les fais proliférer. Le dispositif est stoppé le temps de l’exposition ; l’œuvrer se suspend et reste en attente d’un nouveau départ. Un même dispositif se nourrit ainsi au fil des monstrations de ce qu’il emporte des lieux traversés : les formes se modifient sensiblement, la taille aussi, et s’ajustent aux lieux d’exposition successifs. Ainsi, les installations constituées principalement de « solides souples », ont cette particularité de pouvoir s’adapter au lieu, faire corps avec ce lieu semble être l’une de leurs propriétés. Les caractéristiques de ces matériaux permettent en effet une adaptation au cadre qui accueille, reçoit, leur potentiel plastique ayant par ailleurs dès l’origine cette quasi impossibilité à être figée, donc une grande malléabilité. Si le processus et le lieu d’origine informent l’œuvrer et par là l’œuvre, le matériau a donc également une grande part à jouer dans l’étude de ce qui informe.
5. Quand l’œuvre fait de tout lieu son lieu propre, se l’approprie
Les solides souples se déforment et leur agencement ne saurait être fixe, figé, arrêté, à moins qu’un autre matériau adjoint ne vienne stopper ce potentiel d’évolution : étirement, affaissement, tension, suspension se verraient alors comme pétrifiés, l’instabilité serait alors pérennisée, réifiée. Ce potentiel du matériau souple (textile, fils, lycra), c’est-à-dire sa flexibilité, sa ductilité, est pourtant ce qui permet aux installations auxquelles ces matériaux fournissent la matière première, d’adhérer à différents espaces, de se réagencer, s’adapter, se reconfigurer sans pour autant que la « vérité » de l’œuvre, ou, pour employer un autre mot, l’intention n’en soit changée. Ainsi, La Bruja 1, installation de Cildo Meireles, a connu diverses configurations qui pourtant ne nous empêchent pas de saisir les contours de l’œuvre.
Présentée pour la première fois en 1981 à la Biennale de São Paulo, La Bruja (La sorcière) se compose d’un balai fixé au mur à la base duquel s’échappent une multitude de fils noirs. Les 2500 kilomètres de fils noirs étaient alors venus envahir le sol des trois étages du bâtiment conçu par Oscar Niemeyer. En 2009, lors de l’exposition À contre-corps au Frac Lorraine, le principe reste le même, mais les fils suivent une ligne dense tout au long des lieux d’exposition, des escaliers, avant d’enjamber le chemin de ronde de l’Hôtel Saint Livier à Metz et se déverser dans la cour de l’édifice, faisant ainsi écho à la dimension défensive de ce lieu historique. En 2011, à la Biennale de Lyon, ce sont quelques 3000 kilomètres de fils qui viennent envahir le troisième étage du Musée d’Art Contemporain et structurer tout l’espace dans lequel exposent d’autres artistes29.
L’extrême plasticité30 du matériau permet alors de coller au lieu, d’y adhérer sans réserve ainsi qu’un corps qui tenterait de s’y lover, de le faire sien, de s’y attacher, sans pour autant que l’œuvre perde son intégrité, sa vérité ou son authenticité. C’est aussi cette dimension que j’expérimente dans ma propre démarche ; tout processus d’effectuation naît du lieu d’accueil. En premier lieu, le travail du matériau et la mise en forme de celui-ci se font dans l’atelier et (se) jouent des contraintes et possibilités. Les matériaux (collants, lambeaux textiles, fils, lés de tissu extensible) sont tendus dans l’espace, celui-ci servant alors de cadre, de limite, un peu à la manière dont les bords de la feuille viennent limiter le geste pour le dessinateur. Lorsque la production se déplace, elle se reconfigure, s’étend, ou bien se rétracte, comme ce fut le cas avec [Titrer] : cette installation prend naissance dans un atelier personnel d’une vingtaine de mètres carrés, ouvert sur un espace public, et dont le toit plafonne à près de six mètres de haut. Les lanières de collants cousues entre elles viennent alors peu à peu dévorer le lieu. Ce lieu, pourtant public, « s’intimise », se personnalise par l’appropriation que j’en fais. Puis l’installation est déplacée dans différents espaces et sa forme se reconfigure, les éléments sont réagencés entre eux. Fragmenté afin de s’adapter au lieu, le dispositif redevient toujours dans son essence le même : la forme s’est sensiblement modifiée, mais l’idée d’appropriation, de prolifération reste prégnante. La forme peut alors se penser en termes de formation, c’est-à-dire comme en devenir et le dispositif plastique vient alors doubler le lieu.
![Aurélie Fatin, [Titrer], Collants, galets, fil rouge, mobilier peint en blanc, ampoules, 2013-?. De gauche à droite : Vue d'atelier, extension dans l'espace public, exposition à la Fabrique, Toulouse.](https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/files/2018/01/Aurélie-Fatin-titrer.jpg)
Aurélie Fatin, [Titrer], Collants, galets, fil rouge, mobilier peint en blanc, ampoules, 2013-?. De gauche à droite : Vue d’atelier, extension dans l’espace public, exposition à la Fabrique, Toulouse. © Aurélie Fatin.
Le lieu qui accueille se voit certes modifié par ce type d’installation, mais plus encore, les deux fusionnent en quelque sorte. Cette fusion est au cœur des œuvres de Carlie Trosclair31 (Perceiving sensibility, Intra, Cascade). Les textiles utilisés par l’artiste semblent épouser les surfaces du lieu, puis s’en extraire : plissés, vaporeux, translucides, ils sortent du mur, s’enfoncent dans les sols, venant ainsi modifier l’espace, le déformer en le doublant. L’installation Ingress32, façonnée selon ce principe, a connu deux présentations : l’une en 2009, puis la seconde lors du MFA First Show à Columbia. Ces deux occurrences de l’installation, bien qu’adhérant à chaque fois au lieu d’accueil, n’en restent pas moins une seule et même œuvre, puisque ce qui prévaut c’est alors l’étroitesse du lien avec la topographie du lieu, la contiguïté que l’œuvre entretient avec tout lieu.
La dimension hautement organique de ces matériaux se prête à une évocation du corps externalisé, le corps de l’œuvre s’étendant alors de manière potentiellement infinie dans le lieu, disparaissant avant de se réinstaller éventuellement ailleurs : il s’agit alors d’intégrer dans le corps-même de l’œuvre, dans son itinéraire, la possibilité que l’œuvre soit scindée, découpée, ré-adaptée, modifiée, voire reconfigurée sans pour autant que le propos n’en soit fondamentalement changé. C’est ce à quoi m’a amené la délocalisation fréquente de mes travaux. Ce sont aussi les contingences liées à ces déplacements obligés qui m’ont par ailleurs conduit à choisir des matériaux légers, malléables, facilement transportables et dont le potentiel de reformation est quasi-infini. Nous aimerions cependant terminer sur un dernier exemple, et non des moindres sur cette question : le Léviathan Thot d’Ernesto Neto. Cette installation textile, fut conçue en 2006 par l’artiste pour le Panthéon, suite à une commande publique du CNAP33.
Monstre anthropomorphe, inspiré du mythe dont elle tire son nom, l’œuvre monumentale, à la fois organique et architecturale, fut scindée, fragmentée, et la main gauche du Léviathan exposée en 2009 dans le patio du Musée des Beaux-Arts de Nantes, à l’occasion de la seconde édition du Festival Estuaire. En effet, l’œuvre intégrale ne rentrait pas dans ce nouvel espace, plus bas de plafond et aux dimensions nettement plus modestes. Pourtant, l’œuvre ne perd en rien son intégrité puisque les principes voulus et explorés par l’artiste depuis plusieurs décennies, s’y trouvent encore :
La sculpture comme corps spatial, le sol comme espace, lieu où l’environnement sociopolitique rejoint le désir d’infini, le monde pour terre, la gravité pour pensée physique et la structure du tout en éternel conflit avec la puissance de la matière, équilibre et tensions des pouvoirs, relation des énergies, par-delà la culture. […] Cette sculpture est construite, ou plutôt, ainsi que j’aime à le dire, apparaît, se développe, comme un organisme de contact. Ce monstre humanoïde est fait, comme la plupart de mes œuvres, d’une relation complémentaire entre deux éléments ou une combinaison de relations de ces deux éléments : le corps, d’une part, ses harnais d’autre part. […] Tout cela sera suspendu et ne trouvera l’identité de sa forme que dans l’équilibre résultant d’un conflit entre gravité et matière… jusqu’à s’immobiliser34.
Tout juste pourrait-on se poser la question du sens à donner à ce découpage du monstre : la symbolique – le monstre démembré, terrassé – ne s’en trouverait-elle pas enrichie ou complétée ? L’histoire de l’œuvre, son itinéraire, s’écrivant dès lors de manière labile ? Ne pourrions-nous pas, en ce qui concerne spécifiquement ces productions s’assimilant au corps organique, parler de dispositifs à morphologie variable ? La notion de morphologie nous ramène à l’organique et à son potentiel de croissance, d’évolution. Ceci pourrait peut-être nous amener à penser ces installations comme (ré)génératrice de lieu et témoignant d’une certaine morphogénèse du lieu. La morphogénèse désignant en effet, le « développement des formes, des structures » et en embryologie, l’ « ensemble des transformations que subit l’embryon avant d’acquérir sa forme spécifique35.» Puisque c’est aussi bien à cela que nous assistons : à l’évolution de ces œuvres au travers des lieux qu’elles traversent et avec lesquels elles font corps.
Conclusion
Les installations que nous avons évoquées, par les matériaux employés, souples, malléables, nous semblent à même de faire corps avec les lieux dans lesquels elles s’incarnent. Ainsi, et en ce sens, ce qui se joue, c’est une forme d’appropriation de ces espaces de monstration qui accueillent ces « chantiers artistiques ». A s’attarder en effet à la mise en espace de ces dispositifs qui usent de textiles, fils, exploitent le motif de la toile, du réseau, on constate que les lieux d’exposition deviennent espaces de travail36, donc ateliers. Car, comme l’écrit Elisabetta Orsini : « […] quand il [l’artiste] travaille, il prend possession de tout l’espace dont il a besoin, tandis que, dans le même temps, l’espace s’intériorise en lui. Cela explique que l’atelier de l’artiste soit toujours exportable et transportable37 ».
Elle ajoute que :
Le corps au travail est expansif et envahisseur et inclut le monde qui l’entoure, comme si c’était le corps qui entoure et enveloppe le monde. De ce point de vue l’artiste ressemble plus à un gigantesque Léviathan qu’à un simple démiurge, puisque ce qu’il organise par son action, constitue une partie intégrante de sa monstrueuse individualité38.
À l’heure où l’artiste est bien souvent appelé à résidence pour pouvoir exister — subsister — donc à séjourner temporairement dans un lieu – un atelier mis à sa disposition –, ne doit-il pas, à l’image de notre société contemporaine, envisager sa production comme adaptable, fragmentable, mobile, nomade ? La tentation est alors grande de lutter contre une sensation gênante de fugacité, d’impossibilité à s’ancrer, à s’en-raciner, et peut-être est-ce alors tout l’enjeu des pratiques d’installation, a fortiori celles dont il a été question. Tentation d’envahir, de s’approprier en adhérant au lieu, tentative de lui « colle(r) à la peau » , le décalquant tout en s’en distinguant. Cet « as-semblement », comme le nomme Michel Guérin, c’est-à-dire le « lien de l’être-œuvre avec l’œuvre-lieu39 » nous semble en effet résonner avec la mobilité contemporaine – la traversée des lieux – de l’artiste et de sa production. Mobilité de l’artiste et de son œuvre(r), délocalisation inhérente à la diffusion, et nécessité d’appropriation, ces conditions génèrent pourtant une forme apprivoisée de nomadisme, à laquelle les propos de Tatiana Trouvé font écho lorsqu’elle nous dit : « [chaque] nouvelle exposition, c’est comme si je partais m’installer quelque part. Il ne suffit pas de prendre deux valises et de partir » ajoutant qu’ « il y a un va-et-vient constant entre différents fragments de l’atelier, de la maquette et de l’espace réel40 ».
Notes
1 – Ne serait-ce que de l’esprit de son créateur à son incarnation dans le réel, toute œuvre est la résultante d’un mouvement de déplacement, de va-et-vient incessants.
2 – Isolé dans son atelier ou y recevant, l’artiste ne saurait être – mis à part quelques cas extrêmes – totalement détaché du monde extérieur à moins que l’on ne parte du principe qu’il ne serait pas inclus dans la société, donc qu’il n’en serait ni partie prenante ni vecteur.
3 – Praxis est à entendre comme opposition à la seule théorie, sans l’exclure mais l’incluant bien au contraire au sein d’un processus pratique d’acquisition de connaissances, savoirs, savoir-faire et savoir-être.
4 – E. ORSINI, Atelier, Lieux de la pensée et de la création, Paris, Éditions Mimesis Philosophie, 2007, p. 31.
5 – Louise Bourgeois dans L. BOURGEOIS, Estructuras de la existencia: las Celdas, Julienne Lorz (ed.), catalogue d’ exposition, FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, et La Fábrica, Madrid, 2016, p. 28.
6 – E. ORSINI, Op. cit., p. 57.
7 – S. CASSAGNES-BROUQUET, « Les ateliers d’artistes au Moyen Âge : entre théorie et pratiques », Perspective [En ligne], Volume 1, 2014, pp.83-98, mis en ligne le 31 décembre 2015, consulté le 30 janvier 2017. URL : http://perspective.revues.org/4391, p. 83.
8 – Voir M. GUÉRIN, L’espace plastique, Bruxelles, Éditions La part de l’œil, Collection théorie, 2008.
9 – M. GUÉRIN, « Le concept de topoïétique », Philosophiques, Volume 24, Numéro 1, 1997, pp. 127–140, consulté le 6 juillet 2014. URL : https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1997-v24-n1-philoso1804/027427ar.pdf, p. 135.
10 – Ibid.
11 – D. BUREN, Notes sur le travail, rédigées entre 1967 et 1975. Consultées sur le site de la Monumenta 2012, le 2 mars 2017. URL : http://2012.monumenta.com/. Chemin : médias ˃ Textes ˃ Notes sur le travail. Le texte est issu de : Studio international, Londres, Volume 190, Numéro 977, Septembre-octobre 1975, p. 124-125 (anglais) ; repris in Catalogue Daniel Buren, Genève, Centre d’Art Contemporain Salle Patiño, 1976.
12 – Pour plus d’informations, nous renvoyons le/la lecteur/trice au site de l’artiste . URL : https://danielburen.com/map?type=exhibits_current. Chemin : Catalogue raisonné 1967-1972 ˃ page 2 ˃ T III 33. Il/elle y trouvera par ailleurs de nombreux et riches exemples du travail in situ que l’artiste réalise à cette époque.
13 – L’ in-situ tel que défini par Buren peut encore être illustré par ses célèbres Colonnes (1986). Cependant, l’œuvre commanditée par le ministère de la culture pour la cour du Palais Royal à Paris est faite à un artiste ayant accédé à une notoriété certaine, ou pour le dire grossièrement à l’une des « valeurs sures » de l’art contemporain. Le « cahier des charges artistiques » qu(e s)’impose l’artiste est dès lors plus aisé à remplir…
14 – F. DE MEREDIEU, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain (1994), Paris, Larousse, Collection « In extenso », 2011, p. 402.
15 – Site web de la Monumenta 2012, lors de laquelle l’artiste présente l’œuvre Excentrique(s). Consulté le 10 mars 2017. URL : http://2012.monumenta.com/. Chemin : Concepts clés ˃ Travail situé.
16 – M. GUÉRIN, Op. cit., pp. 132-133.
17 – Propos recueillis par Florence Ostende pour la revue Catalogue [En ligne]. « Tatiana Trouvé à la South London Gallery », Catalogue, Numéro 5, Septembre 2010, consulté le 15 janvier 2017. URL : http://www.cataloguemagazine.net. Chemin : Archive ˃ Numéro 5 ˃ Tatiana Trouvé à la South London Gallery.
18 – J. DERRIDA, La vérité en peinture (1978), Paris, Flammarion, Collection Champs essais, 2010, p. 63.
19 – M. REMY, « Le cadre abymé, le cadre inter-dit », Polysèmes [En ligne], Numéro 11, 2011, mis en ligne le 01 mars 2015, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://polysemes.revues.org/655 ; DOI : 10.4000/polysemes.655.
20 – J. DERRIDA, Op.cit., p. 71.
21 – A. LEROI-GOURAN, L’homme et la matière, Évolution et techniques, Paris, Albin Michel, 1943, p. 235.
22 – L’ensemble de la citation est issu de : I. GOLDBERG, Installations, Paris, CNRS Éditions, 2014, pp. 181-182. L’auteur y reprend les propos de Georges Didi-Huberman, Sally Jane Norman et Colette Pétonnet (voir notes suivantes).
23 – G. DIDI-HUBERMAN, Fables du lieu, Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, 2001, p. 12.
24 – S. J. NORMAN, « Du Gesamtkunstwerk wagnérien aux arts des Temps modernes : spectacles multimédias, installations minimalistes », in D. BABELOT (sous la direction de), L’œuvre d’art totale, Paris, CNRS Éditions,1995, p. 280.
25 – C. PETONNET, Histoire urbaine, anthropologie de l’espace, Paris, CNRS Éditions, p. 21, in V. GOUDINOUX, « Voguez à ma suite, camarades aviateurs…, Prologue à une exposition », Catalogue d’exposition 50 Espèces d’espaces, Marseille, Musée de Marseille, 28 novembre 1998-30, mai 1999, p. 14.
26 – R. BARTHES, Roland Barthes par Roland Barthes, in R. BARTHES, Œuvres complètes, Tome 4 – 1972-1976, Paris, Éditions du Seuil, 2002, p. 133.
27 – I. GOLDBERG, Op.cit., p. 23.
28 – Ibid., pp. 22-23.
29 – Le/la lecteur/trice pourra se référer utilement au dossier de presse de l’exposition À contre corps (Frac Lorraine, 2009), téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.fraclorraine.org/media/pdf/PresseContreFR.pdf, ainsi qu’au site web de la 11è Biennale de Lyon (Une terrible beauté est née, 2011). URL : http://2011.labiennaledelyon.com/. Chemin : Scolaires ˃ Pistes pédagogiques ˃ Vignette Cildo Meireles. Consultés le 10 avril 2017.
30 – Rappelons que le terme plasticité désigne le potentiel plastique. Le terme « plastique », est lui-même tiré du grec plastikos, qui signifie « malléable, qui sert à modeler, relatif au modelage» lui-même dérivé de plassein : « façonner (de l’argile, de la cire) », au figuré « former (quelqu’un) » et « éduquer », « imaginer faussement, fabriquer des mensonges ». Source : Le Trésor de la langue française informatisé. URL : http://atilf.atilf.fr/.
31 – Nous renvoyons le lecteur au site web de l’artiste. URL : http://carlietrosclair.com/.
32 – Voir le site web de l’artiste. URL : http://carlietrosclair.com/. Consulté le 10 décembre 2016. Chemin : Portfolio˃ Fabric works ˃ Vignette Ingress
33 – Centre National des Arts Plastiques.
34 – Propos recueillis par Sarah Jeong à l’occasion de la 35è édition du Festival d’Automne à Paris en 2006. Dossier de presse du Festival d’automne à Paris 2006, consulté le 20 juin 2017. Téléchargeable sur le site web du Festival d’automne. URL : https://www.festival-automne.com. Chemin : Le Festival d’Automne à Paris ˃ Archives ˃ Tous les artistes : N ˃ Neto Ernesto ˃ Téléchargement : Dossier de presse.
35 – Le Trésor de la Langue Française informatisé. URL : http://atilf.atilf.fr/. Entrée « Morphogenèse ». Consulté le 20 avril 2016.
36 – Nous renvoyons les lecteur/trice/s, concernant cet aspect, à quelques ressources web : sur le site de Toma Sarraceno, il/elle trouvera de nombreuses photographies documentant la réalisation de l’œuvre 14 billions à la Bonniers Konstall, à Copenhague. URL : http://tomassaraceno.com/projects/14-billions/.
La courte vidéo Chiharu Shiota in Het Noordbrabants Museum, publié par le Het Noordbrabants Museum, documente quant à elle le montage de l’installation Between the lines. URL : https://www.youtube.com/watch?v=N051PA5VDX4.
Enfin, la vidéo publiée par le Salon de Montrouge présente le montage de l’édition 2014 du salon, et donc différentes appropriations des lieux de l’exposition. URL : http://www.artube.fr/fr/video/show/salon-de-montrouge-2014-montage-de-l-exposition.
Ressources consultées en août 2017.
37 – E. ORSINI, Op.cit., p. 210.
38 – Ibid., p. 28.
39 – M. GUÉRIN, « Le concept de topoïétique », Op. cit., p. 135.
40 – Propos recueillis par Florence Ostende pour la revue Catalogue [En ligne]. Voir note 15.
Bibliographie
BARTHES, Roland, Roland Barthes par Roland Barthes, in R. BARTHES, Œuvres complètes, Tome 4 – 1972-1976, Paris, Éditions du Seuil, 2002.
BUREN, Daniel, Notes sur le travail, rédigées entre 1967 et 1975. Consultées sur le site de la Monumenta 2012, le 2 mars 2017. URL : http://2012.monumenta.com/. Chemin : médias ˃ Textes ˃ Notes sur le travail. Le texte est issu de : Studio international, Londres, Volume 190, Numéro 977, Septembre-octobre 1975, p. 124-125 (anglais) ; repris in Catalogue Daniel Buren, Genève, Centre d’Art Contemporain Salle Patiño, 1976.
CASSAGNES-BROUQUET, Sophie, « Les ateliers d’artistes au Moyen Âge : entre théorie et pratiques », Perspective [En ligne], Volume 1, 2014, pp.83-98, mis en ligne le 31 décembre 2015, consulté le 30 janvier 2017. URL : http://perspective.revues.org/4391.
DE MEREDIEU, Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain (1994), Paris, Larousse, Collection « In extenso », 2011.
DERRIDA, Jacques, La vérité en peinture (1978), Paris, Flammarion, Collection Champs essais, 2010.
DIDI-HUBERMAN, Georges, Fables du lieu, Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains, 2001.
GUÉRIN, Michel, « Le concept de topoïétique », Philosophiques, Volume 24, Numéro 1, 1997, pp. 127–140, consulté le 6 juillet 2014. URL : https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/1997-v24-n1-philoso1804/027427ar.pdf.
GUÉRIN, Michel, L’espace plastique, Bruxelles, Éditions La part de l’œil, Collection théorie, 2008.
GOLDBERG, Itzhak, Installations, Paris, CNRS Éditions, 2014.
LEROI-GOURAN, André, L’homme et la matière, Évolution et techniques, Paris, Albin Michel, 1943.
NORMAN, Sally Jane, « Du Gesamtkunstwerk wagnérien aux arts des Temps modernes : spectacles multimédias, installations minimalistes », in D. BABELOT (sous la direction de), L’œuvre d’art totale, Paris, CNRS Éditions, 1995.
ORSINI, Elisabetta, Atelier, Lieux de la pensée et de la création, Paris, Éditions Mimesis Philosophie, 2007.
PETONNET, Colette, Histoire urbaine, anthropologie de l’espace, Paris, CNRS Éditions, p.21, in V. GOUDINOUX, « Voguez à ma suite, camarades aviateurs…, Prologue à une exposition », Catalogue d’exposition 50 Espèces d’espaces, Marseille, Musée de Marseille, 28 novembre 1998-30, mai 1999.
REMY, Michel, « Le cadre abymé, le cadre inter-dit », Polysèmes [En ligne], Numéro 11, 2011, mis en ligne le 01 mars 2015, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://polysemes.revues.org/655 ; DOI : 10.4000/polysemes.655.
Webographie
Site web de la Biennale de Lyon. URL : http://2011.labiennaledelyon.com.
Site web de Daniel Buren. URL : https://danielburen.com.
Site web de la revue Catalogue [En ligne]. URL : http://www.cataloguemagazine.net. Entretien avec Tatiana Trouvé : « Tatiana Trouvé à la South London Gallery », Catalogue, Numéro 5, Septembre 2010, consulté le 15 janvier 2017. Chemin : Archive Numéro 5 Tatiana Trouvé à la South London Gallery.
Site web de l’artiste Carlie Trosclair. URL : http://carlietrosclair.com.
Site web du Frac Lorraine. URL : https://www.fraclorraine.org.
Site web du Festival d’Automne de Paris. URL : https://www.festival-automne.com.
Site web de la Monumenta 2012. URL : http://2012.monumenta.com.
Site web de l’artiste Toma Sarraceno. URL : http://tomassaraceno.com.
Salon de montrouge 2014 – montage de l’exposition. Vidéo publiée par le Salon de Montrouge 2014, sur le site web artube. URL : http://www.artube.fr/fr.
Chiharu Shiota in Het Noordbrabants Museum, vidéo publiée par le Het Noordbrabants Museum sur Youtube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=N051PA5VDX4.