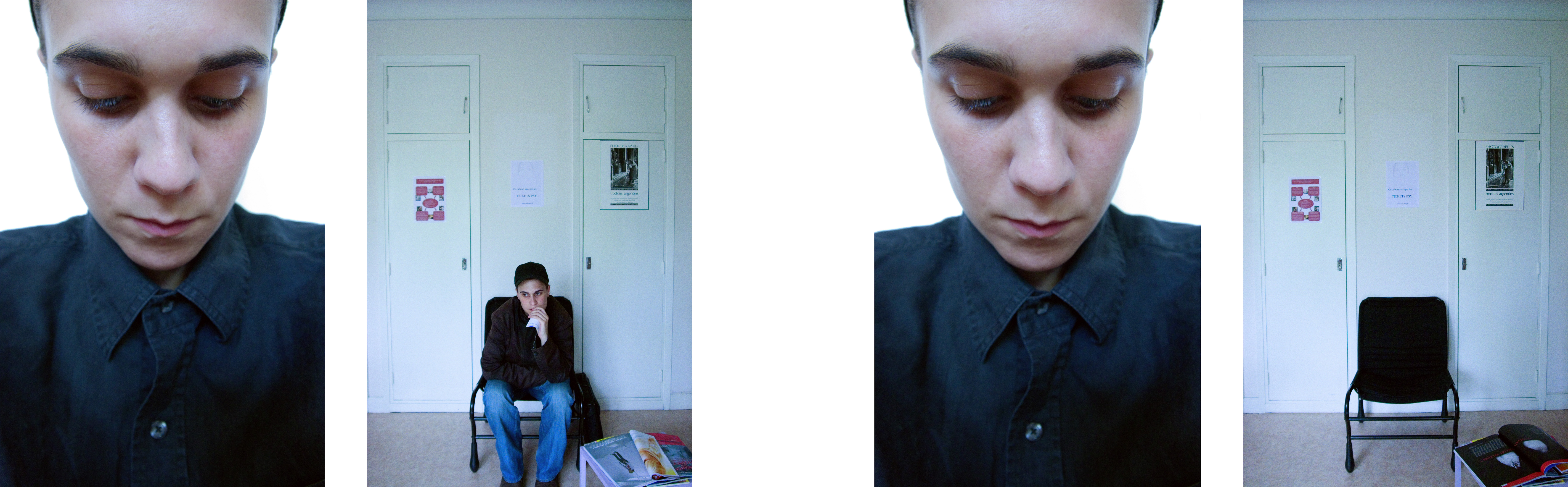Marion D’Amato
Docteur en Arts Plastiques, Laboratoire LLA CREATIS, E.D. Allph@, Université Toulouse Jean – Jaurès
marion.damato@wanadoo.fr
Pour citer cet article : D’Amato, Marion, « Les narrations taxidermiques de Polly Morgan. », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°5 « Image mise en trope(s) », 2013, mis en ligne en 2013, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2018/01/09/la-ville-contemp…ite-au-generique/>.
Télécharger l’article au format PDF
Résumé
La taxidermie est l’art de donner l’apparence du vivant à des animaux morts. Si nous revenons à l’étymologie du mot, nous apprenons qu’il vient du grec taxis qui signifie l’ordre, l’arrangement, et derma, la peau. Il s’agit donc, par un travail sur le matériau tégumentaire, de faire « revivre » des animaux morts, « d’arranger » leurs cadavres afin de donner l’illusion du vivant. Dans son travail, Polly Morgan emploie la taxidermie en sortant les animaux de leurs contextes naturels, les mettant en scène pour raconter, proposer des histoires qui renvoient les spectateurs à des références culturelles occidentales. Qu’ils soient figurés morts, yeux fermés et corps figés alanguis, ou vivants, yeux ouverts et corps figés en pleines actions, les animaux de Polly Morgan obéissent à cette dichotomie factice intrinsèque à la taxidermie. En effet, où arrêtons-nous de voir le cadavre pour suivre l’histoire que l’artiste nous propose à travers l’animal mis en scène ? Comment ce glissement s’opère-t-il et en quoi les images mentales permettent au spectateur d’entrer dans cet univers ?
En effet, le choix d’employer de petits animaux ainsi que des objets miniatures pour créer leur environnement, renforce le parti-pris artistique de Polly Morgan, dans lequel les animaux sont humanisés, prêts à nous livrer leurs sentiments, ou plutôt les sentiments que nous leur prêtons. Dans un champ artistique doté de références de contes et légendes, teinté de précieux et de féminin, Polly Morgan nous entraîne ainsi vers un univers particulier, habité de bêtes mortes qui semblent revêtir les contours d’une humanité perdue.
En étudiant dans un premier temps les choix scénographiques de l’artiste, notamment avec les œuvres Lovebird, Tribute to sleeping beauty, ou encore Still life after death (Rabbit), nous questionnerons l’enjeu de la fiction en tant qu’élément transcendant l’image initiale. Dans un second temps, nous analyserons l’œuvre Carnevale, qui par la figuration corporelle de la référence humaine nous demande qui de l’humain ou de l’animal dessine les contours de l’autre, tout en laissant visiblement le temps en suspens grâce à l’action figée, permettant ainsi au spectateur de saisir les tropes auxquels il fait face.
Mots-clés : taxidermie – animal – art contemporain – Polly Morgan – trope
Abstract
Taxidermy is the art of giving dead animals a lifelike appearance. If we get back to etymology, we learn that it comes from the greek taxis which means order, arrangement, and derma, skin. By a work on material tegument, it consists in bringing dead animal back to life, arranging their carcass so as to give an illusion of life. Through her work, Polly Morgan uses taxidermy in extracting animals out of their natural environment, staging them to relate, suggesting stories which refer to western cultural references. Whether they’re represented dead, eyes closed and body languid in a fixed manner, or alive, eyes opened and body frozen into action, Polly Morgan’s animals obey to this artificial dichotomy intrinsic to taxidermy. Indeed, when do we stop watching the carcass and start following the story proposed by the artist with her animals? How this shift in meaning is operating and how mental images make it possible to the spectator to come into this universe?
Using little animals and miniature objects so as to create their environment, reinforces Polly Morgan’s preconception, where animals are humanized, ready to give us their feelings, or feelings which we give them. In an artistic field with a lot of tales and legends references, tinged with precious and feminine, Polly Morgan is taking us into a particular universe, filled with dead animals which seem to hold a lost humanity.
Studying at first the artist’s scenography choices, with works like Lovebird, Tribute to sleeping beauty, or Still life after death (Rabbit), we’ll question fiction’s stake as the element transcending the initial picture. Secondly, we’ll analyze the work Carnevale, which, with human body figuration, is asking us who of the human or the animal is drawing limits of the other, while leaving time in abeyance thanks to fixed action, allowing the spectator to understand the tropes they are confronted with.
Keywords: taxidermy – animal – contemporary art – Polly Morgan – trope
Sommaire
1. La narration, l’enjeu de l’espace plastique chez Polly Morgan
2. Le temps en suspens et l’action figée, se saisir des tropes
Notes
Bibliographie
La taxidermie est l’art de donner l’apparence du vivant à des animaux morts. Si nous revenons à l’étymologie du mot, nous apprenons qu’il vient du grec taxis qui signifie l’ordre, l’arrangement, et derma, la peau. Il s’agit donc, par un travail sur le matériau tégumentaire, de faire « revivre » des animaux morts, « d’arranger » leurs dépouilles afin de donner l’illusion du vivant. Des muséums d’histoire naturelle jusqu’aux cabinets de curiosité, la taxidermie se place dans un système ambigu, entre dégoût et fascination. Figés dans des postures qui se veulent naturelles, mémoires mortes d’animaux sauvages et domestiques servant à reconstituer un état premier, ou bien chimères fantastiques illustrant ou inventant des légendes, les animaux empaillés sont le témoignage d’une pratique humaine qui cherche à arrêter le temps, conserver un patrimoine, tout en reconstituant et donnant un contexte précis à l’animal naturalisé. Le taxidermiste, artisan à part entière, est ainsi perçu à la fois comme un scientifique consciencieux, mais aussi comme un sculpteur de la matière morte, pour laquelle la mise en scène est savamment travaillée. Celle-ci se doit alors d’informer le spectateur sur l’objet auquel il fait face, tout en dépassant l’image visuelle première de l’animal mort, pour faire émerger une image mentale autre.
Les questions du statut du créateur, de l’identité de sa créature, et de sa réception par le spectateur sont ainsi particulièrement prégnantes. Il n’est donc pas étonnant que la pratique de la taxidermie soit employée dans le champ de l’art contemporain, car elle met en jeu plusieurs niveaux de réception de l’œuvre. Entre réalité et fiction, cette pratique artistique invite à une narration qui va au-delà de l’image de l’animal mort.
Polly Morgan, artiste contemporaine anglaise, travaille depuis 2005 la taxidermie comme pratique artistique à part entière. Elle l’emploie en sortant les animaux de leurs contextes naturels, les mettant en scène pour raconter, proposer des histoires qui renvoient les spectateurs à des références culturelles occidentales et populaires. Qu’ils soient figurés morts, yeux fermés et corps figés alanguis, ou vivants, yeux ouverts et corps figés en pleines actions, les animaux de Polly Morgan obéissent à cette dichotomie factice intrinsèque à la taxidermie. En effet, où arrêtons-nous de voir le cadavre pour suivre l’histoire que l’artiste nous propose à travers l’animal mis en scène ? Comment ce glissement s’opère-t-il et en quoi les images mentales permettent au spectateur d’entrer dans cet univers ?
En étudiant dans un premier temps les choix scénographiques de l’artiste, notamment avec les œuvres Lovebird, et une Sans titre pour l’exposition collective Mythologies, nous questionnerons la narration en tant qu’élément transcendant l’image initiale dans l’enjeu de l’espace plastique. Dans un second temps, nous analyserons les œuvres Still life after death (Rabbit), et Carnevale1, qui par l’allusion et la figuration corporelle de la référence humaine nous demandent qui de l’humain ou de l’animal dessine les contours de l’autre, tout en laissant visiblement le temps en suspens grâce à l’action figée, permettant ainsi au spectateur de saisir les tropes auxquels il fait face.
1. La narration, l’enjeu de l’espace plastique chez Polly Morgan
Le choix d’employer de petits animaux ainsi que des objets miniatures pour créer leur environnement, renforce le parti pris artistique de Polly Morgan, dans lequel les animaux sont humanisés, prêts à nous livrer leurs sentiments, ou plutôt les sentiments que nous leur prêtons. Dans un champ artistique doté de références de contes et légendes, teinté de précieux et de féminin, l’artiste nous entraîne ainsi vers un univers particulier, habité de bêtes mortes qui semblent revêtir les contours d’une humanité perdue. Contrairement au travail de Damien Hirst2 qui expose des animaux morts conservés dans du formol, Polly Morgan instaure une narration particulière, où l’animal est mis en scène dans une apparente légèreté. Par ailleurs, notons ici que pour garantir la pérennité de ses œuvres, Damien Hirst est obligé de remplacer les animaux ainsi conservés, puisque le formol ne fait que ralentir la décomposition des corps, il ne la stoppe pas. Il ne s’agit donc pas de taxidermie, qui emploie d’une part uniquement la peau des animaux morts, et qui d’autre part suspend l’état de mort et de dégradation, obstacle au cycle naturel.
Pour Polly Morgan, il ne s’agirait donc plus uniquement de mettre le spectateur face à sa propre conscience de la mortalité, mais de l’inviter à découvrir ce qui est susceptible d’advenir au-delà, dans l’au-delà ou par-delà le cadavre, alors transformé en objet plastique par le biais de sa mise en scène.
L’œuvre Lovebird, réalisée en 2005, joue ainsi sur plusieurs niveaux de lectures. De prime abord, cette œuvre présente sous une cloche en verre un oiseau sur un perchoir, faisant face à son reflet dans un miroir, avec à son pied une peau de souris blanche transformée en tapis. La scène est surélevée par un socle à trois marches, et mise en lumière par un minuscule lustre. Les détails sont extrêmement soignés, et témoignent du travail méticuleux effectué par l’artiste. En cloisonnant ainsi son œuvre par une cloche en verre, Polly Morgan appuie la théâtralité de la mise en scène, le côté précieux et fragile, ainsi que la référence aux cabinets de curiosité. À défaut d’une étiquette apposée sur l’objet, le titre de l’œuvre vient orienter notre lecture de l’œuvre, et engage la narration instaurée par l’artiste. Pour Daniel Sibony, philosophe et psychanalyste, dans son ouvrage Création, essai sur l’art contemporain paru chez Seuil en 2005 :
Le propre de l’artiste est qu’il crée une œuvre, une mise en situation, à chaque détour marquant du processus : là où les autres changent de cadre mais sans confier au nouveau cadre la tâche de montrer le passage, d’incarner cette secousse d’identité sur un mode créatif partageable. Certes, il y a eu pour eux un passage, mais l’artiste, lui, incarne ce passage, cette rupture d’identité dans une œuvre, comme élément d’un jeu de l’être où les autres sont impliqués. Du reste, il les appelle à venir reconnaître les traces du passage en question, les traces qu’ils n’ont pas remarquées en les vivant. Et s’ils les voient dans l’œuvre, ça leur donne de l’énergie, ça les « accroche », il y a « rencontre »3.
La rencontre proposée par Polly Morgan se joue dans l’ensemble des détails mis en scène, plus que dans les animaux figés par la taxidermie, et ce même s’ils renvoient à leurs propres morts dans la narration comme nous le verrons plus tard. Les détails donc, sont à analyser et à assembler, de façon à oublier la morbidité des cadavres et à saisir la fiction qui les met en œuvre. Le glissement, ou le passage comme le nomme Daniel Sibony, semble résider dans la découverte de ces détails, dans le titre de l’œuvre, mais aussi dans le miroir, autre figure principale de la création. En anglais, lovebird renvoie aux oiseaux inséparables, connus pour vivre en couple et ne supportant pas la solitude, se laissant mourir si leur compagnon disparait. Pourtant, il n’y a là qu’un seul oiseau, qui se regarde, ou plutôt qui regarde le spectateur par le reflet du miroir. Par ailleurs, le miroir, figure qui a fasciné nombre d’artistes au cours des différents siècles fait appel à plusieurs références bien spécifiques, telles que celle de Méduse vaincue par Persée et son bouclier, Narcisse, ou encore Blanche Neige. Ici, il semble que tout est symbole, appel au spectateur pour rentrer dans la narration plastique, et ainsi dépasser les objets réels employés. Pour reprendre les termes de Daniel Sibony, il s’agit là de reconnaître les traces du passage en question. Mais il ne faut pas en rester à cette reconnaissance, c’est-à-dire qu’il faut effectivement comprendre les signes plastiques mis en jeu, et ensuite effectuer un retour sur l’espace plastique. Celui-ci ne tiendrait-il dès lors qu’au simple fait des symboles utilisés ? Comme le dit Michel Guérin dans son livre L’Espace Plastique4, l’œuvre fait symbole, en ne relevant pas d’une contigüité de ses différentes parties, mais bien d’une continuité de celles-ci :
L’œuvre se met en œuvre (en place) en tant qu’elle s’approprie un espace qui ne lui préexiste pas, mais qu’elle produit en se produisant elle-même. Toute création dans l’espace est inséparablement espace de création et création d’espace.
L’œuvre n’était pas là avant d’exister, c’est un fait, mais en surgissant, elle témoigne de son propre espace, comme de la création de celui-ci et d’elle-même, dessinant ainsi des limites plus ou moins marquées, selon son appropriation par le spectateur. Et c’est ici même que se dessine l’espace plastique, en regroupant espace représenté, représentation d’espace, et espace du lien au spectateur. L’œuvre est formée de son tout et de ses parties, et sa lecture tient de la considération de cet état. Le spectateur doit se saisir du tout et des parties, entrer dans la pensée plastique qui est selon Michel Guérin reprenant Pierre Francastel :
Constellante ou rayonnante ; elle commence partout à la fois. Elle projette d’un coup son espace tout en le parcourant en détail. Est plastique un processus dans lequel priment les suggestions qui remontent de la matière, et qui président à la déformation-reformation.5
Cette appropriation s’effectue donc par strates successives, ou plutôt continues, à mesure que les indices référentiels se dévoilent. Pour Lovebird, l’espace est dans un premier temps concrètement marqué par la cloche en verre, et se déploie ensuite dans les indices distillés par l’artiste. En ne se regardant pas directement dans le miroir l’oiseau semble faire référence au mythe de Méduse et Persée. En effet, par analogie, nous pourrions penser que s’il se regardait lui-même, il serait figé dans sa propre image, alors que dirigé vers l’extérieur de la cloche en verre, c’est bien au spectateur que s’adresse cette fixation. Ainsi, nous nous retrouvons figés par ce regard, invités par ce lien visuel à faire partie de la mise en scène sous cloche. Il y a là plusieurs enchaînements autour du reflet : celui du miroir et de ses différentes projections, celui du regard, miroir de l’âme, qui retient le spectateur en quête de liens plastiques, et celui des reflets de la couche en verre qui renvoie plusieurs effets visuels qui pourraient mettre le spectateur à distance. Ces enchaînements et leur compréhension permettent alors de faire émerger la question de la place du spectateur au sein de l’œuvre. Nous l’avons dit, le regard de l’oiseau orienté vers l’extérieur permet d’entrer sous la cloche, mais il permet également d’appuyer la contradiction avec ce qui se passe en-dedans et en-dehors. En-dedans, par la taxidermie, les animaux renvoient à leurs propres morts, depuis la souris pour laquelle la peau entière est juste déposée comme le serait réellement un tapis, et l’oiseau empaillé, figé pour toujours dans cette posture. En dehors, le spectateur peut tourner autour de cette installation, mais ne sera qu’en un point précis en lien direct avec l’oiseau, et figé lui aussi face aux deux animaux. Le vivant et le mort se retrouvent ainsi entremêlés, donnant chacun à l’autre une épaisseur à l’œuvre. Il s’agit dès lors d’appréhender le temps en suspens, de ressentir l’enjeu de l’espace plastique comme espace créé et création d’espace.
Le travail plastique de Polly Morgan permet cette appréhension de l’œuvre, car en employant la taxidermie, l’artiste met directement en avant ce temps en suspens. Grâce à ses titres, elle donne au spectateur un indice qui lui servira de référence, et lui permettra d’entrer dans la narration. De même, en utilisant de petits animaux, au contraire de Damien Hirst, Polly Morgan n’est pas dans le registre du spectacle, de l’horreur, de l’effroi, mais elle invite le spectateur à prendre le temps de découvrir toute la préciosité et la fragilité de son travail.

Polly Morgan, sans titre, Boîte à bijoux en cristal, taxidermie de sittelle, 140mmx96mmx90mm, Mythologies, Galerie Haunch of Venison, Londres, 2009.
Pour l’exposition collective Mythologies organisée à la galerie Haunch of Venison de Londres en 2009, l’artiste a présenté une œuvre sans titre, pour laquelle un oiseau est à nouveau mis en scène sous verre, allongé dans un coffre à bijoux, transformé ainsi en un cercueil précieux.
Cette mise en scène évoque encore l’univers des contes tel que celui de la Belle au bois dormant ou Blanche-Neige, allongées endormies et attendant que leurs princes viennent les délivrer de leurs sorts. À nouveau, l’artiste choisit une symbolique explicite afin de permettre au spectateur de se défaire de l’image du cadavre scénographié. Au-delà de la personnification de l’animal, c’est tout le champ sémantique invoqué qui participe au glissement plastique. L’écrin sur lequel l’oiseau repose est délicat, et sa transparence joue, comme le faisait le miroir de Lovebird, sur l’intérieur et l’extérieur de l’installation, invitation au spectateur à participer à l’œuvre, à y rentrer, comme pour la cloche de verre qui était protection en même temps que révélation. Par ailleurs, il y a sur cette boîte une poignée, contrairement à la cloche en verre, qui induit la possibilité de l’ouvrir et de la fermer, et d’agir plus consciemment sur l’oiseau. Si pour Daniel Sibony :
L’œuvre est l’ensemble des limites que l’artiste a touchées, ou qui l’ont atteint. Limites de perception et de mémoire, de besoin et de désir, de déprime et de créativité, d’érotisme et de calcul. Autant d’évènements à incarner.6
L’œuvre donc, parait également être la perception et l’incarnation par le spectateur de ces mêmes limites. Aussi, en incluant cette ouverture dans son dispositif, Polly Morgan lui permet de ressentir l’expérience plastique, et de percevoir la possibilité de rentrer en tant qu’acteur dans la narration. La main, que ce soit celle de l’artiste ou celle imaginée du spectateur-acteur, induit le geste, et par là même la tactilité de l’œuvre, expérience intime de l’objet et du créateur. Cette approche tactile invite ainsi à une réception plus sensible de l’espace plastique, pour laquelle la mise à distance est moins prononcée que pour Lovebird. De plus, si pour la première œuvre les animaux renvoyaient à leurs propres morts, le temps en suspens est ici plus prononcé par le fait même de l’allusion au sommeil de la Belle au bois dormant et de Blanche-Neige, qui n’est pas non plus « naturel », mais bien sous le coup d’un sortilège, plus profond et dans l’attente d’un réveil provoqué par un tiers.
L’artiste serait-elle dès lors la sorcière qui aurait causé ce sommeil, et le spectateur l’élément qui viendrait l’interrompre ? Nous sommes avec cette question à nouveau emmenés sur le chemin de la narration, tout en ayant conscience que celle-ci sert à la mise en relief de l’espace plastique. En effet, si l’œuvre à travers ses références nous guide vers ce cheminement, elle permet également de souligner l’importance du rôle du spectateur dans la création même de son espace : il s’agit de la rencontre, du lien qui maintient la relation intime entre l’artiste, l’œuvre, et le spectateur à l’espace plastique, qui ne se résume pas aux contours et aux limites physiques de l’œuvre.
2. Le temps en suspens et l’action figée, se saisir des tropes

Polly Morgan, Still Life After Death, Photographie de Matthew Leighton, Chapeau haut de forme, lapin, peinture 2006.
Chez Polly Morgan, les titres et les mises en scène jouent donc sur plusieurs niveaux de lecture. Still life after death (Rabbit), œuvre de 2006, est un autre exemple de l’atmosphère particulière créée par l’artiste. Contrairement aux deux premières œuvres étudiées, aucune boîte ni cloche de verre ne participe à l’installation. Seuls un chapeau haut de forme noir, un lapin blanc recroquevillé sur lui-même, et un disque de peinture noire sont mis en scène. Notons ici que ce travail s’articule au sein d’une série Still life after death, qui présente à chaque œuvre un nouvel animal figé. Si en français, cette série s’intitulerait Nature morteaprès la mort, il est intéressant de noter que l’anglais emploie littéralement le terme de – vie figée –, alors que le français clôt l’expression en renvoyant directement à la mort de l’objet, à son immobilité définitive. Il serait intéressant de développer la question de la nature morte dans l’art contemporain, mais à défaut de temps, nous retiendrons avec cette œuvre la dualité du titre et de la mise en scène. En effet, l’action en suspens, ce chapeau qui flotte au-dessus du lapin allongé au sol renvoie davantage au terme anglais – vie figée – qu’à notre traduction française. De plus, en faisant clairement référence au chapeau du magicien et à son tour fétiche, Polly Morgan parvient à former une scène qui serait figée, « en cours de route ». La mise en scène et le saisissement photographique semblent ainsi interrompre le tour de magie, arrêté sur un accident de parcours. À nouveau, le spectateur est entrainé par la narration, à la recherche d’éléments qui viendraient donner corps à l’installation qui lui est offerte. L’action proposée, pourtant possiblement en plein rebondissement, se retrouve alors elle-même figée par le titre de l’œuvre, qui nous rappelle bien qu’elle se situe « après la mort », le tour de magie ne peut pas continuer. De même, nous ne sommes pas non plus dans la miniaturisation que les deux précédentes œuvres nous présentaient, mais bien dans des dimensions à taille humaine, le chapeau invoquant directement cette mise à l’échelle. Accessoire vestimentaire, celui-ci appelle l’image de la personne qui peut le porter. Si la présence humaine aurait clairement établit un contexte référentiel, l’absence permet de laisser le choix au spectateur dans la narration, elle ouvre le champ des possibles. En cela, Polly Morgan ancre non seulement sa démarche dans une volonté d’employer la taxidermie comme principal médium artistique, mais aussi comme une porte ouverte à l’espace plastique investi par le spectateur, saisi grâce aux différents tropes mis en scène. Le manquement est alors comblé par ceux-ci, et participe à l’épaisseur, au relief de l’espace plastique. Le lapin ainsi disposé sur le sol, au milieu du cercle de peinture noire, fond du chapeau, ombre de celui-ci, ou encore et peut-être symbolisation de l’aura de la mort, semble dessiner les contours du magicien, a priori responsable du drame. Ce ne serait plus dès-lors l’humain qui donne forme et arrange la peau animale – taxis derma –, mais bien l’animal qui dessine les contours de l’humain.
Avec l’œuvre Carnevale, réalisée en 2011, nous retrouvons cette mise en forme de la référence corporelle humaine par l’animal. Plusieurs merles y sont figés en plein vol, tenant chacun dans leurs pattes un ruban de couleur vive, enrubannant une silhouette fine, comme momifiée et statufiée, debout sur un socle. L’entrelacement des rubans ne laisse aucune allusion à une surface de peau visible, car celle-ci aurait sans doute notifiée trop clairement une possible vie, alors que le recouvrement total réfère à un état fixe définitif, et souligne une forme, suggère une figure qui reste invisible. De même, les rubans et leurs couleurs vives, ainsi que leur tressage à même la silhouette, et qui donne visuellement des losanges évoque le costume d’arlequin, personnage symbole du carnaval, répercutant ainsi lisiblement le titre dans l’œuvre et réciproquement. D’ailleurs étymologiquement, carnaval vient du latin – carne – la viande, et – levare – laisser, lever, et fait référence au carême où l’on s’abstient de viande. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Polly Morgan a choisi le mot italien et non anglais, comme si elle voulait en souligner l’étymologie. En effet, la viande, que l’on associe ici au corps humain donc, a été gommée à force d’être recouvert, laissée de côté au profit de la peau animale agencée. Ce paradoxe souligné, il devient alors intéressant de se questionner sur la mise en œuvre de l’installation par l’artiste, qui d’une part offre par le biais de la taxidermie l’illusion de la vie aux merles, et d’autre part a représenté le corps humain par son effacement, travail tout aussi méticuleux d’agencement d’un autre type de tissu non vivant, rubans patiemment tressés. La mise sur socle pose par ailleurs cette silhouette comme une réelle sculpture, non pas taillée dans un bloc de pierre, mais bien pensée par le textile, dans la mise en forme et en cernes de ses contours. Concernant les oiseaux, il n’y a ici rien à voir avec Les pensionnaires7 d’Annette Messager, réalisés en 1971 et pour lesquels l’artiste a fabriqué des tricots dont elle les a habillés. En effet, si Messager s’est appliquée à constituer une collection dans laquelle le temps est bel et bien arrêté, Polly Morgan nous entraîne définitivement par-delà les animaux morts. Le temps suspendu de la mise en scène, fait encore une fois participer le spectateur à l’œuvre, lui permettant de tourner autour de l’installation pour la comprendre, et réaliser que dans la narration engagée, ce sont bien les oiseaux qui dessinent le corps humain.
La peau, ainsi travaillée et envisagée, que ce soit par la taxidermie ou le tressage, animale ou humaine, appelle également à la surface et à la profondeur des corps. Avec Polly Morgan, nous avons vu que tout était mise en scène, le matériel plastique et son agencement narratif lui permettant de donner corps à son œuvre, de rentrer au cœur de l’espace plastique. L’intérieur des corps n’est pas montré, parce que justement il n’y en a pas, c’est du « faux », des « supports formés » pour accueillir la peau travaillée. Pourtant, cette surface symbole de l’intérieur et de l’extérieur, de la relation à l’autre, permet de donner corps et relief à l’espace plastique. Pour Michel Guérin il apparaît qu’en peinture la surface :
Accomplit une triple mission de réception : elle supporte l’inscription, elle distribue les places, elle sublime le plat et le plan (avec ses avant-plans et ses arrière-plans) et y creuse une profondeur. La surface récupère la profondeur, elle lui trouve une solution, l’interprète, la révèle en creux. 8
Avec le travail de Polly Morgan, il semble que la peau à la surface de l’œuvre permette encore plus de révéler la profondeur de son support. De même, en mettant en scène des références communes populaires par la taxidermie, l’artiste permet au spectateur d’aller plus loin dans son appréhension de l’œuvre, d’être interpellé, touché par ce qu’il regarde. Cette expérience ne paraîtrait pas envisageable si de multiples tropes n’étaient distillés par l’artiste, et elle pose le spectateur dans un contexte où il ne fait dès lors plus face à l’œuvre, à la surface de celle-ci, mais bien corps avec elle.
Notes
1 – Polly Morgan, Lovebird, technique mixte, 2005. Sans titre, boîte à bijoux en cristal, taxidermie de sittelle, 140mmx96mmx90mm, Mythologies, Galerie Haunch of Venison, Londres, 2009. Still life after death (rabbit) chapeau haut de forme, lapin, peinture, 2006. Carnevale, taxidermie de merles, rubans, 2011.
2 – Nous pensons aux œuvres de Damien Hirst tel que The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991, acier, verre, requin tigre, formol, 213x518cm, ou Mother and Child Divided, 1993, acier, GRP composites, verre, silicone, vache, veau, formol, 208.6 x 332.5 x 109cm (x 2), 113.6 x 169 x 62cm (x 2)
3 – Daniel Sibony, Création, Essai sur l’art contemporain, Seuil, 2005, page 94.
4 – Michel Guérin, L’Espace Plastique, La Part de l’Œil, Bruxelles, 2008, page 79.
5 – Ibid., page 102
6 – Daniel Sibony, Op. cit., page 80.
7 – Annette Messager, Les Pensionnaires, 1971-72.
8 – Michel Guérin, Op. cit., page 94.
Bibliographie
GUÉRIN Michel. L’Espace Plastique. Bruxelles : éditions La Part de l’Œil, coll. Théorie, 2008, 124p.
MESSAGER Annette. Les Pensionnaires. Éditions Dilecta, coll. Les Travaux de l’Atelier, 2007, 24p.
SIBONY Daniel. Création, Essai sur l’art contemporain. Seuil, coll. La Couleur des Idées, 2005, 298p.