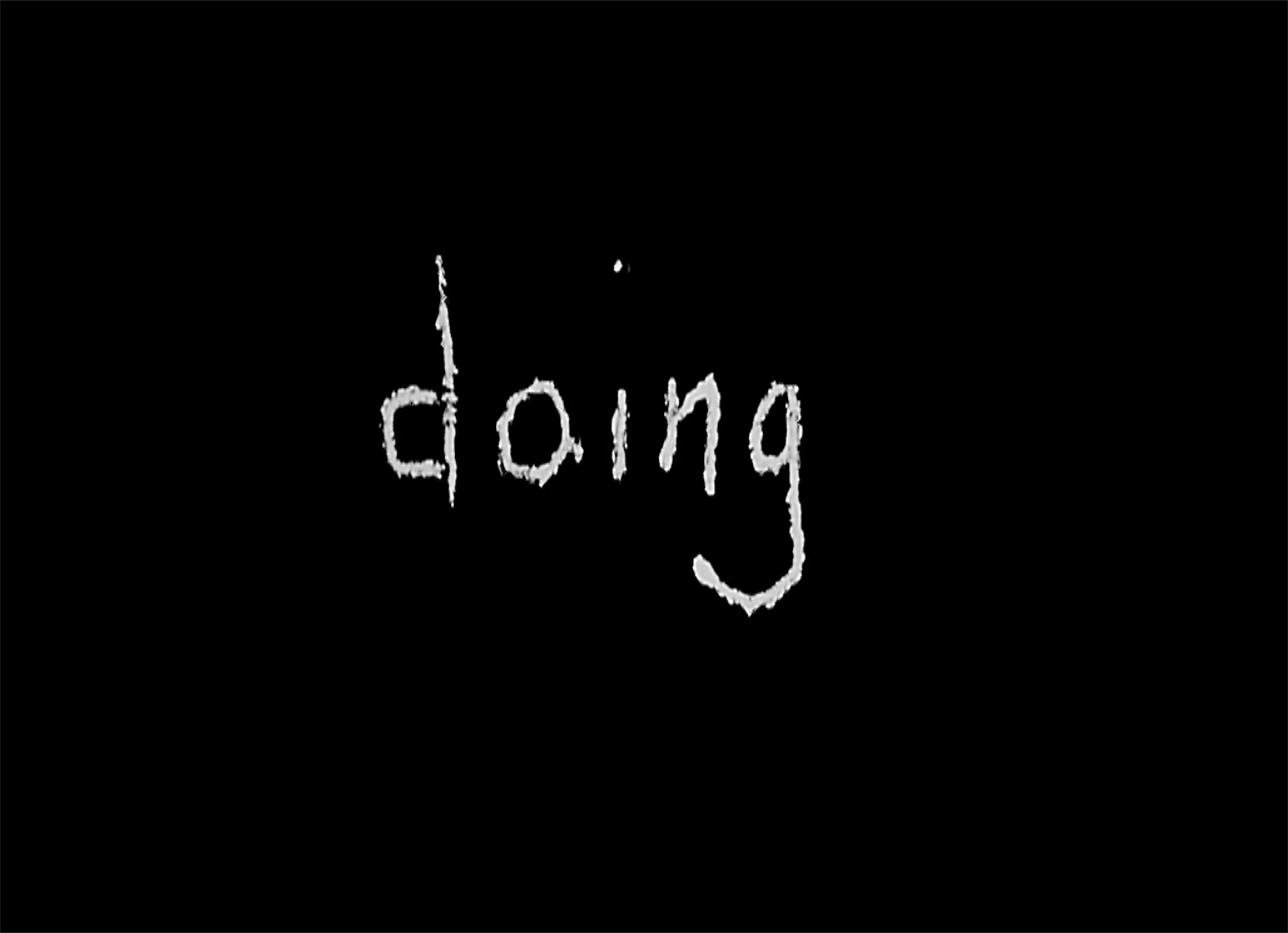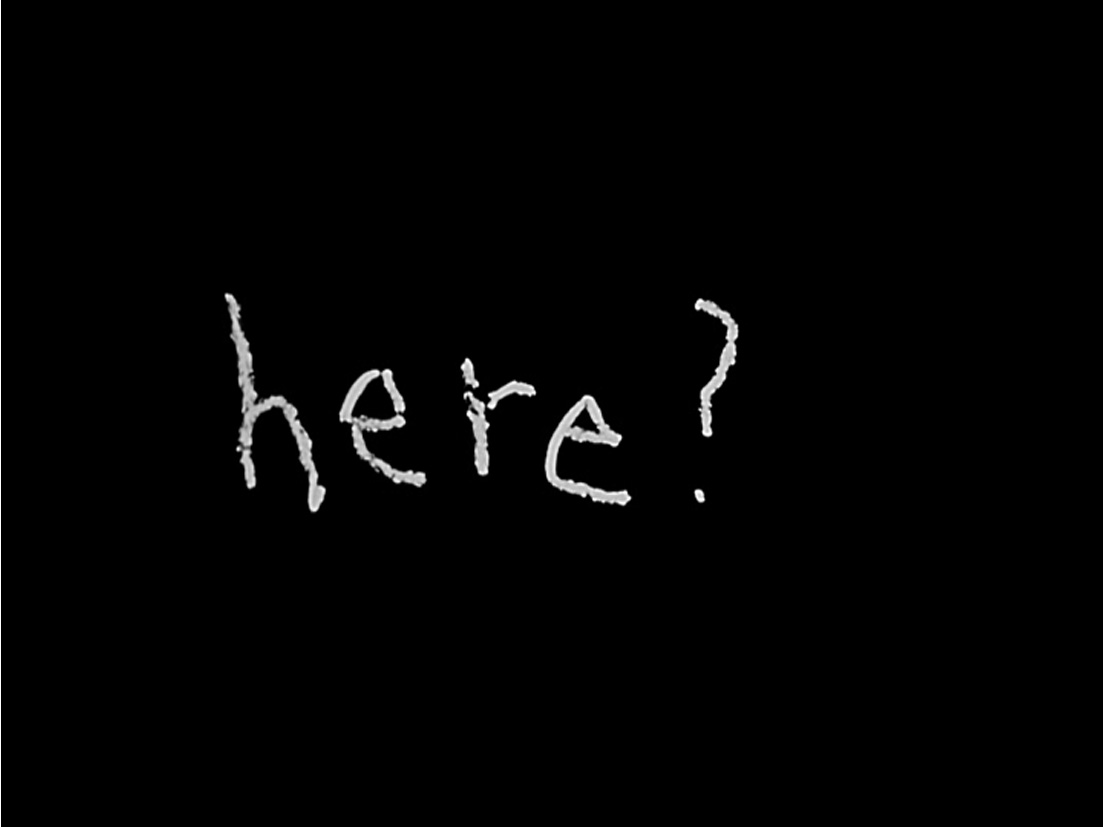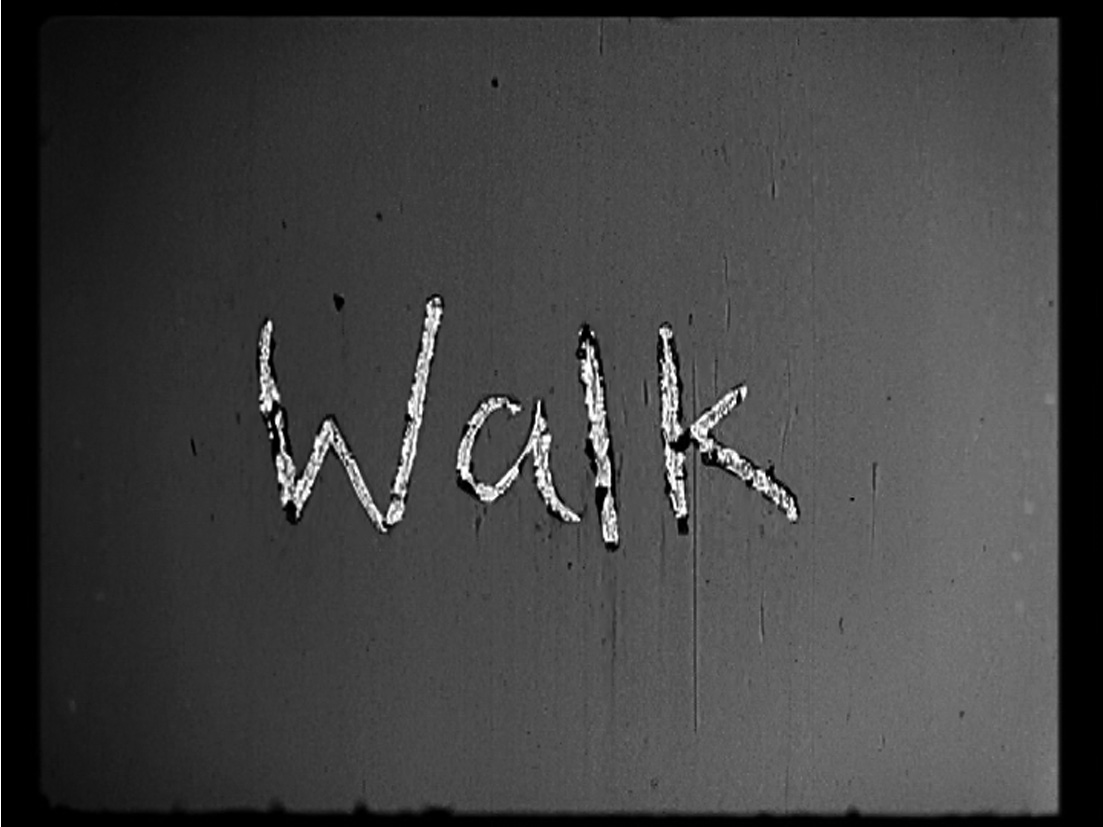Sophie CHADELLE
En septembre 2019, Sophie Chadelle a entrepris une thèse, en CDU au DEMA, intitulée « Voix de femmes, voix de fans, voix institutionnelles : La traduction du genre dans les séries contemporaines », au CAS, sous la direction de Nathalie Vincent-Arnaud (UT2J) et de David Roche (UT2J). Ses recherches portent notamment sur les études sur le genre, sur la traductologie et sur les études audiovisuelles.
sopchad@yahoo.fr
Pour citer cet article : Chadelle, Sophie, « Séries, sexualité féminine et traduction : une impossible reconquête du pouvoir ? », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°10 « Représentations du désir féminin : entre texte et image », été 2019, mis en ligne le 01/07/2019, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2019/05/21/series-sexualite-feminine-et-traduction-une-impossible-reconquete-du-pouvoir/>.
Télécharger l’article au format PDF
Résumé
Les séries Sex and the City(Star, HBO, 1999) et Ugly Betty (Horta, ABC, 2004) mettent en scène des figures féminines fortes et indépendantes assumant pleinement leurs corps et leurs sexualités. Ces portraits féminins semblent se détacher des représentations stéréotypées et sexistes du personnage féminin du cinéma classique, souvent érotisé et objectifié pour le plaisir du regard masculin. Or, ces séries sont produites en anglais et une étude de la traduction audiovisuelle (TAV) française, le sous-titrage et le doublage, montre dans quelle mesure la TAV réintroduit, par le biais de certains décalages entre le texte de la V.F. et celui de la V.O., une vision patriarcale et normée du corps de la femme, de sa sexualité et de son identité.
Mots-clés : Séries nord-américaines – Féminisme – Traduction – Langue – Politique culturelle
Abstract
The two series under study, Sex and the City and Ugly Betty stage a number of female characters who are both strong and independent, openly accepting their bodies. The portrayal of these feminine characters seems to go beyond stereotyped, sexist representations traditionally seen in feminine characters in the cinema where they are often objectified, eroticized for the mere pleasure of the male gaze.
Now these series were originally made in English and studies carried out of the French translation, both subtitling and dubbing, show just how far the TAV, through the existence of a number of discrepancies between the original text and the French translation, reintroduces a somewhat patriarchal vision of the sexuality and the female body and her identity.
Keywords : North American series – Women studies – Translation Studies – Linguistics – Cultural Studies
Sommaire
Introduction
1. Le rejet d’une vision patriarcale et objectifiante du corps de la femme
2. La sexualité et la corporalité féminine comme prise de pouvoir des héroïnes
3. Redéfinition du plaisir féminin : de la corporalité au pouvoir intellectuel
Conclusion
Notes
Bibliographie
Introduction
Il est difficile de remettre en question le langage visuel, les images mentales, clichés d’un cinéma fait par les hommes selon leurs visions, leurs fantasmes, leurs désirs et leurs normes. […] Le cinéma des femmes, la créativité des femmes, la vie des femmes… tout est à réinventer1.
C’est ce que souligne Agnès Varda dans La Création étouffée, confirmant ainsi ce que les chercheurs en études cinématographiques et audiovisuelles des années 1970 et 1980, comme Laura Mulvey, Kaja Silverman2 ou encore Teresa De Lauretis3, dénoncent : le milieu du cinéma, comme celui de la création audiovisuelle, jouerait un rôle important dans la perpétration d’une représentation de la féminité stéréotypée et limitée. Selon elles, l’identité de la femme, de son corps et de sa sexualité dans le cinéma classique seraient le reflet du désir masculin et de la norme dominante. Dans son article « Visual Pleasure and Narrative Cinema4 », Laura Mulvey dénonce une forme d’asymétrie dans le cinéma hollywoodien entre le personnage masculin doué d’agentivité et le personnage féminin qui devient objet de plaisir fétichiste et voyeuriste. En se référant au concept freudien de scopophillie, Mulvey affirme que la femme est alors représentée comme une image objectifiée, érotisée et passive. Ce regard masculin à trois dimensions, celui du personnage masculin, celui de la caméra et enfin celui du spectateur, limite ainsi le personnage féminin à un rôle passif dans la diégèse, dans la narration et dans la réception. Kaja Silverman dans son ouvrage The Acoustic Mirror va plus loin en abordant la question de la voix de la femme. Il existerait une différence nette entre la voix cinématographique féminine et la voix cinématographique masculine. La voix de la femme serait isolée de toute forme de productivité et de création car elle serait représentée dans de nombreux films du cinéma classique comme « dictée », comme dépourvue d’agentivité et surtout comme limitée au domaine du diégétique. Or, depuis les années 1970, les luttes pour les droits civiques et même la théorie féministe et queer ont largement influencé les fictions populaires contemporaines, selon les travaux de Laurie Ouelette5 et Joanne Hollows6. En particulier, certaines séries s’efforcent de représenter la femme comme active dans sa quête d’identité et de sexualité, s’éloignant ainsi de la représentation passive et stéréotypée de la femme comme simple objet de désir. De nombreuses œuvres audiovisuelles ont à cœur de mettre en scène une véritable discussion dialectique de voix féminines contradictoires et de ne pas seulement montrer l’image d’une femme indépendante. Iris Brey, dans son ouvrage Sex and the Series, souligne l’importance de mettre en mot la sexualité féminine :
Les séries ont beau montrer la sexualité des femmes, ce n’est pas pour autant qu’elles en parlent facilement. L’orgasme féminin, l’anatomie, du clitoris, la localisation du point G […] … la représentation de la sexualité féminine a été presque inexistante dans les médias. […] Or certaines séries se sont emparées de la sexualité et inventent une nouvelle langue, écrite ou visuelle, pour mettre enfin des mots sur l’un des plus grands mystères de la modernité. Le sexe féminin est protégé par des lèvres, pas étonnant, donc, que la sexualité féminine soit d’abord une question de langage7.
La parole et la mise en discours seraient donc des éléments centraux dans le processus d’émancipation. Cette prise de parole de la femme est d’autant plus active et libérée qu’il y a de plus en plus de créatrices et de productrices de séries, comme Jenji Kohan (Weeds, Orange is the New Black), Jane Campion (Top of the Lake) ou Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, Murder) qui sont reconnues autant par les critiques que par les audiences grâce à leurs œuvres télévisuelles qui mettent en scène des figures de femmes assumant et revendiquant leur identité et leur sexualité. La voix de la femme se libèrerait, selon Brey, du cadre du diégétique et du regard masculin et deviendrait source de création, répondant, donc, à l’appel lancé par Cixous exigeant que « la femme s’écrive8 ».
Les séries Sex and the City (Star, HBO, 1999) et Ugly Betty (Horta, ABC, 2004) sont des comédies qui jouent avec humour sur certains stéréotypes patriarcaux. Ce jeu sur les stéréotypes sexistes permet l’expression, par les images et par les mots, d’une sexualité et d’une corporalité féminine émancipée et émancipante. Ugly Betty, relatant l’évolution professionnelle au sein d’un magazine de mode d’une jeune fille latine au physique jugé disgracieux, met en scène avec humour les stéréotypes visuels et linguistiques d’une représentation normative de la beauté et du corps féminin afin d’en proposer une vision transgressive. Cette série se joue à la fois des images mais également des discours habituellement associés à la beauté féminine. La série Sex and the City, retraçant la vie sexuelle et amoureuse de quatre amies à Manhattan, met en images et en mots la sexualité et le désir de ces quatre jeunes femmes. Selon Kim Akass9et Iris Brey10, Sex and the City est une des premières séries qui ne se limite pas seulement à montrer la sexualité féminine mais s’efforce de la nommer explicitement lui donnant donc une existence. Il s’agit d’une série chorale puisque les quatre protagonistes principales ne cessent de débattre de certains aspects de leur sexualité et ce débat constant entre les quatre héroïnes permet d’installer une relation dialogique libératrice de la sexualité féminine. Dans ces deux séries, la représentation du corps de la femme et de sa sexualité est placée au cœur de la narration. Pour autant, les personnages féminins ne sont pas représentés comme la source passive du plaisir voyeuriste observé par le « male gaze » décrit par Mulvey. Au contraire, elles sont dépeintes comme assumant leur sexualité et leur corporalité, ce qui leur permet de reconquérir leur force d’action et leur identité. Cette reconquête s’effectue en plusieurs étapes : le rejet (explicite ou de manière détournée par l’ironie et l’humour) de la vision patriarcale du corps et de la sexualité féminine, l’affirmation de la sexualité et du corps de la femme comme nouvelle arme de pouvoir et enfin la redéfinition du plaisir féminin comme étant l’association d’une corporalité féminine et d’un pouvoir intellectuel émancipant. Dans ces deux séries, l’association de la corporalité de la femme à ses mots et à son pouvoir d’écriture devient une force émancipatrice. En effet, les deux héroïnes de ces séries sont toutes deux des figures d’auteures. Carrie Bradshaw, dans Sex and the City, est journaliste et ce sont les chroniques qu’elle écrit dans chaque épisode qui sont les moteurs de la narration. Betty Suarez est, dans Ugly Betty, secrétaire dont le seul but est de devenir écrivain. Betty doit accepter son corps et Carrie doit assumer sa sexualité afin que toutes deux puissent trouver l’écriture et ainsi compléter leur quête identitaire. Les mots ne sont donc pas seulement utilisés pour exprimer une sexualité féminine libérée des carcans cinématographiques et audiovisuels patriarcaux mais sont également la source d’une nouvelle forme de pouvoir pour les personnages féminins : le pouvoir créatif.
Cependant, les deux séries étudiées ici sont produites en langue anglaise. La réception de ces deux séries et de leur discours sur l’identité féminine, pour un public non-anglophone, dépend donc de leur adaptation linguistique, à savoir de leur traduction audiovisuelle (TAV) : le sous-titrage et le doublage. Les chercheuses en traductologie, Louise Von Flotow et Sherry Simon, dans leur ouvrage Translation and Gender : Translating in the Era of Feminism11, ont mis en avant la dimension politique de la traduction et le lien entre traduction et perpétration d’une politique patriarcale institutionnalisée. Ces deux traductologues mettent en avant le fait que la traduction ne doit plus être envisagée comme un simple transfert linguistique mais bel et bien comme une forme de pouvoir intellectuel. Elles mettent en avant le concept de « Cultural Turn », concept traductologique qui révolutionne la vision de la méthodologie de la traduction. La traduction doit être considérée dans un contexte et doit prendre en compte des concepts tels que la culture, l’identité, le genre, concepts complexes et difficilement définissables. L’acte de traduire ne doit plus être considéré comme la simple reproduction d’un original, une simple transposition linguistique, mais comme une véritable production culturelle. Il s’agit alors d’envisager les conséquences de l’acte de traduire et ainsi d’en comprendre sa dimension politique. La traduction devient le reflet, au même titre que l’acte d’écriture, des luttes de pouvoirs entre les violences normatives d’une culture ou d’une idéologie dominante et les voix marginalisées. La traduction peut alors être envisagée comme un acte d’émancipation mais également comme une forme de manipulation. Pour Christina Zwarg, la traduction devient le reflet des crises idéologiques que traversent nos sociétés et nos civilisations : « translation has increasingly become the vehicle through which history, meaning and language come to crisis12 » . C’est dans cette perspective que, dans leur ouvrage, Von Flotow et Simon affirment que la traduction, au même titre que la langue, joue un rôle essentiel dans la représentation de la femme dans nos sociétés. Elles illustrent cette théorie en donnant de nombreux exemples d’ouvrages dont les thèses féministes ont été trahies dans le processus de traduction. Un de ces exemples est la traduction en anglais américain du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C’est en 1952 que la maison d’édition BantamBooks publie la version en langue anglaise de cette œuvre, sous le titre The Second Sex, traduite par Howard Parshley, œuvre qui connaît un succès important dès sa parution. Les rééditions ont été nombreuses au cours des décennies suivantes mais l’œuvre ne sera jamais retraduite et c’est la traduction de 1952 de Parshley qui reste la version américaine officielle. Or, certains chercheurs féministes, comme Margaret Simons13, se sont aperçus que la traduction de Parshley est par moment très libre et change ou même passe sous silence certains passages. Ainsi, dans la version américaine du Deuxième sexe, plus de dix pourcent du texte original a été omis sans que cela n’ait été signalé ni par le traducteur, ni par la maison d’édition. Les passages qui ont été coupés concernent essentiellement l’historiographie féminine (le nom de soixante-dix-huit femmes a été enlevé : des femmes politiques, des chefs militaires, des courtisanes, des saintes, des artistes et des poètes), certains événements historiques qui remettent en questions certains clichés sur l’identité féminine, comme l’existence, dans la Renaissance de femmes nobles à la tête d’armées, la plupart des références à des tabous culturels telles que les relations homosexuelles féminines etc. Simons, qui a comparé les deux versions du Deuxième sexe, affirme ainsi :
He [Parshley] didn’t care to have discussions of women’s oppression belaboured, although he was quite content to let Beauvoir go on at length about the superior advantages of man’s situation and achievements14.
La traduction défectueuse de cette œuvre de référence féministe, selon Von Flotow et Simon, pourrait expliquer en partie quelques critiques américaines à l’égard de Beauvoir qui estiment que cette dernière reste trop modérée en ce qui concerne la revendication d’une sexualité féminine libérée. Ainsi, Barbara Klaw affirme que Beauvoir reproduit même certains stéréotypes patriarcaux en ce domaine : « [Beauvoir is] perpetuating patriarchal stereotypes of female sexuality15 ». L’exemple de la traduction du Deuxième sexe met en lumière un lien qui à l’époque n’était que peu connu : le genre, l’écriture et la traduction.
L’exemple de la traduction de Beauvoir nous amène donc à nous demander si la TAV des séries étudiées ici n’impacte pas les discours d’émancipation à propos de l’identité de la femme. N’existe-t-il pas des décalages ou même des omissions qui ne relèveraient pas de la simple faute linguistique ou d’orthographe mais qui possèderaient une réelle dimension politique en termes de genre ? Dans quelle mesure ces décalages auraient-ils un impact sur notre compréhension de la représentation, dans ces deux séries, du corps et de la sexualité de la femme ? Le mot et le discours sont au cœur de l’émancipation identitaire des personnages féminins, il semble donc vital de se pencher sur l’adaptation des termes originaux dans une autre langue. Les éventuelles différences entre les deux médiums (l’écran et la TAV) par lesquels passe le discours, créeraient ainsi un gouffre passant sous silence certains aspects de la reconquête du pouvoir par les personnages féminins de ces deux séries. La TAV pourrait-elle être alors considérée comme une déclinaison de la langue patriarcale dénoncée par de nombreuses féministes, comme Cixous, Irigaray et Kristeva, et du langage patriarcal cinématographique dénoncé par Varda (« le langage visuel, les images mentales, clichés d’un cinéma fait par les hommes selon leurs visions ») ? Pour y répondre, il s’agira donc de considérer, dans l’analyse de la TAV de ces deux séries, les passages portant sur les différences étapes de reconquête du pouvoir (le rejet de la vision patriarcale du corps et de la sexualité féminine, l’affirmation de la sexualité et du corps de la femme comme nouvelle arme de pouvoir et enfin la redéfinition du plaisir féminin comme étant l’association d’une corporalité féminine et d’un pouvoir intellectuel émancipant).
Dans le cas des adaptations françaises de ces séries, que cela soit le sous-titrage ou le doublage, comme dans tout acte de traduction en général, il existe une double situation de communication. L’énonciateur est double puisqu’il y a l’énonciateur de la version source et l’énonciateur-traducteur de la version cible. L’interlocuteur est également double puisqu’il existe le public de la version originale, ici le public anglophone, et le public de la version adaptée, le public francophone. Cela suppose que la situation d’énonciation soit également dédoublée, entraînant ainsi la superposition de deux réalités culturelles bien distinctes. Enfin, le signifiant et le signifié en anglais sont associés à un signifiant et un signifié français. Le message délivré est donc complexe, créant un nécessaire décalage dans l’acte de communication. C’est dans ce décalage que réside la dimension politique qui nous intéresse : la réinstallation de certains stéréotypes patriarcaux par le biais de la TAV. Comme le suggère le concept de « Cutural Turn », il est vital d’interroger le contexte dans lequel s’opère la traduction. Il s’agit tout d’abord de mesurer le contexte de production de la TAV. La TAV est une forme de traduction très technique puisqu’il s’agit de respecter un certain nombre de contraintes pour permettre au spectateur de suivre au mieux l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Le doublage doit respecter des contraintes de temps et doit correspondre aux mouvements des lèvres des acteurs. Les sous-titres doivent également respecter les contraintes de temps mais doivent aussi condenser les dialogues car un sous-titre ne peut dépasser trente-trois caractères. Ces contraintes techniques ont évidemment un impact sur le choix du traducteur et donc sur sa dimension politique mais elles ne sont pas les seules raisons expliquant certains décalages entre la version source et la version cible. Si l’on cherche à étudier la dimension genrée de la TAV, il s’agit alors de se détacher de ces aspects techniques afin de se concentrer davantage sur d’autres décalages, davantage culturels et politiques que linguistiques ou techniques. En effet, selon Jorge Diaz Cintas dans son article « Clearing the Smoke to See the Screen : Ideological Manipulation in Audiovisual Translation16 », il est important de comprendre que la TAV s’inscrit dans un contexte économique : celui du marché de la culture, de ses luttes de forces et de sa hiérarchie. Selon Diaz Cintas, avec le développement du genre sériel et de ses moyens de diffusion, la consommation de séries en téléchargement illégal ou en streaming a bouleversé la production normée de la TAV. Le discours issu de la production officielle de la TAV est depuis une décennie soumis aux normes du marché libéral et de la production de masse de la culture ainsi qu’à la nécessité d’adapter le discours sériel au plus grand nombre. Le but commercial est évidemment de faire le plus d’audience possible. C’est justement par le biais de cette politique de l’adaptation commerciale que la TAV révèlerait, toujours selon Diaz Cintas, certaines luttes de pouvoir idéologiques comme la question du genre. La question de la représentation francophone de l’identité de la femme dépasse donc le cadre de la création textuelle ou de l’image puisqu’elle s’inscrit dans une démarche culturelle commerciale. Il s’agit également de la faire correspondre à une politique de réception et de lecture télévisuelle.
Dans cette analyse, les exemples de la TAV des dvds français des deux séries à l’étude (DVD Company Buena Vista Home) ont été classés selon les étapes de la reconquête du pouvoir (définis et cités au préalable) par les personnages féminins des œuvres à l’étude. Ces éléments de la TAV pris individuellement n’ont que peu d’impact en termes de politique genrée. Mais en les comparant et en les mettant en relation les uns avec les autres, nous avons constaté que des schémas se mettent en place, détruisant ainsi, pour certains passages, la vision émancipée du corps de la femme et de sa sexualité. C’est une analyse qui s’appuie sur les travaux d’Anne-Lise Feral 17sur la série Sex and the City et sur mes propres analyses de la TAV d’Ugly Betty. Le principe était le suivant : relever tous les décalages entre la V.O. et la V.F. n’ayant aucun rapport avec des erreurs linguistiques ou des choix techniques. Il s’agissait de relever des décalages entre la V.O. et la V.F. sur des expressions :
– rejetant une vision patriarcale du corps de la femme ;
– revendiquant la prise de pouvoir des femmes par leur sexualité, leur corps et leur féminité ;
– redéfinissant le vrai plaisir féminin comme l’association de la corporalité de la femme et de son pouvoir intellectuel, et notamment de sa capacité à écrire.
Certains exemples de décalages entre la V.O. et la TAV sur ces thèmes démontrent la dimension politique de certaines parties de la TAV, altérant ainsi la mise en scène émancipatrice du corps et de la sexualité de la femme dans ces deux œuvres télévisuelles. En voici quelques exemples.
1. Le rejet d’une vision patriarcale et objectifiante du corps de la femme
Item 1 : Sex and the City (E01, S01)
| Original | TAV |
|
Miranda: The advantages given to models and to beautiful women in general are so unfair, it makes me want to puke! . . . We should just admit that we live in a culture that promotes impossible standards of beauty.
Carrie: Yeah, except men think they’re possible.
Miranda: Yeah.
|
DOUBLAGE (D) :
Miranda: Les avantages qui sont donnés aux mannequins et aussi aux belles femmes me dépassent tellement que je voudrais tout de suite être encore plus bête et plus moche! . . . Nous devrions juste admettre que nous vivons dans un monde où personne ne peut instaurer un nouveau standard de beauté. Carrie: Oui, nous n’avons pas à nous juger les unes les autres.
Miranda: Oui. |
Lors de cette discussion, les quatre héroïnes discutent des normes de beauté imposées par les magazines de mode. Le premier décalage souligné met en avant le fait que la V.O. dénonce l’injustice d’une société qui accorde des privilèges aux belles femmes tandis que la V.F. introduit une remarque sur le physique et l’intelligence de Miranda. Non seulement la notion d’injustice (à propos de l’existence d’une beauté normée) disparaît dans la V.F., mais la TAV sous-entend également que Miranda est complètement dépassée alors que celle-ci revendique une forme de prise de pouvoir en rejetant ce fait (« me dépassent »). Nous passons donc d’une forme d’agentivité de la femme (par son refus) à une forme de passivité dans la V.F. De plus, la notion de dégoût (« puke » veut dire vomir) pour ces normes de beauté a disparu dans la V.F. Enfin, la traduction de la réplique de Carrie efface la révolte du personnage envers le comportement des hommes qui justement permet l’installation de ces normes de beauté. La V.F. suggère que ce sont les femmes qui se jugent les unes les autres et qui sont donc les responsables. Cet item met donc bien en valeur que la représentation les femmes rejetant les normes de beauté est remise en question dans la version française.
Item 2 : Sex and the City(E01, S01)
| Original | TAV |
| Miranda : I find it fascinating that four beautiful flesh and blood women could be intimidated by some unreal fantasy. I mean, look at this [she shows an issue of Glamour]. Is this really intimidating for any of you?
Voice over : Suddenly I was interested. If models could cause otherwise rational individuals to crumble in their presence, exactly how powerful was beauty ? |
DOUBLAGE (D) :
Miranda : Je trouve ça fascinant que quatre merveilleuses filles soient attirées voire intimidées par ces filles plastifiées de partout. Ça doit être plutôt désagréable. Regardez-ça. Est-ce que ça vous fascine vraiment ?
Voice over : Soudain je me suis sentie intéressée. Si les mannequins pouvaient changer le comportement d’une femme, du moins l’influencer, quel était donc le pouvoir réel de la beauté ?
|
Dans cet item, le premier décalage repéré est la traduction de l’expression « beautiful flesh and blood women » par « quatre merveilleuses filles ». Il s’agit de la même discussion que pour l’item précédent. Miranda fait alors l’apologie de la beauté « normale » de ses amies. Cette revendication disparaît dans la V.F. puisque l’allusion à la beauté des quatre amies disparaît. La dimension charnelle des personnages est donc niée par la disparition de l’idée de « chair » et de « sang ». Notons également que le terme « women » est traduit par le terme « filles » alors qu’il aurait dû être traduit, dans un souci de fidélité, par « femmes » puisque « fille » est l’équivalent français du terme anglais « girls ». Le terme « femme » suggère davantage de maturité et sa dégradation au rang de « fille » est révélatrice d’une certaine diminution du pouvoir féminin. Le deuxième décalage relevé ici est la traduction de l’expression « unreal fantasy » par « ces filles plastifiées de partout ». Le doublage supprime l’idée que ces normes de beauté ne sont pas réelles, ce qui constitue l’argument principal de la critique de Miranda de ces normes de beauté. L’expression française suppose qu’il s’agit de quelque chose qui n’est pas naturel. Enfin, le dernier décalage intéressant à analyser concerne la traduction française de l’expression « rational individuals ». La V.F. donne un genre aux personnes désignées par Miranda alors que cette dernière tente justement de ne pas féminiser les personnes concernées par ce phénomène de fascination puisqu’elle sous-entend un peu plus loin dans le dialogue que les hommes en sont également victimes. La V.F féminise le processus. De plus, le terme « rational » est omis dans la V.F., ce qui diminue justement les capacités intellectuelles de ces femmes.
L’analyse de la TAV de ces deux items souligne donc dans quelle mesure certains choix de traduction remettent en question la volonté des personnages féminins de cette série de dénoncer une vision patriarcale et normée de leurs corps et de la beauté féminine en général. Il ne s’agit pas de contre-sens mais de quelques omissions et d’adaptations qui atténuent fortement la démarche militante de Miranda. Ces décalages contribuent ainsi à la réécriture du discours de la série et inscrit donc la TAV de cette œuvre dans une dimension politique genrée.
2. La sexualité et la corporalité féminine comme prise de pouvoir des héroïnes
Item 3 : Sex and the City (E03, S01)
| Original | TAV |
|
Samantha : Plus the sense of power is such a turn on, maybe you’re on your knees, but you’ve got him by the balls. Charlotte : Now, you see, that is the reason I don’t want to go down this road.
|
D : Samantha : Et en plus, tu as un pouvoir sur eux très excitant. Tu es peut-être à genoux mais tu les tiens par les couilles. Charlotte : Je ne suis pas féministe et je n’ai aucune envie de faire ce que vous dites, aucune!
|
|
SOUS-TITRAGE (S) : Samantha: Et le sentiment de pouvoir est excitant. T’es à genoux mais tu le tiens par les couilles. Charlotte : C’est la raison pour laquelle je ne veux pas m’y aventurer.
|
Dans cet épisode, Samantha revendique une sexualité libérée et argumente que la fellation représente une forme de prise de pouvoir pour la femme. Charlotte, en revanche, dans le doublage estime que cet acte sexuel est dégradant pour la femme. Et pourtant la raison avancée est qu’elle n’est pas féministe. Le terme féministe, surtout dans une série comme Sex and the City, n’est pas utilisé à la légère. La série représente justement les nombreuses facettes des divers féminismes, qui sont associées à l’idée de pouvoir. Le doublage, lui, oppose sexualité et féminisme et suggère que le féminisme est l’équivalent d’un acte dégradant.
Item 4 : Ugly Betty (E02, S01)
| Original | TAV |
|
Journalist : Someone should tell to that woman, wearing a young man on your arm doesn’t always cover the jiggle parts. |
D : Il serait temps d’expliquer à cette femme que se montrer au bras d’un jeune homme fait paraître ses rides plus flagrantes
|
|
S : Quelqu’un devrait expliquer à cette femme que porter un jeune homme à son bras ne cache pas les chairs molles.
|
Dans cet épisode, une journaliste se moque d’une des personnages féminins de la série, Wilhelmina, la directrice artistique du magazine pour lequel travaille Betty. Wilhelmina est dépeinte comme mangeuse d’hommes et revendique une sexualité libérée et dominatrice, comme le suggère la journaliste. En effet, selon cette dernière, Wilhelmina porte sa nouvelle conquête comme un vêtement ou un bijou. Dans cet item, un changement de point de vue s’opère en partie dans le doublage par un chassé-croisé réorganisant les éléments de la phrase anglaise. Le résultat de ce chassé-croisé implique que Wilhelmina n’est plus celle qui domine dans la relation puisqu’elle ne porte plus l’homme mais se retrouve à son bras. Elle passe d’une figure active et dominatrice qui objectifie l’homme avec qui elle sort à une figure passive et ornementale. Dans ce cas, nous avons encore une atténuation du discours original revendiquant la sexualité féminine comme une forme de prise de pouvoir.
Item 5: Ugly Betty (E02, S01)
| Original | TAV | |
| Betty : I work in an office full of Glamazone women |
|
|
|
S : Je travaille dans un bureau plein de femmes sophistiquées qui font toutes 1m80 et sont parfaitement épilées |
Dans la V.O., Betty procède à un néologisme qui associe à la fois l’élégance physique des femmes avec qui elle travaille et l’image de guerrière. Elle utilise cette expression lors d’une conversation avec son père au cours de laquelle elle évoque son admiration pour ces femmes qui cumulent beauté, pouvoir et férocité. Ici, la notion de beauté est associée à celle de guerrière et donc de pouvoir, association illustrant le discours de la série qui tente de redéfinir la notion de beauté féminine et d’échapper au carcan patriarcal alliant beauté féminine et fragilité. Or, le sous-titrage fait disparaître la dimension guerrière, changeant ainsi la portée féministe du néologisme.
Ces trois items mettent en valeur les décalages entre la V.O. et la V.F. qui atténuent fortement la dimension de pouvoir de la corporalité et de la sexualité féminine. La prise de pouvoir des personnages féminins de ces deux séries par leur sexualité ou leurs corps est donc, dans ces exemples, fortement remise en question.
3. Redéfinition du plaisir féminin : de la corporalité au pouvoir intellectuel
Les deux séries mettent en avant le fait que leurs personnages féminins doivent apprendre à accepter leurs corps hors norme (dans le cas de Betty) et à vivre une sexualité émancipée et libérée (dans le cas des protagonistes de Sex and the City) afin de poursuivre une quête identitaire les menant vers le vrai plaisir émancipateur : le pouvoir intellectuel et surtout l’écriture. Les deux héroïnes des deux séries sont des auteures et les références aux figures féminines intellectuelles ou des références à des personnalités féminines qui écrivent sont nombreuses dans la série. Pourtant, la TAV propose parfois une traduction inadéquate, atténuant voire supprimant ces références et leur pouvoir d’évocation et d’inspiration.
Item 6: Ugly Betty (E07, S01)
| Original | TAV |
|
Candace Bushnell wants to pitch a story on power women in Manhattan. |
S : CB veut écrire sur les femmes influentes de Manhattan |
|
D : CB veut te parler de son prochain livre sur les femmes à Manhattan |
Dans cet exemple Sofia Reyes, journaliste féministe s’adresse à son équipe de rédaction, entièrement constituée de journalistes femmes et leur présente un nouveau projet pour leur magazine féministe. Ce qui nous intéresse ici est la traduction de l’expression « power women ». Dans le doublage, l’idée de pouvoir (“power”) disparaît complètement. Il ne s’agit plus que d’un livre sur les femmes à Manhattan. L’omission de l’idée de pouvoir peut passer inaperçue ou anodine et pourtant cela contribue à diminuer les capacités intellectuelles associées aux femmes fortes ou aux figures féministes. L’exemple n’est pas isolé et c’est la répétition de ce genre de décalages et d’omissions qui contribue au changement de perspective par rapport au discours féministe de la série.
Item 7: Ugly Betty (E07, S01)
| Original | TAV |
|
5 years ago he wrote for an airline magazine, now he’s Katie Couric
|
S : Il y a cinq ans il écrivait pour une ligne aérienne et il se prend pour Katie Couric |
|
D : Formidable, il y a cinq ans il écrivait dans la revue d’une compagnie aérienne et aujourd’hui c’est Mr Pullizer |
Dans cet épisode, Daniel, le rédacteur en chef de Modeet patron de Betty, lui parle d’un photographe célèbre. Le nom de Katie Couric, première femme journaliste américaine de télévision à devenir très célèbre est remplacé, dans le doublage, par « Mr Pullizer ». La référence à cette figure intellectuelle de femme est masculinisée par le doublage alors que l’on aurait pu penser à un équivalent français, comme « Claire Chazal » par exemple.
Item 8: Ugly Betty (E07, S01)
| Original | TAV |
| Seems like generic chick lit to me
|
S : Ça semble de la littérature de nana |
|
D : Je pensais que c’était des trucs sans intérêt, des trucs de nana |
Dans cet épisode, Daniel fait référence à un genre littéraire considéré comme féminin. Si la V.O. suggère un certain mépris pour ce genre, le doublage, lui, supprime complètement la dimension littéraire et associe le « truc sans intérêt » à la notion de féminité alors que la V.O. associe, malgré l’aspect péjoratif, l’image de la femme à la littérature (« litt ») et à l’écriture.
Item 9: Sex and the City (E01, S01)
| Original | TAV |
| Tina Brown
Diana Sawyer |
S : Tina Brown
Diana Sawyer |
| D : Tina Turner
Naomi Campbell |
Dans cet épisode, Carrie fait références aux figures féminines intellectuelles influentes de Manhattan. Étant, journaliste elle-même, elle se réfère à deux grandes figures féminines du journalisme américain. Tina Brown était la rédactrice en chef du New Yorker en 1998. Diana Sawyer, elle, était une grande journaliste télévisée des années 1980 et 1990. Or, le doublage français adapte ces références par les noms d’une chanteuse et d’un mannequin, certes des personnalités publiques artistiques fortes mais tout de même différentes des femmes journalistes et auteures évoquées (une est d’ailleurs un mannequin, incarnation de la beauté normée dénoncée par Miranda dans le même épisode). La figure féminine auctoriale disparaît donc.
Ces quatre items illustrent dans quelle mesure la TAV dissocie, dans certains cas, la figure féminine de la figure auctoriale. Pourtant, l’acte d’écrire est présenté dans Ugly Betty et dans Sex and the City, comme la vraie source d’émancipation des deux héroïnes. Leurs sexualités et leurs corps de femmes, associés à leurs écritures et leurs capacités intellectuelles deviennent la clé de leurs quêtes identitaires. Or, à de nombreuses reprises, la TAV incomplète, inexacte ou trop libre, remet en question cette thèse.
Les quelques exemples donnés ici montrent dans quelle mesure la traduction audiovisuelle des discours originaux de ces deux œuvres audiovisuelles peut acquérir, dans certains cas, une dimension politique en ce qui concerne le genre. Les décalages entre la V.O. et la V.F. ne sont ici pas dus à des erreurs purement linguistiques ni à des contraintes techniques. Il s’agit bel et bien d’un choix de traduction. Ces exemples soulignent également une différence entre le sous-titrage et le doublage. La traduction du doublage suggère davantage de prise de distance par rapport au texte source tandis que le sous-titrage, sans doute à cause de la contrainte d’espace, propose une traduction plus littérale. Il s’agit de la traditionnelle différence traductologique entre la traduction dite « directe » et la traduction « oblique18». Le concept de « traduction directe », selon Hardin et Picot, suggère que la traduction n’est utilisée que comme un simple outil dans le processus de communication. En revanche, la « traduction oblique », dont le doublage se rapproche le plus, devient une forme de création et place au centre du processus de communication le choix du traducteur. La prise de distance du doublage, de manière générale, suggère qu’il s’agit davantage d’une adaptation que d’une simple transposition linguistique. Le but est à la fois de traduire le texte source, de respecter les contraintes techniques et d’adapter ce qui est dit ainsi que les références culturelles afin que le public cible puisse s’approprier le mieux possible le texte source. Dans le cas du sous-titrage, de nombreuses références culturelles ne sont pas adaptées mais traduites littéralement. Ainsi, des références à des figures culturelles et influentes comme Katie Couric et Candace Bushnell, dans Ugly Betty, ou Tina Brown et Diana Sawyer, dans Sex and the City, certes sont gardées, mais ne sont pas forcément reconnues par un public francophone.
Qu’il s’agisse d’une forme de censure ou simplement d’une question de non-compréhension culturelle, la représentation de l’identité féminine dans ces deux séries est double et un décalage est ainsi créé, dans certains cas, entre sa représentation à l’écran et sa représentation dans la traduction française. Jorge Diaz Cintaz dans « Clearing the Smoke to See the Screen : Ideological Manipulation in Audiovisual Translation » souligne la difficulté de traduire certains thèmes :
Audiovisual media and its translation play a special role in the articulation of cultural concepts such as femininity, masculinity, race and Otherness, among others. It can contribute greatly to perpetuating certain racial stereotypes, framing ethnic and gender prejudices and presenting viewers with out-dated role models and concepts of good and bad19.
Ainsi, la notion d’altérité, que cela soit la représentation du féminin ou des réalités intellectuelles et culturelles d’une autre civilisation, reste difficile à adapter d’une société à une autre. La traduction peut devenir une forme de ventriloquisme culturel ou même une forme de censure de la voix féminine. Au-delà de la question de la représentation, il s’agit de questionner la phase de réception, comme le rappelle Francesca Billiani :
Communication media in general, and above all mass media, address a rather large and socially diverse audience, which, more so than in the case of literary texts, needs to be kept under control and organized in its tastes and opinions by a visible, and invisible, censorial power20.
La traduction semble refléter, dans les cas étudiés, cette relativité et la difficulté d’adapter et de comprendre ces questions identitaires. Mais il ne faut pas non plus négliger la dimension commerciale du marché des séries, comme le suggère Diaz Cintas dans son article « Clearing the Smoke to See the Screen : Ideological Manipulation in Audiovisual Translation ». Ainsi, l’adaptation linguistique pourrait également être considérée comme une arme commerciale dont le but serait de rentabiliser l’adaptation de ces séries. La question de la rentabilité est donc essentielle dans la création de ces œuvres et évidemment dans leur adaptation. Il est pourtant difficile d’établir un lien direct entre la politique genrée de certains éléments de la TAV et les exigences de rentabilité du marché libéral de la culture. Une chose est certaine : la représentation à l’écran de la sexualité et du corps de la femme, utilisée comme arme de reconquête du pouvoir identitaire vers une émancipation intellectuelle, reste donc théorique et de l’ordre de la fiction puisque sa mise en pratique par le biais de la TAV reste encore lacunaire, du moins en partie.
Conclusion
Pour pallier cette difficulté à mettre en pratique les discours féministes de certaines œuvres artistiques lorsqu’il s’agit de les adapter à des publics étrangers, Louise Von Flotow, dans la conclusion de son ouvrage Translating in the Era of Feminism, rappelle l’importance vitale d’envisager toute forme de traduction comme une production culturelle et politique s’inscrivant dans un contexte au sein duquel des luttes idéologiques sont en jeu. L’aspect militant de l’acte de traduire ne doit pas quitter la conscience du traducteur, selon elle. La vigilance doit être de mise. Il nous semble tout même juste de rappeler l’importance vitale qu’a eue, et continue de jouer, la traduction dans la compréhension de thématiques féministes américaines, anglophones ou issues d’autres cultures, et dans l’acquisition d’une conscience et d’une compréhension commune et internationale des combats en termes de genre. La traduction a permis la diffusion plus large des voix féminines, que cela soit par les textes ou par les images, leur permettant ainsi de s’affranchir des frontières culturelles et de s’émanciper à une plus large échelle. La TAV n’est pas en reste dans ce processus d’émancipation puisqu’il s’agit d’un moyen de communication de plus en plus utilisé dans la sphère médiatique, et permettant une meilleure compréhension de l’Autre (longtemps associé à la féminité), mais également de la notion de relativité et de pluralité culturelle, comme le souligne Rubi Rich :
Subtitling allows us to hear other people’s voices intact and gives us full access to their subjectivity. Subtitles acknowledge that our language, the language of this place in which we are watching this film, is only one of many languages in the world, and that at that very moment, elsewhere they are watching movies in which characters speak in English while other languages spell out their thoughts and emotions across the bottom of the frame for other audiences. It gives me hope . . . Subtitles, I’d like to think, are a token of peace21.
Notes
1 HORER, Suzanne et Jeanne SOCQUET. La Création étouffée. Paris : édition Pierre Horay, 1973.
2 SILVERMAN, Kaja. The Acoustic Mirror. Bloomington and Indianapolis : Indiana University Press, 1988.
3 DE LAURETIS, Teresa. Technologies of Gender. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
4 MULVEY, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. Film Theory and Criticism : Introductory Readings. New York : Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford UP, 1999, p. 833-844.
5 OUELETTE, Laurie. Victims No More : Television, Postfeminism and Ally McBeal. The Communication Review. Vol. 5, N° 4, 2002, p. 312-323.
6 HOLLOWS, Joanne. Feminism, Femininity and Popular Culture. Oxford : Manchester University Press, 2000.
7 BREY, Iris. Sex and the Series. Mionnay : Libellus Editions, 2016, p. 36.
8 CIXOUS, Hélène. Le Rire de la méduse. Paris : Galilée, « Lignes fictives », 2010.
9 AKASS, Kim et Janet MCCABE. Reading Sex and the City. Londres : IB Tauris, 2004.
10 BREY, Iris. Sex and the Series. 2016.
11 VON FLOTOW, Louise. Translation and Gender : Translating in the Era of Feminism. Ottawa : University of Ottawa Press, 1997.
12 ZWARG, Christina. Feminism in Translation : Margaret Fuller’s Tasso. Studies in Romanticism. Boston : Boston University, 1990, p. 463-90.
13 SIMONS, Margaret. The Silencing of Simone de Beauvoir. Guess What’s Missing from the Second Sex, Women’s Studies International Forum. Vol. 6, 1983, p. 559-564.
14 SIMONS, Margaret. The Silencing of Simone de Beauvoir. 1983, p. 562.
15 VON FLOTOW, Louise. Translation and Gender. 1997, p. 193.
16 DIAZ CINTAS, Jorge. Clearing the Smoke to See the Screen : Ideological Manipulation in Audiovisual Translation. Meta. Vol. 57, n° 2, 2012, p. 279-293.
17 FERAL, Anne-Lise. Gender in Audiovisual Translation : Naturalizing Feminine Voices in the French Sex and the City. European Journal of Women Studies. 2011, Vol. 18, p. 391-407.
18 HARDIN, Gérard et PICOT, Cynthia. Translate : Initiation à la pratique de la traduction. Paris : Dunot, 1990.
19 DIAZ CINTAS, Jorge. Clearing the Smoke to See the Screen. 2012, p. 282.
20 BILLIANI, Francesca. Assessing boundaries – Censorship and Translation. An Introduction. Modes of Censorship and Translation. Manchester : Ed. Francesca Billiani, 2007, p. 5.
21 RICH, B. Ruby. To Read or Not to Read: Subtitles, Trailers, and Monolingualism. Subtitles : On the Foreignness of Film. Montreal : Alphabetic City, 2004, p. 153.
Bibliographie
AKASS, Kim et Janet MCCABE. Reading Sex and the City. Londres: IB Tauris, 2004.
BILLIANI, Francesca. Assessing boundaries – Censorship and Translation. An Introduction. Modes of Censorship and Translation. Manchester : Ed .Francesca Billiani, 2007.
BREY, Iris. Sex and the Series. Mionnay : Libellus Editions, 2016.
BUTLER, Judith. Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity. New York : Routledge, 1990.
CHAMBERLAIN, Lori. Metaphorics of Translation. In VENUTI, Lawrence (ed.). Rethinking Translation. London : Routledge, 1992.
DE LAURETIS, Teresa. Technologies of Gender. Bloomington : Indiana University Press, 1987.
DE MARCO, Marcella. Audiovisual Translation Through a Gender Lens. Approach to Translation Studies. Amsterdam-New York, Vol. 37, 2012.
DIAZ CINTAS, Jorge. Clearing the Smoke to See the Screen : Ideological Manipulation in Audiovisual Translation. Meta. Vol. 57, n° 2, 2012.
FERAL, Anne-Lise. Gender in Audiovisual Translation: Naturalizing Feminine Voices in the French Sex and the City. European Journal of Women Studies. 2011,Vol 18, p.391-407. https://doi.org/10.1177/1350506811415199
FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualité. Paris : Gallimard, 1984.
HARDIN, Gérard et PICOT, Cynthia. Translate : Initiation à la pratique de la traduction. Paris : Dunot, 1990.
HOLLOWS, Joanne. Feminism, Femininity and Popular Culture. Oxford : Manchester University Press, 2000.
HORER, Suzanne et SOCQUET, Jeanne. La Création étouffée. Paris : édition Pierre Horay, 1973.
MULVEY, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. Film Theory and Criticism : Introductory Readings. New York : Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen, Oxford UP, 1999, p. 833-844.
OUELETTE, Laurie. Victims No More: Television, Postfeminism and Ally McBeal. The Communication Review. Vol. 5, N°. 4, 2002, p 312-323.
RICH, B. Ruby. To Read or Not to Read : Subtitles, Trailers, and Monolingualism. Subtitles : On the Foreignness of Film. BAETANS, Jans. Montreal : Alphabetic City, 2004, p. 153-69.
SILVERMAN, Kaja. The Acoustic Mirror. Indianapolis : Indiana University Press, 1988.
SIMON, Sherry. Gender in Translation : Cultural Identity and the politics of transmission. London-New York : Routledge, 1997.
SIMONS, Margaret. The Silencing of Simone de Beauvoir. Guess What’s Missing from the Second Sex. Women’s Studies International Forum. Vol. 6, 1983, p.559–564
VON FLOTOW, Louise. Translation and Gender : Translating in the Era of Feminism. Ottawa : University of Ottawa Press, 1997.
ZWARG, Christina. Feminism in Translation : Margaret Fuller’s Tasso. Studies in Romanticism. Boston : Boston University, 1990, p. 463-90.