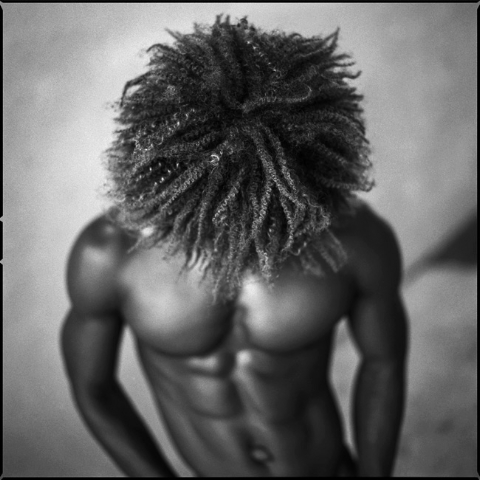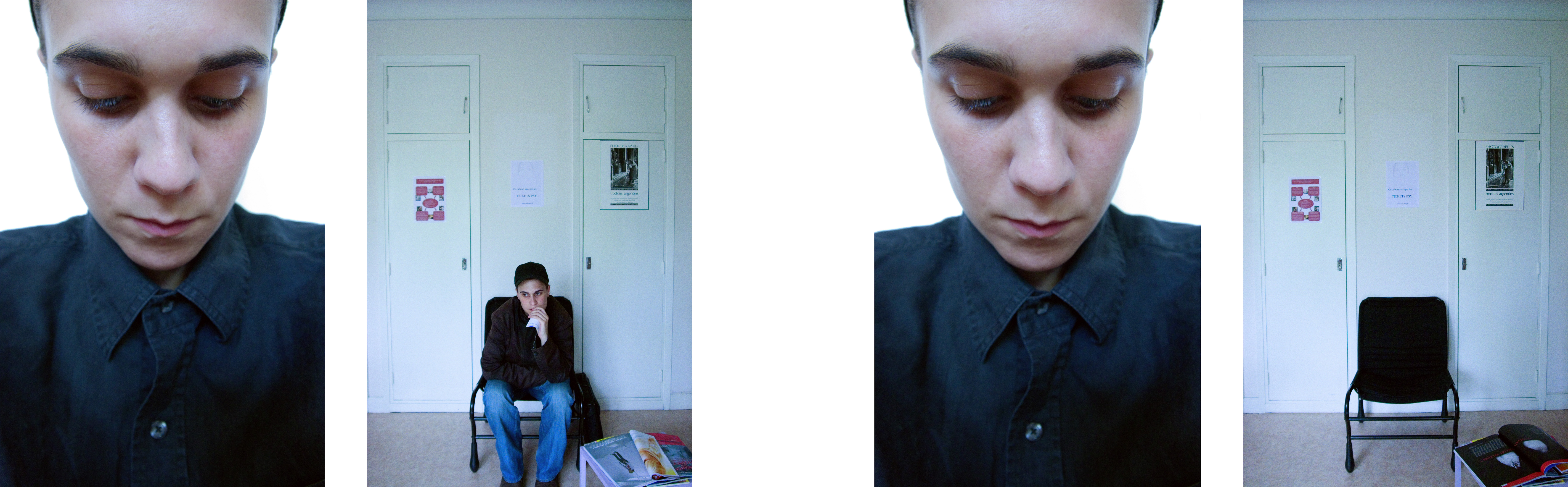Milena Mogica
Doctorante en Lettres et Arts, Université Lumière – Lyon 2
milemogi@yahoo.fr
Adeline Thulard
Doctorante en Lettres et Arts, Université Lumière – Lyon 2
adeline.9juin@gmail.com
Pour citer cet article : Mogica, Milena et Thulard, Adeline, « Le “training” comme processus dramaturgique : corps à corps chez Pippo Delbono. », Litter@ Incognita [En ligne], Toulouse : Université Toulouse Jean Jaurès, n°6 « Jeux et enjeux du corps : entre poïétique et perception », été 2016, mis en ligne en 2016, disponible sur <https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2018/01/09/la-ville-contemp…ite-au-generique/>.
Télécharger l’article au format PDF
Résumé
Pippo Delbono travaille à partir des corps de ses comédiens et de son propre corps. Il propose aux spectateurs des images intenses provoquant une expérience émotionnelle forte. L’étude de son training permet de dévoiler comment le geste devient un principe dramaturgique structurant, appelant une réception corporelle de la part du spectateur, à l’origine de l’émotion particulière caractérisant les représentations de la compagnie.
Mots-clés : training – théâtre – dramaturgie – geste – mouvement – psychologie
Abstract
Pippo Delbono works upon his body as well as his actors. He gives spectators intense images resulting in strong emotional responses. The study of his training allows to reveal how one movement becomes a dramaturgical structuring principle which calls for a physical reception from the spectator. It simply caracterises the origin of the company’s representations shared by the larger public.
Key-words: training – theatre – dramaturgy – motion – movement – psychology
Sommaire
1. Une matière corporelle pour la scène
2. Le training : des principes dramaturgiques
Notes
Bibliographie
Les spectacles de Pippo Delbono se déclinent en images, petites saynètes non dialoguées s’enchaînant sans liens logiques apparents. Colette Godard, dans sa préface à l’ouvrage Le Corps de l’acteur, les décrit en ces termes :
Car son théâtre […] se compose […] d’un enchaînement de tension, de défoulement, d’attente, d’arrêts brusques et menaçants, de cris, de paroles, de silences, de gestes, de mouvements, d’attente, de rires, de regards, de tout ce qui fait la vie en commun des êtres humains. Autant dire le théâtre.1
Le chaos qui semble parfois régner sur scène dans certaines séquences est le résultat d’improvisations corporelles, ensuite ré-élaborées et fixées. Ce travail de composition d’une partition physique à partir d’improvisations peut-il constituer la base d’une dramaturgie scénique ? Comment le training amène-t-il une réception physique pour le spectateur ? Les principes primordiaux qui régissent ce travail dans le corps peuvent-ils devenir la base dramaturgique du spectacle ?
Pippo Delbono travaille à partir des corps de ses comédiens et de son propre corps. Il propose aux spectateurs des images intenses provoquant une expérience émotionnelle forte, née d’une réception physique. Ce travail de corps à corps, de l’acteur au spectateur, vient de la pratique d’un théâtre anti-psychologique construite au fil des ans à partir de diverses rencontres, en particulier de collaborations avec l’actrice Iben Nagel Rasmussen de l’Odin Teatret (dirigé par Eugenio Barba) et avec Pina Bausch. D’une manière à la fois personnelle et héritée de ces rencontres, Pippo Delbono développe sa conception du training physique. Pour lui, il n’est pas voué à la virtuosité, n’est pas non plus uniquement un échauffement du corps avant la création, mais permet une maîtrise du corps et de ses émotions. Cette maîtrise n’est pas un contrôle coercitif, elle a pour objectif d’exprimer les tensions internes de l’interprète tout en les maintenant en équilibre et dans une forme de distance. Ainsi, l’engagement personnel de Pippo Delbono, de son vécu, dans ses spectacles, se double d’un engagement physique. Celui-ci permet de maîtriser celui-là, tout en l’exprimant par le geste. Le corps du spectateur est ainsi touché, en s’appuyant sur une empathie physique. Par ce biais, c’est dans le corps que naît l’émotion et c’est par lui qu’elle est revécue sur le mode de la distance. Dans ce théâtre, le geste issu du training est à la base de la dramaturgie du spectacle. L’émotion physique mise en jeu est d’abord marquée du sceau de l’incompréhension, car sa transposition dans le geste déplace son objet. La partition psychophysique de l’acteur construit un parcours sensoriel et émotionnel pour le spectateur, dont le corps est convoqué organiquement. Nous dévoilons ici, par une analyse du training chez Pippo Delbono, la façon dont le geste devient un principe dramaturgique structurant, appelant une réception corporelle.
1. Une matière corporelle pour la scène
De manière générale, le travail corporel des acteurs, à travers ce que l’on appelle parfois training, est devenu plus présent avec le développement d’un théâtre émancipé du texte, accentuant des aspects performatifs ou visuels, théâtre dit parfois « postdramatique », selon la terminologie utilisée par Hans-Thies Lehmann pour souligner cette émancipation. Nous verrons dans la deuxième partie ce qu’il en est de cet écartement du dramatique.
Dans un recueil, Le Training de l’acteur, Josette Féral introduit à cette notion de training :
Deux mots se partagent le champ dévolu au travail de l’acteur : training et entraînement. Coexistants dans les textes et les discours, sous la plume de praticiens et de chercheurs, ces deux termes semblent employés indifféremment pour désigner une seule et même réalité : celle du travail qu’effectue l’acteur pour perfectionner son art avant d’entrer en scène. Cette impression pourtant fait illusion.2
À ceci elle ajoute que l’utilisation de ce terme en France est relativement récente – milieu des années 1980. On le retrouve dans les écrits d’Eugenio Barba, de Richard Schechner, de Nicolà Savarese, alors que les textes de Jerzy Grotowski, Peter Brook, Antoine Vitez, Yoshi Oida, et de Barba lui-même avant 1982, parlent d’entraînement. Le mot training permet d’utiliser un même concept de manière « interculturelle »3, mais surtout d’éviter les connotations sportives voire militaires du mot « entraînement » : nous ne sommes pas dans une gymnastique d’acteur, mais dans une préparation à la scène qui va au-delà de la technique pure et s’inscrit dans le long terme. Nous sommes loin d’un travail physique qui ne servirait qu’à échauffer les muscles. Nous pouvons ici apercevoir l’héritage des pédagogies du XXème siècle : Jacques Copeau, Grotowski, Barba, défenseurs d’une éthique de l’acteur face au travail, l’attitude comptant autant que la réussite technique. Josette Féral donne, dans cette idée, quelques constantes du training : l’attachement à un maître ; un au-delà de la technique (la technique n’est pas tout) ; une inscription dans la durée ; des exercices poussés toujours plus loin et se décentrant ainsi de la notion de réussite pour proposer plutôt un cheminement tout au long de la vie ; l’individualisation de l’entraînement, car l’acteur doit s’y engager pleinement – et donc de manière personnelle.
Le training peut alors devenir la base d’un processus dramaturgique créateur, prenant les corps individualisés des acteurs comme matière première. Pippo Delbono est un artiste emblématique de cette évolution du training, évolution dont les différentes phases correspondent pour lui à un parcours de création et de vie4 qu’il est possible de suivre dans l’ordre chronologique de ses trois étapes principales : la découverte du training issu de l’Odin Teatret d’Eugenio Barba, puis le déclic provoqué par Pina Bausch dans l’usage de matériaux issus de la vie quotidienne, d’un biographique transposé, et enfin la rencontre avec Bobò, microcéphale et sourd-muet, mais surtout égérie, acteur représentatif de ce que Pippo Delbono demande au théâtre.
1.1. Le travail du mouvement au centre de la création : le training de l’Odin Teatret
Lorsque Pippo Delbono entre à l’adolescence dans sa première école de théâtre, le travail corporel n’y a pas sa place. La simple rencontre, en la personne de Pepe Robledo, avec un théâtre accordant de l’importance aux techniques physiques, est une révolution. Il pratiquera le training de l’Odin Teatret5, basé sur des actions physiques et vocales, avec Pepe Robledo puis avec Iben Nagel Rasmussen. Cette dernière est une des toutes premières actrices d’Eugenio Barba, et a largement contribué à l’évolution des techniques de l’Odin. Elle dirigeait à cette époque son propre groupe, appelé Farfa, à partir du training qu’elle avait développé d’une manière personnelle et qu’elle voulait transmettre.6.
Il dira plus tard qu’à ce moment-là, il ne comprenait rien au training, et qu’il ne saisira que plus tard la portée des principes internes aux exercices proposés. Ceux-ci sont tous en lien avec la notion de déséquilibre, de centre du mouvement, de tissage de contradictions corporelles7, et avec une idée du rythme issue des théâtres d’Inde et d’Asie. Par exemple, des « stops » au moment d’une acmé de l’action permettent de concentrer l’énergie qui en est issue en un instant intense pour le spectateur. Ou encore, dans le training de l’Odin, on insiste sur l’idée que les actions ont un début, un développement et une fin, ce qui correspond au principe de jo-ha-kyu du théâtre japonais8. Développer cet exemple va nous permettre de saisir en quoi on peut parler d’une dramaticité9 du geste, et, avec Barba, d’une « dramaturgie » de l’exercice10. Jo correspond au début, créé par une résistance interne au mouvement, par exemple dans une marche qui se figure rencontrer un obstacle (on peut imaginer le vent, ou opposer une pression contraire au niveau des hanches). Ha, c’est la possibilité du développement du mouvement, de l’action : la résistance disparaît et l’énergie, d’autant plus intensément qu’elle était précédemment retenue, se déploie dans le Kyu jusqu’à la fin, le moment de suspens équivalent au « stop » dont nous parlions, fin qui est aussi un nouveau début, un nouveau Jo. Pippo Delbono dira dans Le Corps de l’acteur11 :
Le training se construit en trois moments. Avant, pendant, après. L’acteur doit trouver différentes façons de tourner, d’aller au sol, de sauter, de perdre l’équilibre. Ensuite, il les assemble indifféremment comme dans une improvisation. Il s’agit de mouvements concrets et pas esthétiques. Une fois ces « phrases chorégraphiques » dessinées nous devons les inscrire dans l’espace et prendre conscience des lignes que le corps dessine.
Dans cette citation, nous retrouvons l’idée des trois étapes du mouvement, du montage des actions (permis par la fin du mouvement considérée comme un nouveau début), et enfin l’idée de « phrase », d’une écriture du corps dans l’espace, porteuse de dramaturgie. Il s’agit d’actions, et non pas de danse, ou alors d’une danse absolument dépourvue de volonté esthétique.
Mais Pippo Delbono dit aussi qu’il faudra se libérer de ces exercices et n’en garder que les principes intrinsèques (en particulier, le centrage de l’action), le but étant :
[…] de parvenir ultérieurement à une forme d’improvisation libre, poétique, consciente et attentive qui trace dans le même temps deux chemins, celui de l’observation des lignes que le corps produit dans l’espace, et celui de la fragilité et du naturel.
Le training n’est pas pour lui une fin en soi mais le vecteur de principes poétiques, à travers lesquels peut s’exprimer la sensibilité de l’acteur sans qu’il ne perde conscience de son inscription dans la dramaticité de l’espace et du mouvement, sur lesquels il peut alors s’appuyer.
1.2. Training et émotion : le vécu comme matière scénique
La sensibilité en scène est une caractéristique importante du travail de Pippo Delbono, que l’on peut symboliser, car il le fait lui-même, par sa rencontre avec Pina Bausch. Pepe Robledo en résume la conséquence ainsi : « Pippo a découvert que [son] vécu, très dense, pouvait devenir une matière artistique »12. En fait, il construisait déjà des scènes de manière très personnelle au moment de Farfa, proposant des éléments qui entraient en contradiction avec l’esprit du groupe – par exemple l’utilisation de musiques enregistrées. Cet univers est entièrement présent dans son premier spectacle, Le Temps des assassins, créé en collaboration avec Pepe. C’est ce spectacle que Pina Bausch voit et approuve, avant de les inviter à Wuppertal. Plus qu’un apprentissage de techniques – car le niveau des danseurs de Pina Bausch est difficile à suivre – il y trouve une reconnaissance de son univers, une confirmation, et comprend qu’il peut être « le créateur de ses propres spectacles »13.
Il est difficile de faire la part des choses entre l’influence du training de l’Odin Teatret et celle de Pina Bausch. Pippo Delbono dira de l’Odin : « J’ai senti qu’il manquait de la fragilité sous cette masse technique »14. Mais il serait trop simple de dire que l’Odin pousse à une virtuosité technique froide, là où Pina Bausch travaillerait sur le vécu et l’émotion. Dans Mon théâtre on peut lire :
À l’Odin, tout était fondé sur une sorte de rhétorique corporelle. Mais c’est comme dans le théâtre de texte, certains acteurs peuvent avoir une diction parfaite et être de mauvais acteurs.15
La différence viendrait alors du degré de sensibilité poétique que l’acteur est capable d’exprimer, de mettre en forme. Pour exprimer cette sensibilité, que l’on pourrait être tenté de placer du côté de Pina Bausch, Pippo Delbono dira aussi la nécessité de cette technique, ici celle de l’Odin :
Au bout d’un certain temps, l’acteur prend conscience de toutes les possibilités que lui offre son corps. Ainsi ce travail est un entraînement pour maîtriser les soubresauts de la pensée et les diktats des émotions.16
En effet, dans le training sont déjà présents des principes qui poussent l’acteur à une conscience de soi, à un travail sur le centrage de son corps, permettant un engagement du corps mais aussi de l’esprit et des émotions dans l’action, un engagement psychophysique. Par exemple, les exercices acrobatiques peuvent provoquer des émotions : un des stagiaires sur Enrico V17 dit qu’il a été « troublé » par un exercice sur la colonne vertébrale, que les sensations étaient troublantes, parce que les repères corporels étaient déplacés. De même, certains mouvements demandent une forme de courage, une gestion des émotions : la peur, le désir de bien faire, l’éveil de la sensualité. À propos des stages qu’il a pu diriger, Pippo Delbono nous dit :
[Je] me consacre uniquement à ce moment de l’échauffement [élaboré selon les principes du training] car y réside une grande partie des principes de l’art de l’acteur. Tout est là, la « dramaticité » et… la psychologie. L’acteur peut trouver à l’intérieur de son corps, sans se creuser la tête, des sentiments comme la douleur, l’amour, la beauté, la souffrance.18
Le terme « psychologie », dans ses autres occurrences, a dans sa bouche une connotation très négative. Elle semble ici être d’une nature différente et représenter l’apparition d’émotions nées du corps en travail.
Les œuvres de Pina Bausch semblent faire le chemin inverse, pour arriver à une précision hautement technique, qui posera des problèmes d’exécution au duo Pippo-Pepe. L’émotion, matière de départ, n’y est pas brute, elle est retraitée, jusqu’à devenir une forme, un mouvement froid que l’on peut répéter à l’infini.
L’opposition entre la physicité de l’Odin, risquant de toucher au formalisme par des principes de travail devenant des lois, et l’usage de la matière-émotion liée au vécu chez Pina Bausch, n’est donc valable que dans le cas précis de Pippo Delbono, dans le sens que ces rencontres ont prises pour lui. Mais cette opposition toute rhétorique nous permet de mettre à jour une contradiction volontairement présente dans ses créations, une tension entre la technicité, la précision des gestes, et l’intensité des émotions qu’ils peuvent provoquer pour le spectateur. L’émotion fait un double chemin : Pippo demande à ses acteurs de « trouver une manière de transformer les émotions en signes », et une « habileté technique pour transformer ses émotions en signes »19. Puis l’émotion naît pour le spectateur par le montage de ces différents « gestes », qui se contredisent, se complètent, se contaminent, dans un dialogue de type dramaturgique que nous analyserons en deuxième partie.
1.3. Le geste : déplacer l’émotion et la transformer en signes
Nous sommes en présence de partitions construites, où le mouvement sert à former des « phrases chorégraphiques ». Réciproquement, le texte en scène, souvent porté par Pippo Delbono, demande à être perçu comme un geste. Pippo lit les textes au lieu de les apprendre, pour mettre à distance les mots, pour que l’on ne puisse pas croire qu’ils sortent directement de lui, au premier degré. Il est donc dans une position où le texte n’est pas incarné par Pippo jouant un personnage. Les mots de Pippo n’interagissent pas au niveau fictionnel avec les saynètes, mais sont portés par lui comme un geste, exécuté en son nom propre, qui lui permet d’entrer dans un rapport poétique avec les actions des acteurs. Nous sommes de nouveau dans une logique de montage, créant des associations fécondes pour l’imagination du spectateur. Le texte y a le même statut que le reste des éléments scéniques montés dans la représentation, avec lesquels il dialogue. Il est par exemple en décalage avec l’action effectuée, comme lors de la dernière apparition de Lucia dans Il Silenzio, costumée en clown, une bouteille à la main, tandis que Pippo dit en boucle cette phrase grave qu’il a vue au cimetière des enfants de Buchenwald : « Quand tu es ici fait silence. Une fois dehors, ne reste pas silencieux ». La question de l’émotion trouve sans doute une issue modèle dans la rencontre avec Bobò20, que Pippo Delbono désigne comme son troisième maître. Cette rencontre intervient à un moment où il n’est plus capable de continuer le training, et éprouve du dégoût à l’égard de ce type de travail. Pourtant, il cherche encore à trouver un moyen d’en exprimer les principes. Il en explore les fondements, rythmiques et physiques, même lorsqu’il ne peut se lever. Il dira de cette période : « J’ai trouvé dans mon bassin, à la chute de la colonne vertébrale, la nécessité de ma présence sur un plateau […] l’énergie vitale s’y concentre. C’est là que réside ma pensée »21. Bobò est celui qui n’a pas besoin du training car la vie lui a fait intégrer ces mêmes principes, par un autre chemin que celui du travail technique. À partir de ce sentiment de soi initial, débarrassé de la tentation virtuose des partitions physiques, Pippo va développer dans ses spectacles une présence scénique mettant en avant une émotion non plus seulement liée aux contenus proposés par les séquences, mais liée aussi à l’engagement de l’acteur dans l’action même d’être en scène22. Il va désormais chercher des acteurs dont la présence sur le plateau le touche. Dans Mon théâtre, il est très clair à ce propos : « Le théâtre est aussi une question de vie, d’émotion, d’humanité, de présence et d’engagement sur le plateau »23. L’émotion, la vie, se trouvent associées à la présence de l’acteur en scène et à son niveau d’engagement dans l’action scénique. Pippo dira ainsi « Dans Barboni ou dans Guerra, les spectateurs ne doivent pas voir le travail de l’acteur, ils doivent percevoir la poésie de l’acteur au travail. C’est cela la rencontre avec Bobò. »24.
Cette poésie et cette présence continuent de passer par le geste, à la condition que ce geste soit une « nécessité » entièrement tournée vers la volonté de communication du récit ou de l’émotion de départ. Il parle de la nécessité de communication des gestes de Bobò, sourd-muet n’ayant jamais utilisé le langage des signes. Sa survie dépend de ses gestes, qui ne sont jamais esthétiques mais toujours voués à l’expression, et qui s’opposent à ce que Pippo appelle une « nécessité du personnage » empêchant de sentir celle, plus profonde, de l’acteur à être en scène25. Guidé par cette nécessité de communication, Bobò semble toujours faire pour la première fois les gestes pourtant calculés et encadrés par la partition prédéfinie qui est le point final de la poïétique de Pippo Delbono26. L’émotion est dépassée : quand ce n’est pas par la partition physique, c’est par un déplacement de l’intérêt du personnage sur la présence de l’acteur en scène et sur son engagement « centré » dans son action. Le travail du training, évoluant tout au long du parcours de l’artiste, a permis à la fois l’émotion et le dépassement de cette émotion par sa mise à distance ou par son déplacement. Le vécu utilisé comme matière scénique est complètement retraité, et l’émotion du spectateur n’est donc pas directement provoquée par le contenu du « récit » mais par le geste qui la porte, qui la transpose. Cela n’est possible que par une forme d’engagement dans l’action de la part des acteurs. Cet engagement est dans l’exécution du geste et de la partition plus lié à l’incarnation d’un personnage. Cela permet au spectateur de ne jamais perdre de vue l’acteur et son jeu. Il s’agit alors de monter ensemble des « lignes » d’actions physiques, dans la tradition allant de Stanislavski27 à Barba en passant par Grotowski. Leur précision, leur linéarité permettent de se dégager de la question de l’inspiration et du personnage, et servent à nettoyer l’acteur des émotions parasites. L’acteur est ainsi mis en évidence dans sa fonction de personne agissant en scène. Il est la matière scénique, modelée par un processus de type dramaturgique montant ensemble et faisant correspondre entre eux les éléments issus du training et ceux issus d’un vécu personnel.
Ces actions ne sont pas toujours porteuses d’un sens évident. L’incompréhension marquant les spectateurs est pourtant relayée par une dramaticité organique, réélaborée intellectuellement après le vécu, et portée par une dramaturgie déplacée à l’intérieur même du montage des actions scéniques.
2. Le training : des principes dramaturgiques
Comme nous l’avons vu, à la base du travail de composition se trouve le corps du comédien. Le travail d’écriture ou « travail à la table » est remplacé par des séances consacrées au training, à la maîtrise et à l’écoute du corps. Le texte n’est pas au centre de la représentation, mais le modèle dramaturgique n’est finalement pas écarté. Il devient dramaturgie scénique, écriture des corps, et ce à différents niveaux : par le montage des séquences entre elles à l’échelle du spectacle, par le montage à l’intérieur des séquences, et par un travail à l’intérieur du corps. La dramaturgie comme construction du sens et de l’émotion, associée au training, implique alors pour le spectateur une logique de l’émotion passant par le corps. Ce qui se tisse entre la scène et la salle devient de l’ordre de l’organique.
2.1. Enjeux d’une dramaturgie
Il peut sembler difficile de parler de dramaturgie puisque ce terme est fondamentalement lié à la question du texte, tant dans son premier sens (l’écriture du texte théâtral), que dans le second (le passage du texte théâtral à la scène). Il s’agit ici au contraire de partir de la scène et d’en organiser les matériaux visuels et auditifs. Catherine Bouko et Hans-Thies Lehmann, dans leurs ouvrages respectifs sur le spectateur postdramatique28 et le théâtre postdramatique29, parlent de dramaturgie visuelle. Dans leur réflexion, la scène devient « graphie », le spectateur « lecteur », les éléments scéniques étant considérés comme des signes. Les conséquences du déplacement du terme de dramaturgie du texte à la scène ne sont cependant pas analysées. Ce sont les définitions les plus larges du terme qui permettent de penser une dramaturgie de la représentation, comme l’indique Joseph Danan dans son article « Tentative de cadrage » : « La dramaturgie est ce qui organise l’action en fonction d’une scène, qu’elle soit le fait de l’auteur dramatique ou celui du metteur en scène ou de l’auteur scénique ».30 Dans Qu’est-ce que la dramaturgie ? il reprend les mots de Jean-Marie Piemme pour éclairer les diverses significations du terme :
À son sens le plus large elle [la dramaturgie] témoigne de ce que tout élément théâtral élaboré dans la dialectique d’un objet à voir et d’un regard pour le saisir installe l’ordre du sens, de la signification.31
Les éléments, qu’ils soient textuels ou visuels, sont organisés pour être montrés, et par conséquent pour « faire sens ». Il s’agit donc d’organiser l’action, cet art de la composition devenant un « ordre où tout signifie32», mais pas seulement : c’est aussi un ordre où tout fait « émotion ». Marie-Madeleine Mervant-Roux, dans son article « Un dramatique postthéâtral ? », nous rappelle que selon Aristote la dramaturgie s’élabore entre mimesis et catharsis : « l’organisation du mythos, le jeu mimétique de l’acteur […] l’une et l’autre ont un même objectif ultime : produire chez le spectateur des émotions ». Une étude dramaturgique a autant pour but de comprendre le type de représentation en jeu que l’émotion qui en naît, ce que l’auteure résume dans la question suivante :
Comment se développe aujourd’hui le processus émotionnel, donc sémantique – il y a de l’émotion lorsque le sens déborde – occupant désormais la place de la catharsis à l’ancienne ?33
Nous ne chercherons pas spécifiquement à répondre à cette question mais cela nous permet de définir la dramaturgie comme désignant la façon dont l’action s’organise pour produire du sens et de l’émotion. C’est donc à partir d’une étude dramaturgique que nous tenterons de comprendre le type de réception mis en jeu par le travail sur le corps défini en première partie de cet article. Dans le Lexique du drame moderne et contemporain34, coordonné par Jean-Pierre Sarrazac, les auteurs étudient les évolutions des termes traditionnels de la dramaturgie dans les écritures textuelles contemporaines. Nous tenterons d’appliquer la même logique en pensant aux déplacements de ces termes dans les écritures scéniques. Les principes fondamentaux de la dramaturgie sont énoncés par Peter Szondi dans Théorie du drame moderne35. Selon lui, le personnage dramatique se réalise dans l’acte de décision qui instaure le conflit à résoudre, moteur de l’action dramatique et du déroulement de la « fable », à travers le dialogue. Le dialogue étant presque absent des spectacles de Pippo Delbono, nous privilégierons l’étude des notions d’action et de conflit.
2.2. Une dramaturgie du geste faite de tensions
L’action qui se développe dans les spectacles de Delbono n’a bien sûr plus rien de la grande action avec un début, un milieu et une fin. Aucune progression, ni évolution quelconque : le conflit ne se résout pas. Il s’agit ici plutôt de micro-gestes ou de micro-actions, telles que les définit Vinaver, dont les réflexions sont reprises par Joseph Danan dans l’article « action » du Lexique du drame moderne et contemporain : « [e]lles prolifèrent et le texte n’agit plus qu’au niveau moléculaire, dans un grossissement, comme au microscope, du présent […] Elles se développent dans deux directions opposées : la parole-action et les actions physiques »36. Si les textes contemporains jouent sur la parole-action, comme chez Valère Novarina, les écrivains de plateau se réapproprient les actions scéniques d’abord élaborées par Stanislavski puis par Grotowski et Barba, comme nous l’avons abordé en première partie.
Dans une scène d’Il Silenzio, une jeune femme se dandine sur une chaise au son de la chanson « Une histoire de plage » de Brigitte Bardot. Un jeune homme arrive, elle lui saute dans les bras, puis se retourne et fait la moue. Il lui offre un collier, le lui met : de nouveau elle l’embrasse puis fait la moue. Il lui offre un manteau de fourrure : même jeu. Puis il lui donne des clés que nous supposons être d’une voiture. Ils s’enlacent finalement pour ne plus se lâcher, tournent de plus en plus vite et tombent au sol. Pendant la fin de la scène, le volume sonore de la musique a augmenté, et la voix de Pippo Delbono en off dit les mots suivants en italien : « dis-moi que tu m’aimes, dis-moi que tu m’aimeras toujours », de plus en plus fort, jusqu’au cri. Les gestes composent ici « l’action » principale. Les principes de composition de cette « partition » sont intrinsèquement liés au travail du training dont nous venons de parler. Dans cette scène, les gestes sont précis et répétitifs, et le travail sur la tension intérieure, le conflit qui marque l’émergence du geste, est visible dans le mouvement final. Les deux amoureux tournent sur eux-mêmes, enlacés : la force de ce mouvement giratoire tend à la séparation des deux corps, alors que ceux-ci se resserrent l’un contre l’autre. Pour contrer l’élévation que subit le corps de la femme, ils tombent finalement tout deux au sol. Le « conflit » dramatique semble ici élargir sa définition, comme les auteurs du Lexique le notent déjà à propos des écritures dramatiques. Il retrouve son sens étymologique de « choc » et désigne tout type de « tension, […], oppositions, […] luttes »37.
Pour en revenir aux tensions en jeu dans le corps, on peut s’arrêter un moment sur la « danse de Pippo », évoquée à de nombreuses reprises dans les écrits sur le travail du metteur en scène. Nous avons vu que le parcours de Pippo l’a amené progressivement de la maîtrise du corps à sa prise en compte dans des caractéristiques individualisées, notamment à travers son expérience du corps malade. L’impossibilité d’exécuter le training parfaitement fait naître une danse pleine de tensions qui rend compte des énergies et des faiblesses traversant le corps empêché38. Dans Questo buio feroce, cette danse apparaît à plusieurs reprises : ses bras semblent pris de spasmes, entraînant le corps vers le haut puis vers le bas, d’un côté puis de l’autre, se répétant inlassablement. Le même type de mouvements, ici exécuté sur une musique stridente au violon reprenant à travers un jeu entre graves et aigus les tensions du corps, sont ensuite reproduits vers la fin du spectacle, sur la chanson d’Aznavour « Emmenez-moi » : cette fois le rythme est moins saccadé, les mouvements allant plutôt de la fermeture sur soi à l’ouverture.
Ce jeu de reprises des mêmes mouvements, jeu sur les différentes tensions qui peuvent naître de l’assemblage d’éléments, est également présent dans Il Silenzio. Le metteur en scène reprend un texte d’Ezéchiel dans la Bible à deux reprises : la première fois texte en main, articulant les mots et appuyant sur chaque syllabe, une musique au violon sur un mode mineur accompagnant sa voix. La seconde fois en hurlant et courant, sur un fond de bruit de tonnerre. Pippo Delbono affirme cette volonté de contradiction dans une formule assez simple « je veux voir un corps qui nie cette voix »39. Les éléments scéniques, dans la variation, peuvent donc se contredire, et le corps et la voix peuvent se dissocier et entrer en conflit. Dans la scène des « amoureux » évoquée plus haut, les éléments scéniques semblent entrer en collision les uns avec les autres : l’augmentation du volume de la musique, les cris de Delbono entrent en contradiction avec la légèreté même de la chanson et de la scène.
La dramaticité des gestes semble résolument attachée à ce travail sur la contradiction : Pippo Delbono affirme que l’objectif est de laisser ouvert le sens pour « créer un vide dans la signification de ce qui est dit en scène, [et permettre] au spectateur de combler ce vide avec son expérience »40. Cette dramaticité est ouverte, non fixée, fondamentalement liée à la nature du geste théâtral. Les théories sur le geste théâtral sont l’enjeu d’un débat haut en couleurs au XIXème siècle. Si certains, comme Le Brun, tentent de fixer le sens des gestes et des expressions, pour parfaire l’art du comédien, d’autres affirment l’impossibilité de faire du geste un signe dont la signification serait évidente. Le geste serait donc, pour reprendre l’expression d’Anne Ubersfeld, signe opaque, en ce sens que le référent est absent, non identifiable. Maddalena Mazzocut-Mis, dans son ouvrage inédit sur « La forme de la passion »41 se replace au centre du débat des Lumières et expose la position de Raymond de Sainte-Albine, théoricien de l’époque : « Aucune codification de signe ne peut exprimer la gamme passionnelle infinie et le geste n’est pas un langage à lire ». Elle affirme un peu plus loin que « le langage gestuel, comme le langage artistique en général, ne sera donc pas l’expression en miroir d’un ordre présumé de type cognitif ». Le geste est expression et communication des émotions, en ce sens, justement, il ne peut faire passer un sens clair et circonscrit.
2.3. Sémiotisation déplacée et réception physique
Si l’action dramatique comme principe dramaturgique est remplacée par le geste dans les formes que nous étudions ici, c’est donc à partir de cette organisation de l’action comme organisation du geste que naîtront le sens et l’émotion. Le geste est cependant un signe opaque et sa dramaticité, sa potentialité de sens, passe par l’émotion. Le travail sur le corps permet à Delbono d’atteindre les spectateurs sans passer par une intellectualisation. Le geste serait donc « le vecteur d’une émotion non polluée par un sens ou un discours » pour que « la relation à établir entre les acteurs et le public ne soit pas intellectuelle mais physique »42. Du côté de la réception, le spectateur se trouve face à des images dont la signification reste ambiguë : même si les gestes de la scène des amoureux, que nous avons décrits plus haut, sont assez reconnaissables (un couple pas si atypique où Madame réclame les cadeaux de Monsieur), le final, composé à partir de jeux de tension, rend l’interprétation difficile. C’est la contradiction en jeu dans le geste, le « conflit » qui y est surexposé et empêche une sémiotisation limpide. Cette absence de réponse à l’appétit sémiotisant du spectateur peut créer une sorte de choc, non en jouant sur des images choquantes, mais simplement parce qu’il y a ici aussi tension entre les attentes du spectateur et ce qui lui est proposé. Ce choc relèverait alors directement du geste, grâce à sa valence émotionnelle intrinsèque et au travail de précision développé pendant le training.
La réception prend donc un caractère corporel lié au travail du corps du comédien. On peut évoquer à ce sujet les théories d’Hubert Godard sur l’empathie kinesthésique en danse :
Le mouvement de l’autre met en jeu l’expérience propre du mouvement de l’observateur : l’information visuelle génère, chez le spectateur, une expérience kinesthésique (sensation interne des mouvements de son propre corps) immédiate, les modifications et les intensités de l’espace corporel du danseur trouvant ainsi leur résonance dans le corps du spectateur.43
Le mouvement de l’autre, du comédien, est ressenti dans le corps-mémoire du spectateur grâce à sa capacité kinesthésique, c’est-à-dire, selon la définition du terme dans Le Nouveau Littré, « la perception sensitive et nerveuse du mouvement des muscles du corps», ceux-là même qui contiennent cette mémoire et qui permettent « l’empathie kinesthésique ». Certains de nos muscles enregistrent nos changements d’état affectif. Ainsi, un changement de notre état peut provoquer une modification corporelle et vice versa, un mouvement peut amener un état émotionnel. De la même façon, via l’empathie kinesthésique, le mouvement de l’autre, sollicitant le mien, peut m’amener à un état affectif. Il est ainsi possible que le corps traversé de tensions de Pippo Delbono ait un impact sur le corps du spectateur, par le ressenti organique de ces tensions.
Le geste permet de toucher le spectateur, de l’amener à l’émotion, celle-ci ne donnant pas tout de suite lieu à un sens direct, à une intellectualisation. Le travail du training constitue ici une dramaturgie du geste basée sur le conflit (le choc, la tension), et c’est ce travail qui donne au geste sa qualité affective. Selon Delbono,
« Dramatique » signifie que ces mouvements, leurs enchaînements, leurs ruptures et surtout l’énergie, la force qui les habite, donnent à l’acteur la possibilité de créer un lien avec le public, une attention partagée.44
Joseph Danan, dans son dernier ouvrage Entre théâtre et performance : la question du texte, admet des formes de dramaticité non suscitées par le texte et, en évoquant l’étiquette postdramatique il suppose qu’ « il pourrait s’agir, dans bien des cas, d’une dramaticité qui s’élabore et opère autrement »45. Autrement que le texte, infirmant en partie les théories de Lehmann et Bouko faisant de la scène postdramatique une graphie et de ses éléments des signes. Ces signes, ici les gestes, obéissent à une logique autre qui appelle la sensibilité du spectateur, la dramatisation du spectateur passant par une expérience corporelle. Si l’on reprend les termes de Danan il s’agirait alors d’une dramaticité.
[…] qui n’annule pas l’intellection mais la déplace dans le temps. Le spectateur revient de là […] [du spectacle] avec une somme d’impressions, de sensations, en tout point comparables à celles d’une expérience vécue.46
Conclusion
Dans son travail sur le training, Pippo opère une synthèse, dont les étapes correspondent à son propre parcours artistique. D’abord, en opposition avec le théâtre de psychologie et de texte, il s’engage dans un travail d’accumulation de principes physiques avec Iben Nagel Rasmussen. Le training devient la possibilité de construire des partitions avec « la force, les qualités dramatiques du training, qui met en jeu le corps de manière tout à fait particulière, concentre l’énergie au niveau de l’estomac »47. Des conséquences psychophysiques sont déjà présentes, et ce sont ces conséquences, ces sensations de tensions, de contradictions dans le corps créant un engagement dans l’action et une sensation de soi exacerbée, qu’il retiendra. A partir de cet engagement qui focalise l’attention du spectateur sur l’acteur, tout matériau peut devenir intéressant pour la scène, y compris des éléments d’un biographique transposé. Cela lui sera confirmé par le travail que développe Pina Bausch à partir de micro-actions issues d’un vécu quotidien. Pour Pippo le geste devient alors encore plus important, et se transforme en signe opaque et complexe. Puis le fait que le corps de Pippo malade le trahisse, et la collaboration avec des acteurs qui ont toutes sortes de difficultés physiques, dévie le geste de son amplitude expressive esthétisante, pour l’amener à considérer l’acteur comme un être qui effectue en scène un travail de présentation de soi et d’usage de soi tel qu’il est, sans autre support que lui-même : « être sur scène, ne rien faire, et dégager de cette immobilité une humanité ». Petit à petit, Pippo ascétise les principes du training initial.
Si Pippo synthétise différentes tendances d’un training sujet à évolutions, on peut dégager au moins une constante : celle de provoquer des émotions avec un langage artificiel, par une dramaturgie du geste. Le geste prend la place de l’action et, par les principes de contradiction en jeu dans le training, crée une tension de type physique chez le spectateur, avec des réactions physiologiques et une attention accrue portée à la scène. On a donc une construction dramaturgique intrinsèquement liée au travail du training, entendu comme travail psychophysique et personnel, et non comme acquisition d’éléments de virtuosité. La manière d’envisager le training permet un lien organique entre le processus de création et le processus de réception.
Ce travail corporel du training, débouchant sur la partition physique de l’acteur, est soutenu par le montage qu’effectue Pippo Delbono avec les autres éléments de la représentation. L’organicité de la réception est encadrée et guidée par les images scéniques, qui en sont comme le support. Elles restent dans la mémoire des spectateurs car ce sont des images vivantes, d’une vie à la fois traduite par l’image et créée par les contradictions internes à l’image, qui en devient dynamique. La poïétique de Pippo Delbono permet dans ses représentations des associations visuelles et sonores faisant appel à tous les sens, et à une mémoire, une « bibliothèque » d’images du spectateur, le rendant actif dans la perception du spectacle par l’éveil de son propre univers. Le montage, de type surréaliste, est producteur d’un sens inextricable plus qu’absent.
Au-delà de l’entraînement de l’acteur, c’est une manière de créer qui se met en place, une poétique dont le dialogue avec la réception se fait dans un jeu de miroir corporel. Cela permet au spectateur de vivre autrement l’expérience du spectacle, d’une manière somme toute proche de ce qu’est l’expérience émotive dans la vie réelle : momentanément non-intellectuelle, opaque, et suffisamment dérangeante ou présente pour que l’on revienne dessus et que l’on y réfléchisse par la suite.
Notes
1 – Colette Godard, Préface à Le Corps de l’acteur, 2004, p. 12.
2 – Josette Féral, Introduction à Le Training de l’acteur, 2000, p. 10.
3 – Ibidem p. 11 ; cette notion d’interculturel est largement utilisée et développée par Eugenio Barba et représente une volonté de trouver les éléments communs entre différentes cultures, pour une anthropologie du théâtre.
4 – Sera principalement utilisé l’ouvrage Le Corps de l’acteur, op. cit., qui développe les principes de travail corporels de Pippo Delbono. Voir également l’ouvrage Mon théâtre, 2004, qui raconte son parcours et sa vision du théâtre. Deux entretiens avec des participants au stage autour du spectacle Enrico V ont confirmé par des exemples concrets ce que disent ces livres à propos du training.
5 – Eugenio Barba a fondé l’Odin Teatret en Norvège en 1964, à son retour de Pologne où il avait passé trois ans avec Jerzy Grotowski. De cette formation initiale, il garde le travail physique et vocal sur des exercices issus du yoga et adaptés au développement des capacités scéniques des acteurs.
6 – À propos de l’individualisation progressive des séquences d’exercices, « laboratoire de la dramaturgie personnelle », on peut consulter l’article « Un jardin tout pour soi » de Barba, publié dans la revue québécoise Jeu, n° 129, 2008, pp. 62-66.
7 – Ces oppositions peuvent concerner les directions, mais aussi les qualités du mouvement. Par exemple, pour exécuter le « pas du samouraï » qui fait partie du training, issu des arts martiaux, le haut du corps est détendu alors que le bas est tonique.
8 – Eugenio Barba, Nicolà Savarese, L’Énergie qui danse, Dictionnaire d’anthropologie théâtrale, 2008 (1983), p. 24.
9 – « Dramaticité » est un terme employé par Pippo Delbono. On le retrouve aussi chez Joseph Danan. Contrairement à la dramaturgie, il ne concerne pas la composition de l’action, mais ses aspects donnant à l’œuvre la possibilité de provoquer une émotion dramatique, émotion liée à la mise en présence des différents éléments de l’action.
10 – Eugenio Barba, « Le Protagoniste absent » dans Le Training de l’acteur, op. cit., pp. 81-94 et en particulier p. 86 : « Un exercice est un exemple paradoxal de dramaturgie, si par dramaturgie nous entendons une succession d’événements. »
11 – Op. cit, ici p. 28. Sauf indication contraire, toutes les citations sont tirées de cet ouvrage, qui développe les principes corporels de son travail.
12 – Ibidem, p. 43.
13 – Ibidem, p. 44.
14 – Ibidem, p. 31.
15 – Pippo Delbono, Mon théâtre, 2004, p. 85.
16 – Le Corps de l’acteur, op. cit., p. 30.
17 – Spectacle créé en 1992, d’après Shakespeare, et intégrant un chœur recruté sur place et formé pour la représentation pendant une semaine, en suivant le training dirigé par Pepe Robledo.
18 – Le Corps de l’acteur, op. cit., p. 23.
19 – Le Corps de l’acteur, op. cit., p. 86.
20 – Vincenzo Cannavacciuolo, dit Bobò, est microcéphale et sourd-muet. Pippo Delbono l’a rencontré dans l’hôpital psychiatrique où il était interné depuis 40 ans. Quand on l’interroge à ce propos, Pippo Delbono se défend de faire du théâtre-handicap, et affirme avant tout les qualités d’acteurs des gens avec qui il a choisi de travailler.
21 – Le Corps de l’acteur, op. cit., p. 42. Par ailleurs, Pippo Delbono est bouddhiste et les pratiques de méditation ou d’observation des émotions se basent, entre autres, sur un centre du corps humain interne placé légèrement sous le nombril, au niveau des entrailles. Appelé Hara en japonais, Tantien en chinois, il est considéré comme le centre de gravité du corps mais aussi comme le siège des émotions et la source de l’énergie.
22 – Les éléments du travail de Delbono correspondent à l’évolution de son parcours artistique. Ils servent ici de modélisation et sont présentés comme séparés. Mais le travail de l’Odin et les théorisations d’Eugenio Barba, en particulier sur la notion de pré-expressif, prenaient déjà en compte cette présence première de l’acteur en scène – l’important, ici, c’est la prise de conscience de cet aspect par Pippo Delbono et les changements que cela a introduit dans ses principes de création.
23 – Op. cit., p. 88.
24 – Le Corps de l’acteur, op. cit., p. 37.
25 – Des personnages sont présents par le biais de costumes et de gestuelles, mais il est impossible d’oublier qu’il s’agit avant tout de Bobò, ou de tel ou tel acteur, de par la qualité du mouvement et les silhouettes si reconnaissables.
26 – Pippo Delbono parle de cette capacité de Bobò à faire les gestes « pour la première fois » dans l’émission « Studio Théâtre » du 27 janvier 2012 animée par Laure Adler, en écoute sur le site de France Inter jusqu’au 23 octobre 2014.
27 – Stanislavski, dans la dernière partie de son travail, rejoint sur certains aspects ce que proposait Mejerhold (alors que pendant longtemps leurs travaux allaient dans des directions opposées). C’est sur cette dernière période que se base Grotowski lorsqu’il revendique une continuité entre son travail et celui de Stanislavski. Voir à ce sujet : Marie-Christine Autant-Mathieu, K. Stanislavski. La Ligne des actions physiques. Répétitions et exercices, 2007.
28 – Catherine Bouko, Théâtre et réception : le spectateur postdramatique, 2010.
29 – Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique, 2002.
30 – Joseph Danan, « Tentative de cadrage(s) », 2010, p. 12.
31 – Joseph Danan, Qu’est-ce que la dramaturgie ?, 2012, p. 6.
32 – Ibidem.
33 – Marie-Madeleine Mervant-Roux, « Un dramatique postthéâtral ? », 2004, p. 16.
34 – Lexique Du Drame Moderne et Contemporain, 2005.
35 – Peter Szondi, Théorie du drame moderne, 1956.
36 – Lexique, 2005, p. 26.
37 – Lexique, 2005, p. 49.
38 – Cf. Bruno Tackels, Pippo Delbono, 2009, p. 74.
39 – Leonetta Bentivoglio, Corpi senza menzogna, 2009, p. 28.
40 – Rossi Ghiglione, Barboni, 1999, p. 55-56.
41 – Maddalena Mazzocut-Mis, La Forma Della Passione, np.
42 – Pippo Delbono, Pons, Le Corps de l’acteur, 2004, p. 22 et 26.
43 – Hubert Godard, 1995, « Le Geste et sa perception », p. 239.
44 – Pippo Delbono, Pons, op. cit., 2004, p. 22.
45 – Joseph Danan, Entre théâtre et performance : la question du texte, 2013, p. 29.
46 – Joseph Danan, op. cit., 2013, p. 39.
AUTANT-MATHIEU Marie-Christine. K. Stanislavski. La Ligne des actions physiques. Répétitions et exercices. Montpellier : L’Entretemps, collection Les Voies de l’Acteur, 2007, 364p.
BARBA Eugenio. « Un jardin tout pour soi » , revue Jeu, n° 129, 2008.
BARBA Eugenio, SAVARESE Nicolà. L’Énergie qui danse, Dictionnaire d’anthropologie théâtrale. Paris : Éditions l’Entretemps, collection Les Voies de l’Acteur, 2008.
BENTIVOGLIO Leonetta. Corpi senza menzogna. Firenze : Barbès, 2009, 163p.
BOUKO Catherine. Théâtre et réception : le spectateur post-dramatique. Bruxelles : Peter Lang, 2010, 258p.
COLLECTIF. Le Training de l’acteur. Éditions Actes Sud Papiers, coédition Centre national du théâtre (CNSAD), coll. Apprendre, 2000, 208p.
DANAN Joseph. « Tentative de cadrage(s) », Revue d’études théâtrales : Registres, 2010.
DANAN Joseph. Qu’est-ce que la dramaturgie ? Éditions Actes Sud Papiers, coll. Apprendre, 2012, 76p.
DANAN Joseph. Entre théâtre et performance : la question du texte. Éditions Actes Sud Papiers, coll. Apprendre, 2013, 96p.
DELBONO Pippo. Mon théâtre. Éditions Actes Sud Théâtre, coll. Le temps du théâtre, 2004, 240p.
DELBONO Pippo, PONS Hervé (préface : GODARD Colette). Le Corps de l’acteur. Éditions Les Solitaires Intempestifs, coll. Du Désavantage du Vent, 2004, 96p.
GHIGLIONE Rossi. Barboni : il teatro di Pippo Delbono. Ubulibri, 1999, 182p.
GODARD Hubert. « Le Geste et sa perception » in GINOT Isabelle et MARCEL Michelle, La danse au XXème siècle. Paris : Bordas, 1995.
LEHMANN Hans-Thies. Le Théâtre postdramatique. L’Arche Éditeur, 2002, 308p.
MAZZOCUT-MIS Maddalena. La Forma Della Passione. Éditions Mondadori Éducation, coll. Studi di Filosofia, 2014, 144p.
MERVANT-ROUX Marie-Madeleine. « Un dramatique post-théâtral ? », L’Annuaire théâtral, numéro 36, automne 2004, p. 13–26.
SARRAZAC Jean-Pierre (dir.). Lexique Du Drame Moderne et Contemporain. Éditions Circé, collection Circé Poches, 2005, 254 p.
SZONDI Peter. Théorie du drame moderne. Éditions Circé, 1956 (réédition 2006).