La notion de vulnérabilité est souvent placée au cœur de la recherche sur l’éthique et les humanités en santé, mais il s’agit d’un élément théorique rarement approfondi.
La vulnérabilité en santé : penser le corps et le temps du soin
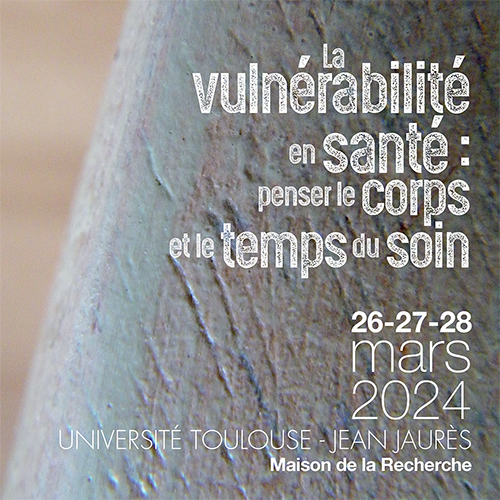
Le webmedia de l'Université Toulouse – Jean Jaurès
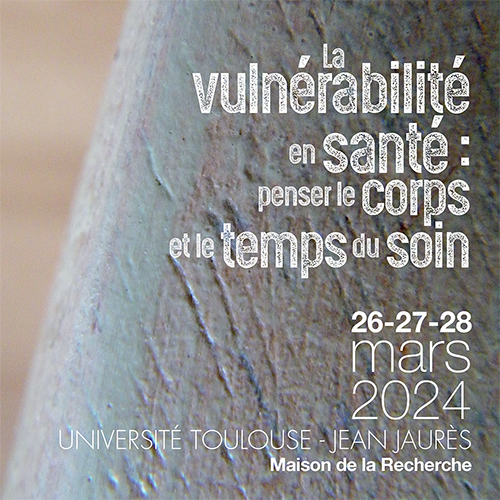
La notion de vulnérabilité est souvent placée au cœur de la recherche sur l’éthique et les humanités en santé, mais il s’agit d’un élément théorique rarement approfondi.

Comment soulager la douleur lorsqu’elle devient rebelle aux traitements ? Au-delà de la maladie, certains patients sont confrontés à la récurrence d’une douleur qui ne trouve aucune réponse. La douleur fait partie de leur vie quotidienne. Nos invités sont spécialiste de la prise en charge de la douleur chronique et nous aident à comprendre en quoi consiste leur accompagnement.

Comment soulager la douleur lorsqu’elle devient rebelle aux traitements ? Au-delà de la maladie, certains patients sont confrontés à la récurrence d’une douleur qui ne trouve aucune réponse. La douleur fait partie de leur vie quotidienne. Nos invités sont spécialiste de la prise en charge de la douleur chronique et nous aident à comprendre en quoi consiste leur accompagnement.

Que se passe-t-il dans un service de réanimation ? Comment les soignants aident les malades chroniques ? À quoi sert la simulation en santé ? Quelle est la place des familles dans les services de soins ? Est-il possible d’avoir une intimité, une vie affective et sexuelle à l’hôpital ?

Penser la santé est le podcast du Réseau de recherche Penser la Santé. Chaque épisode vous propose d’aborder un thème issu de situations de soin pour explorer les enjeux des pratiques et de leurs évolutions.
Pour penser la santé, nous accueillons des spécialistes de ce domaine : des professionnels du monde de la santé (médecins, infirmiers, psychologues…), mais aussi des chercheurs universitaires qui consacrent leur travail à la réflexion sur la santé.

Dans un contexte de dérèglement climatique, la philosophe Aline Wiame s’intéresse aux représentations artistiques de ce monde en changement et aux affects qui nous habitent.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Depuis que le chimiste Paul Crutzen, prix Nobel pour ses travaux sur la chimie de l’atmosphère, a suggéré l’emploi de ce terme en 2000, l’Anthropocène (littéralement, le nouvel âge de l’homme : anthropos, l’homme et kainos, nouveau) a fait une carrière aussi fulgurante qu’étonnante pour une notion scientifique émise dans le champ circonscrit de la géologie.
C’est qu’avec l’Anthropocène, les humains ne seraient plus simplement les témoins de changements géo-climatiques mais bien leurs principaux auteurs-fauteurs de troubles. L’Anthropocène s’est de fait imposée comme une formidable chambre expérimentale des relations entre les sciences du système Terre, les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales.
Il en ressort une prolifération de récits qui font surgir presque autant de versions qu’il y a de façons d’appréhender le monde : Capitalocène, Occidentalocène, Anglocène, Technocène, Cthulhucène, Plantationocène, Homogénocène, Poubellocène, Entropocène…
Plus de 150 appellations différentes se disputeraient une évidence pas si aisée à établir même à l’heure du réchauffement climatique, en somme cette idée que nous vivons dans une époque géologique qui soit au premier chef le fait des humains.
Alors faut-il congédier cette notion ? Ou bien faut-il accueillir cette pluralité des récits comme une chance ou du moins un témoignage de la vitalité des savoirs partagés sur notre destin climatique ?
Réalisateur(s) : BOUHARAOUA Samir
Producteur : Université Toulouse-Jean Jaurès-campus Mirail
Date de réalisation : 10 Octobre 2019
Durée du programme : 102 min
Niveau : niveau Licence (LMD), niveau Master (LMD)
Disciplines : Géodynamique externe – climatologie, Changements globaux, Géographie physique, humaine, économique et régionale, Philosophie contemporaine
Editeur : SCPAM / Université Toulouse-Jean Jaurès-campus Mirail
Langue : Français
Conditions d’utilisation / Copyright : Tous droits réservés à l’Université Toulouse-Jean Jaurès-campus Mirail et aux auteurs.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Ancien résistant guévariste, il fut emprisonné durant quatre ans en Argentine.
Il est l’auteur d’une thèse soutenue en 1987 une thèse en sciences humaines cliniques (Paris VII) : Du Sujet dans les prisons politiques, étude psychanalytique du rapport sujet-discours dans une situation limite et de plusieurs ouvrages dont «L’éloge du conflit » (Ed. La Découverte, 2007).
Voir la collection CINÉLATINO-RENCONTRES CINÉMAS D’AMÉRIQUE LATINE sur CanalU
Durée du programme : 25 min
Classification Dewey : Philosophie et psychologie, Les arts
Niveau : Tous publics / hors niveau, niveau Licence (LMD), niveau Master (LMD), niveau Doctorat (LMD), Recherche
Disciplines : Arts du spectacle (cinéma/audiovisuel, théâtre, danse…), Civilisation espagnole et latino-américaine
Auteur(s) : CUESTA José María, BENASAYAG Miguel
Producteur : Université Toulouse II-Le Mirail
Réalisateur(s) : MICHAUD Nathalie
Editeur : SCPAM Université Toulouse II-Le Mirail
Langue : Espagnol
Conditions d’utilisation / Copyright : Tous droits réservés à l’Université Toulouse II-Le Mirail et aux auteurs.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Dans cette comunication, María Luisa Femenías se propose de montrer que « la quête épistémologique constitue une pratique éthique qui surgit et, pour reprendre les termes d’Ana de Miguel, « dans la mesure où la vision structurelle est constituée de la réalité, la vision construite à partir de la simple acceptation du regard hégémonique devient irrationnelle ».
La théorie permet d’appréhender, de voir les objets et par conséquent le féminisme implique la création d’un réseau conceptuel que l’on peut appeler « filtre » pour restituer sa propre construction de la réalité. C’est pour cette raison que nous devons abandonner le regard ingénu qui nous pousse à considérer que la réalité est là, telle que nous le percevons, et devons mettre l’accent sur le sujet connaissant.
Ce qui ne veut pas dire que si toutes les femmes acceptent une vision féministe de la réalité, les résistances face à l’acceptation de nouvelles approches constituent des réponses collectives à des conflits collectifs, résultats des inégalités structurelles et des processus de socialisation hégémonique qui consolident les codes culturels ancestraux et universels structurés à partir de ce qu’il est convenu d’appeler « l’idéologie patriarcale ».
Par conséquent, l’idéologie patriarcale s’érige en filtre parfait des modes de construction des objets -au sens large du terme- et des faits culturels que nous considérons naturels, structurellement cohérents et ontologiquement légitimes. Tous ces éléments expliquent l’importance d’une épistémologie féministe capable d’ôter toute légitimité aux filtres théoriques traditionnels, filtres qui confirment l’infériorité des femmes -et d’autres groupes d’ailleurs- qui considèrent ces femmes comme assujetties ou incompétentes.
Si le féminisme remet en cause la légitimité de ces cadres et de ces filtres, c’est d’abord en tenant compte de la dimension sociale, éthique et politique de la situation générale des femmes qu’il doit le faire car il s’agit d’une véritable problématique, injuste de surcroît. C’est aussi pour identifier les causes de cette situation culturelle, historique, psychologique et économique et déterminer ce que l’on a appelé « attribution de responsabilités ».
Ensuite, c’est également pour pouvoir élaborer des propositions théoriques alternatives . Il ne suffit pas de qualifier la situation d’injuste, il faut aussi démontrer qu’elle n’est pas naturelle ni dépendante d’une ontologie et il faut proposer des alternatives susceptibles de transformer les structures sociales et de les rendre moins conflictuelles. Finalement, il faut rendre cette prise de conscience universelle , ce qui incite à développer une imagination féministe, théorique et pratique, qui rende incontournable la construction d’une société dans laquelle tous les êtres humains puissent bénéficier, sans exception, d’égalité.
A la lumière de ce que nous venons de dire, il convient d’illustrer brièvement ces propos avec trois exemples de différentes époques et de différents domaines de recherche mais de grande importance universitaire et celui de la vie quotidienne. Dans ces trois cas, le regard féministe critique induit des changements profonds.
Le premier exemple correspond à un cas précis de la philosophie aristotélicienne, le second s’appuie sur la recherche collective à laquelle nous participons et où étaient comparés des tests de Rorschach. En troisième lieu, nous nous s’intéresserons à l’hypothèse de Thomas Lequeur concernant le corps humainsles et qui met en avant l’importance du regard féministe. Dans tous ces cas, notre analyse est fondée sur des métalectures critiques dans une perspective de genre et sur des bases épistémologiques féministes. » (María Luisa Femenías).
Voir d’autres conférences sur CanalU
Durée du programme : 67 min
Classification Dewey : Epistémologie, causalité, genre humain, Recherches sur le féminisme
Niveau : niveau Licence (LMD), niveau Master (LMD)
Disciplines : Philosophie contemporaine , Société- Approches transversales et méthodologie
Auteur(s) : FEMENÍAS María Luisa
producteur : Université Toulouse II-Le Mirail
Réalisateur(s) : SARAZIN Claire
Editeur : SCPAM Université Toulouse II-Le Mirail
Langue : Français
Conditions d’utilisation / Copyright : Tous droits réservés à l’Université Toulouse Jean Jaurès et aux auteurs.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
Avec « Les Excès du genre » (éd. Lignes, 2014), Geneviève Fraisse offre une perspective sur la polémique sexe/genre, la critique des stéréotypes et l’usage de la nudité en politique. Avec l’œil critique d’une chercheuse, elle privilégie résolument la généalogie de l’émancipation et l’examen de la tradition philosophique, plutôt que la discussion sur les catégories et les identités. Le concept de « genre », ni simple outil, ni théorie radicale, est un pari philosophique. Philosophie pour distinguer clairement ce qui relève d’un objet de pensée, d’un concept ou d’une théorie.
Et pour toutes disciplines, car l’enjeu est alors de comprendre ses usages : comme un neutre, le genre, comme un pluriel, les genres et, avec ou sans le mot « sexe » ? Aussi, ne l’oublions pas, ce mot est en excès, car ce qu’il traite déborde l’ordre établi.
Conférence organisée par le réseau de master ARPEGE, Université Toulouse – Jean Jaurès – campus Mirail, le 4 novembre 2015.
Voir d’autres conférences sur Canal-U