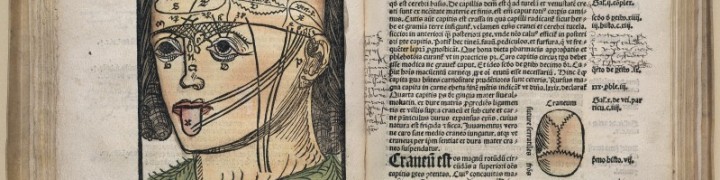Parution – La blessure et la force. La maladie et la relation de soin à l’épreuve de l’auto-normativité
 Philippe Barnier, La blessure et la force. La maladie et la relation de soin à l’épreuve de l’auto-normativité, PUF, 2010, 214 p.
Philippe Barnier, La blessure et la force. La maladie et la relation de soin à l’épreuve de l’auto-normativité, PUF, 2010, 214 p.
Comment la compréhension de la richesse des processus auto-normatifs individuels peut favoriser une revalorisation de l’expérience de la maladie, de la relation de soin, et un épanouissement réciproque du patient et du médecin.
« Philippe Barrier, qui a passé de longues années à faire du diabète son existence même et sa pensée, c’est-à-dire sa force, sa capacité à s’individuer et à être sa blessure, comme disait Joë Bousquet, montre comment la médecine contemporaine en est venue à détruire la relation de soin. Sa démonstration est implacable, magnifique et terrible. Elle donne à voir comment une finalité, prendre soin des malades, se renverse en son contraire : nier leur existence en réduisant celle-ci au contrôle du bon fonctionnement de leurs organes naturels ou artificiels. (…)
Philippe Barrier éclaire du même coup les enjeux d’une question encore bien plus vaste, et les souffrances d’une maladie qui n’est pas seulement celle des corps et des esprits, mais celle du corps social dans son ensemble, celle d’une civilisation que l’on a cru devoir dire “technicienne” – comme si une civilisation pouvait ne pas l’être. » (B. Stiegler, préface)
Introduction
Première partie. — L’épreuve de la maladie
La maladie comme défaut et comme nécessité
Le travail de la maladie (la maladie au travail). La déclaration
Une restructuration de la morbidité
La guérison hallucinée
Vers la difficile conscience de la maladie
La conscience de la maladie comme problème existentiel…
… et comme ressource autorégulatrice
Une double dissimulation
Un processus morbide de relais
L’hypoglycémie comme épreuve initiatique normative. Phénoménologie de l’hypoglycémie
Un processus morbide de relais (suite)
Les représentations négatives de la maladie
L’hyperglycémie comme figure de la morbidité anomique
La marche de la chronicité
Des complications (« la maladie de la maladie ») à la complexité (l’entrecroisement des possibles)
De concepts voisins
Un premier niveau de prise de conscience normative
Ses effets sur le plan représentationnel, émotionnel et affectif
La prise de conscience de la globalité de la normativité de santé
Des impasses au chemin
De la défiance à la confiance ?
Vers le pire et le meilleur
La guérison comme guérison du désir de guérir
Seconde partie. — « Le normal et le pédagogique »
La relation de soin à l’épreuve de l’auto-normativité du patient
Le soin : relationnel et normatif
Le corps soignant comme corps sacerdotal
La tendance « sacralisante » et hétéronomique du discours médical
Le corps muet du patient
L’art médical
La question préalable de la subjectivité
Une relation bipolaire asymétrique
La tension relationnelle évolutive
Chronologie et clinique de la relation de soin
Le cas de la maladie asymptomatique
L’annonce de la chronicité. Une injonction à la subjectivité volontariste
Le modèle relationnel autoritaire (hétéronomique) et ses conséquences
La tentation techniciste médicale
La présentation hétéronomique du traitement
Un accompagnement pédagogique et normatif
L’hypoglycémie dans le suivi médical diabétique
Une propédeutique à l’autogestion de soin
La question de l’autonomie dans la relation de soin
Une autre objection à l’autonomie de santé
Le suivi
Une perspective programmatique allagmatique
La gestion de la temporalité dans la relation de soin appliquée à la maladie chronique
Une objection, sa possible levée
Vouloir, désir
La sensibilité au pathologique, le désir
Une pédagogie du désir ?
Éducation, instruction, apprentissage
Le désir de se bien soigner est-il un objet possible d’instruction et d’apprentissage ?
Un rapport érotique au soin
Le désir de santé
Inappetance
La libération du désir de santé
Quelques libres recettes
Le paradigme de la congruence
Brève synthèse théorétique : la régulation homéostatique globale
Bartleby, le point aveugle du soin
L’auteur est philosophe et docteur en sciences de l’éducation. Bien connu des adeptes de l’éducation thérapeutique à laquelle il forme de nombreux médecins et soignants, il enseigne aussi l’éthique médicale et participe à de multiples colloques et publications sur la philosophie de la santé.
Tags: Philosophie