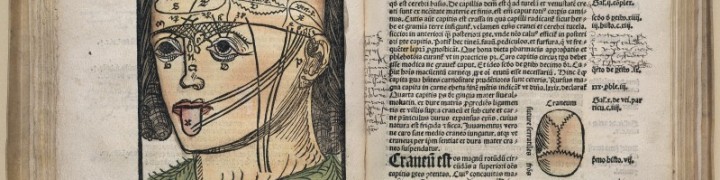Séminaire – Corps, sexualité et travail
Lundi 28 février 2011, de 14h à 16h30
Site CNRS Pouchet : 59, rue Pouchet, Paris 17e
Salle des conférences
L’équipe « Genre Travail Mobilités » (GTM) du laboratoire CRESPPA vous invite à une nouvelle séance de son séminaire public. Cette séance est la dernière d’une série de trois séances ayant pour thème « corps, sexualité et travail » :
« Corps sexualisé et capital beauté : quels effets sur le travail ? »
Invités : Georges Vigarello (Historien, EHESS) ; Jean-François Amadieu (Sociologue, professeur agrégé en Sciences de gestion, Université Paris I Panthéon Sorbonne)
La question de l’apparence physique est assez peu étudiée, notamment lorsqu’elle est liée au travail. Le regard croisé entre ces deux disciplines se propose de l’éclairer. Si des politiques discriminatoires en matière de taille sont régulièrement pratiquées notamment dans la police, on connaît peu de choses sur l’influence de ce que l’on peut qualifier de normes physiques sur le recrutement et les trajectoires professionnelles.
Pierre Bourdieu avait montré dans la distinction, le caractère social de l’apparence physique (1979) et plus récemment, les travaux de Thibaut de Saint Pol ont souligné l’importance de la norme de minceur sur les comportements alimentaires (2010) ; l’augmentation de l’obésité qu’il relève sur le plan statistique depuis le début des années 1980 ne touche pas de façon identique les hommes et les femmes et l’écart entre les catégories socioprofessionnelles s’est fortement accru (2010). Si les corps changent et les morphologies se modifient, on s’interrogera sur les évolutions des apparences valorisées et leur visibilité dans la sphère du travail. Les critères de beauté se modifient également dans le temps, de sorte que pour Georges Vigarello, ils s’inscrivent dans « les grandes dynamiques sociales » (2004, p. 255). Mais, historiquement, les canons de la beauté sont également différenciés en fonction du sexe, « l’histoire de la beauté […] ne saurait échapper à celle des modèles de genre et des identités.’ 2004, p. 11). L’esthétisation des corps féminins s’est longtemps opposée à la notion de travail, travail laborieux et beauté féminine ont été longtemps incompatibles. En s’imposant largement auprès des femmes, comment le travail recompose-t-il la « mise en scène » des
corps masculins et féminins ?
Au début des années 2002, Jean-François Amadieu s’est proposé d’analyser l’influence de l’apparence physique dans les recrutements et les mobilités professionnelles. Tout en se référant à Georg Simmel, il justifie, dès les premières pages de son ouvrage Le poids de l’apparence l’objet de sa recherche de la façon suivante : « Certes, il n’est pas très glorieux de constater que l’une des origines des inégalités réside tout bonnement dans l’apparence des individus. C’est pourtant la vérité : notre corps, notre visage, nos vêtements et notre allure générale jouent un rôle essentiel dans notre destinée. » (2002, p. 11-12). Il poursuit ses recherches notamment dans le cadre de L’observatoire des discriminations dont il est le directeur.
-Sans inscription-
Contacts : Karima Ghembaza : gtm@gtm.cnrs.fr; Sandra Nicolas : sandra.nicolas@gtm.cnrs.fr
Tags: Anthropologie, Etudes Genre, Histoire, Sociologie