La revue Développement durable et territoire lance un appel à texte pour un prochain dossier sur la question de la relation entre santé et environnement. Si l’environnement fait l’objet d’une appréhension et d’une surveillance croissantes et si la médecine se montre de plus en plus performante, le champ de la santé environnementale ne bénéficie pas encore en France d’une appréhension claire et largement partagée tant du point de vue des professionnels de santé que des populations, soulevant des questions complexes, en particulier dans l’extension qu’il implique en matière de santé publique. La juxtaposition des deux termes santé et environnement est en soi objet d’interrogation et de recherche. Les propositions – sous la forme d’une page de résumé – sont attendues pour le 1er décembre 2011.
Si l’environnement fait l’objet d’une appréhension et d’une surveillance croissantes et si la médecine se montre de plus en plus performante, le champ de la santé environnementale ne bénéficie pas encore en France d’une appréhension claire et largement partagée tant du point de vue des professionnels de santé que des populations, soulevant des questions complexes, en particulier dans l’extension qu’il implique en matière de santé publique. La juxtaposition des deux termes santé et environnement est en soi objet d’interrogation et de recherche. Certes, les préoccupations environnementales ont réintroduit la question de la relation entre la santé des individus et des populations humaines et le monde physique et biologique qui les entoure, entre la nature et l’homme (Fromageau, 2009), mais celle-ci est essentiellement portée par l’évolution des connaissances dans les domaines de l’épidémiologie et de la toxicologie et les dynamiques internationales de la recherche. Le vécu, le mal-être des populations reste mal appréhendé et pris en compte, celles-ci sont encore largement livrées à elles-mêmes comme l’ont mis en évidence des problématiques comme la qualité de l’air ou les grandes crises sanitaires, de l’amiante à l’ESB, ou plus largement la thématique de la société du risque…
En tant que champ spécifique d’évaluation et de gestion de risques, la notion de santé-environnement a émergé en France avec retard, suivant la dynamique engagée au plan international, dans le cadre de la démarche de l’OMS d’incitation à l’élaboration de Plans Nationaux de Santé Environnementale, d’où sont nés le deux plans nationaux santé environnement français. Cette émergence tardive est liée à l’arrivée elle-même tardive de la notion d’environnement dans le monde français (dans les années soixante, prenant la suite de celle de milieu) et à la disjonction à peu près complète au plan institutionnel entre cette notion, essentiellement associée à la nature, et le monde de la santé, lié au médical au sens d’intervention thérapeutique, peu axé sur la santé publique en termes de prévention, renvoyant à la longue histoire de la tradition médicale et sanitaire française. Mais la difficulté tient aussi à ce que la réalité contemporaine appelle un regard sans cesse renouvelé face à des enjeux en évolution et en extension constantes et requiert une confrontation réactualisée en permanence des points de vue de l’ensemble des parties prenantes et acteurs concernés, mal circonscrite en France, tant au plan des idées qu’à celui des pratiques. C’est à la promotion de ce renouvellement qu’aspire cet appel à contributions de la revue DD&T.
Du point de vue sémantique, le français hésite entre santé environnement et santé environnementale, ce dernier terme étant étroitement assimilé selon certains à la notion de santé publique. La question de la signification de la notion de santé et de ce qu’elle véhicule au plan de l’intervention collective, apparaît ici centrale. Son articulation avec l’environnement souligne la continuité des liens qui associent entre eux l’ensemble des organismes vivants et le substrat physico-chimique qui a permis leur émergence mais aussi la dimension aléatoire de cette relation. « Si le droit de l’environnement se donne pour objectif la protection de la totalité de l’environnement, il contribuera au maintien de conditions sanitaires satisfaisantes pour le genre humain, mais l’inverse ne produirait pas les mêmes effets » souligne Chantal Cans (2009). Il est donc dans l’intérêt de tous de concevoir un droit de l’environnement qui ne soit pas exclusivement anthropocentré. De même, gardons-nous de réduire l’environnement à son aspect sanitaire (Romi, 2009).
Si l’environnement constitue une ressource vitale, il n’est pas dénué de risques ou de contraintes, démultipliées par sa plasticité aux impacts des actions humaines capables d’en altérer massivement les caractéristiques et les fonctionnalités. Les connaissances sur la nature des risques, les capacités d’analyser leurs effets et d’évaluer leurs impacts ont considérablement progressé au cours des dernières décennies grâce à la mise au point d’outils d’investigation, de mesurage et d’analyse spécifiques et au développement d’approches méthodologiques originales, adaptées à ce nouveau champ de recherche. Ces progrès cognitifs ont permis de mieux cerner la notion de responsabilité et son attribution complexe dans la « société du risque ».
Cet accroissement des connaissances, indéniablement utile pour l’aide à la décision et à la gouvernance politique des risques, trouve cependant une limite dans la persistance, voire l’accroissement de l’incertitude inhérente à l’observation scientifique, démultipliée par la complexité des enchaînements et des effets au plan collectif. Les limites de l’expertise dans ces domaines imposent des dynamiques de décision et d’action pragmatiques et flexibles, susceptibles d’évoluer rapidement et de façon importante en fonction des progrès des connaissances (principe de précaution), renouvelant les cadres d’action. Il est illusoire d’attendre d’être en possession de certitudes pour agir. En tout état de cause, la connaissance experte n’est pas le seul levier de l’action, les populations, directement concernées, ont également de façon croissante vocation à se situer et intervenir face aux résonances nouvelles de ces questions.
D’autant que les rapports entre la santé environnementale, l’évaluation et la gestion du risque relèvent de jeux d’acteurs complexes, au sein desquels le public prend une place croissante, directement mais aussi indirectement, en particulier en ce qui concerne la confiance. Parallèlement aux avancées de la connaissance et au renforcement des prises en charge politiques, le regard porté par l’opinion sur la place de la santé environnementale dans les enjeux de société et la perception qu’elle a des mécanismes de l’impact sanitaire des activités et comportements humains ont fortement évolué. Les préoccupations de santé environnementale s’expriment à travers le filtre de facteurs socio-économiques, socio-techniques et socio-éducatifs encore insuffisamment analysés et pris en compte. L’histoire joue un rôle majeur dans l’appréhension par la conscience collective et le monde de la santé de l’irruption de pathologies mettant en cause les développements techno-scientifiques, notamment dans le domaine de la chimie. On peut rappeler à ce propos la façon dont, aux Etats-Unis, l’univers du travail a permis aux ingénieurs sanitaires d’identifier l’action délétère d’un certain nombre de composés utilisés en milieu professionnel, à l’origine de pathologies spécifiques, et donc leur rôle dans le développement de la santé environnementale.
Ces problématiques nouvelles interpellent des acteurs institutionnels, économiques, politiques, associatifs, ainsi que des chercheurs appartenant à de nombreuses disciplines différentes des sciences du vivant, de la santé et des sciences sociales. Les contributions sollicitées peuvent être théoriques mais aussi pratiques relatant des expériences diverses.
Trois approches seront privilégiées
1) La question de la relation entre santé et environnement.
En France, la santé environnementale ne va pas de soi, elle ne dispose pas de relais sociaux véritablement reconnus. La période récente a tendu à en effacer la mémoire antérieure, ce qui n’est pas sans lien avec les scandales sanitaires à répétition qui ont marqué les années 90, en particulier l’amiante, alors que la population ressent au contraire très fortement la réalité de cette question, qui pour elle n’est pas prise en considération. Cela impose d’en éclairer les arrière-plans et pour cela de recourir à des comparaisons avec d’autres pays où ce champ jouit d’une reconnaissance collective beaucoup plus forte. Nous souhaitons ouvrir la voie à une approche qui fasse ressortir le caractère nouveau et encore mal consolidé de la thématique de la santé environnementale, le fait qu’elle ne dispose en France que d’une base institutionnelle et scientifique étroite et reste mal appréhendée, en dehors de cercles spécialisés, ce qui ne veut pas dire que la notion n’ait pas de sens. Manque la capacité à l’inscrire fortement dans une trame collective éprouvée et partagée. Des éclairages historiques, épistémologiques, sociologiques et socio-psychologiques sur ces questions sont particulièrement bienvenus.
2) Les mutations du droit de l’environnement sous l’effet des préoccupations sanitaires
Parce que les questions d’environnement et de santé sont aujourd’hui particulièrement liées on serait tenté de croire que ces deux droits régissent un seul domaine spécifique lié à une prise de conscience accrue illustrée par les notions de droit à un environnement sain, de droit à la santé ou à la qualité. Or il n’en est rien puisqu’ils régissent des registres séparés qui s’enrichissent progressivement. Reste à mesurer leur degré de pénétration réciproque. Ceci étant, les termes de « santé » et « environnement » n’étant pas juxtaposables et ne recouvrant pas prioritairement les mêmes objectifs, cette entreprise s’avère délicate. En définitive le droit de l’environnement et le droit de la santé publique seraient-ils en concurrence ou complémentaires ? A titre d’exemple, Isabelle Doussan (2009) a montré que dans le domaine de l’eau, la protection accordée à l’eau par le droit de l’environnement à travers notamment ses objectifs de protection de la ressource naturelle, en dehors des préoccupations sanitaires, est une protection « au rabais », « a minima », qui ne vient qu’en second. De même, à l’instar de Chantal Cans (2009), on reste perplexe quant à la portée réelle de certaines dispositions incorporées dans le code de l’environnement, à caractère plus politique que juridique. Pourtant certaines de ces dispositions proclamatoires, destinées à encadrer les politiques publiques ne serviraient-elles pas à justifier le recentrage du droit de l’environnement sur des préoccupations humaines ? Dans cette logique, n’y a-t-il pas le risque que le droit de l’environnement soit réduit à une « excroissance » du droit de la santé ? En effet, la mise en œuvre de certains principes du droit de l’environnement comme le principe de précaution, concept éminemment environnemental, trouve-t-il à s’appliquer en d’autres domaines qu’en matière de santé ? Aussi, quelle pourrait-être à terme la légitimité du droit de l’environnement ?
3) Les nouvelles interrogations et les nouvelles dimensions dans le traitement des questions de santé environnementale.
Les sociétés sont aujourd’hui confrontées à la complexité des choix à opérer, soulevant de nouvelles interrogations qui pourront faire l’objet de contributions à ce numéro : seront privilégiées les articles interrogeant les relations entre santé et environnement. Seront donc exclus les approches centrées sur un thème unique.
Les questions sociales et environnementales sont étroitement imbriquées et supposent des réflexions nouvelles sur la complexité et sur son appréhension à travers les prismes des disciplines multiples qui débordent le champ classique de la rationalité scientifique, du champ de la santé aux sciences sociales. A titre d’exemple, on citera :
Les normes d’exposition aux nuisances environnementales, établies polluant par polluant, ne répondant pas aux problématiques actuelles d’exposition simultanée à de multiples polluants, notamment en matière d’air intérieur, qui nécessiteraient une approche intégrée dont il est pratiquement impossible de définir à l’heure actuelle les modalités.
Le développement de nouvelles filières technologiques, mettant en œuvre notamment des nanoparticules ou des ondes électromagnétiques, laisse entrevoir l’émergence de nouveaux risques, dont les conséquences, encore inconnues, suscitent préoccupations et méfiance, même si ces techniques répondent aux demandes de la population et peuvent être porteuses de progrès de toutes sortes.
- L’acceptabilité des risques en matière de santé environnementale par la population se heurte à des réalités sociales, culturelles et économiques, en particulier à une culture massive du « risque zéro », dont on peut interroger l’origine.
- L’irruption des enjeux du changement climatique rend les actions locales et nationales tributaires de l’échelle planétaire
- Les ambiances urbaines, depuis la théorie des miasmes ancêtre de la santé environnementale, font l’objet d’investigations nombreuses interrogeant les logements, l’urbanisme et les modes de transports pour s’approcher de la notion quelque peu utopique de ville durable ;
- si la santé environnementale est considérée a priori sous l’angle de l’action de l’environnement sur l’homme, l’homme victime est aussi responsable dans la mesure où il transforme son environnement pour satisfaire ses besoins et contribue ainsi dans une large mesure à sa dégradation. Les crises actuelles impliquent aussi bien les comportements que l’éthique individuelle ou collective et les choix techniques. L’action publique, qui s’exerce à travers la normalisation, la réglementation et l’incitation, est-elle adaptée, acceptable et suffisante ? Comment la responsabilité citoyenne peut-elle se concrétiser, aux niveaux individuel et collectif ?
- Enfin, comment l’écosystème peut-il s’adapter à des activités humaines qui exercent sur la planète une pression de plus en plus forte ? En retour, comment les hommes peuvent-ils s’adapter à ces bouleversements de l’environnement ? Les capacités d’adaptation peuvent être très inégales selon les conditions de vie de chacun. Comment maintenir l’égalité dans une société où la préoccupation environnementale peut constituer dans certains cas, si elle est mal définie et contrôlée, une source significative d’inégalités ?
Modalités de soumission
1. Envoi d’une proposition sous forme de résumé d’une page aux 3 adresses électroniques suivantes :
- Helga Scarwell : Helga.Scarwell@univ-lille1.fr,
- Isabelle Roussel : isaroussel169@sfr.fr
- Lionel Charles : lio.charles.fractal@noos.fr
pour le 1er décembre 2011.
2. Réponse de la revue Développement Durable & Territoires à cette proposition pour le 15 janvier 2012
3. Demande du texte complet pour 15 mars 2012 – les conditions éditoriales sont précisées sur le site de la revue http://developpementdurable.revues.org/document1269.html (Merci de bien suivre les recommandations !).
4. Mise en ligne au cours du dernier trimestre 2012.
Contact
- Helga-Jane SCARWELL
courriel : Helga [point] Scarwell (at) univ-lille1 [point] frLaboratoire TVES – UFR de Géographie et d’Aménagement Université de Lille 1 – Sciences et Technologies de Lille 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
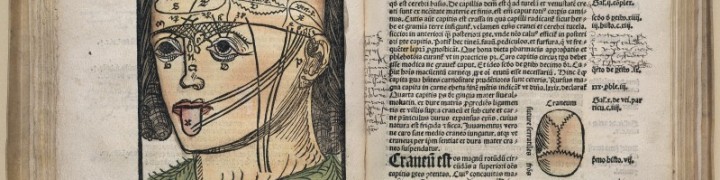
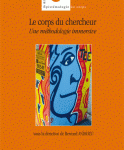
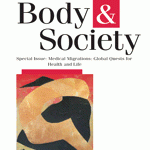

 Journée d’étude – L’éclatement des dispositifs de santé mentale. Regards croisés France-Angleterre
Journée d’étude – L’éclatement des dispositifs de santé mentale. Regards croisés France-Angleterre