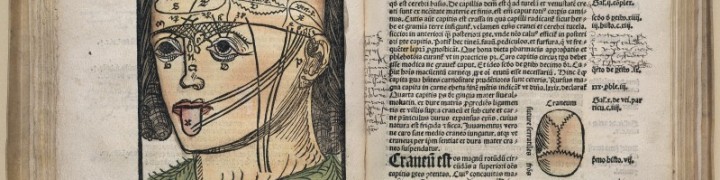Samedi 31 mars 2012 | Marseille (13003)
The colloquium is organized by the UMR 6012 ESPACE, a research team from the Department of Geography of the Aix-Marseille University. After the success of the first edition, our ambition is to provide every two years the opportunity for doctorants, postdoctorants, researchers and public health professionals to present their original research dealing with the spatial aspects of health and health care issues. Special attention is given to quantitative approaches in this field, either related to observational or theoretical studies.
ANNONCE
The colloquium is focusing on the changes that both health geography and spatial epidemiology are experiencing. The specificity of these fields is to integrate knowledge about how the physical and social environment and spatial interactions can determine health and health care issues. Spatial modelling, enriched by new sources of geographical information, tend to become a major tool to understand the complexity of these issues. Conceptually, three main stages can be outlined.
Topics of interest include, but are not limited to:
Theme 1: from fieldwork to data
- Spatial sampling
- Health monitoring systems
- Remote sensing for environmental monitoring
Theme 2: observational studies and spatial analysis
- Landscape epidemiology
- Health risk mapping
- Space-time clustering
- Spatial statistics
- Multilevel statistical modelling
Theme 3: dynamic modelling and simulation
- Health services simulation
- Epidemic equation-based modelling
- Epidemic individual-based/network-based modelling
Important Dates:
Deadline for abstract proposal: March the 31st, 2012
- Acceptance Notification: May the 1st, 2012
- Colloquium registration: May the 31st, 2012
- Payment (last deadline): July the 10th, 2012
Scientific Committee:
- Prof. Matthew BAYLIS, Veterinary Epidemiologist, University of Liverpool
- Prof. Pierre CHAUVIN, Social Epidemiologist, INSERM UMR S 707 / Pierre and Marie Curie University
- Dr. Etienne CASSAGNE, Geographer / Bioclimatologist, University of Bourgogne
- Dr. Hélène CHARREIRE, Geographer, Paris Est Créteil Val-de-Marne University
- Dr. Eric DAUDE, Geographer, CNRS / University of Rouen
- Dr. Sébastien Fleuret, Geographer, CNRS / University of Angers
- Dr. Sandra PEREZ, Geographer, University of Nice Sophia Antipolis
- Dr. Hugo PILKINGTON, Geographer, University of Vincennes in Saint-Denis / INSERM U953
- Prof. Denise PUMAIN, Geographer, University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne
- Dr. Stéphane RICAN, Geographer, Paris West University Nanterre La Défense
- Dr. Benjamin ROCHE, Biomathematician, IRD / Pierre and Marie Curie University
- Prof. Gérard SALEM, Geographer, Paris West University Nanterre La Défense / IRD
- Prof. Alain SANDOZ, Geographer, Tour du Valat / Aix-Marseille University
- Prof. Marc SOURIS, Computer scientist, IRD / Asian Institute of Technology
- Dr Florian TOLLE, Geographer, University of Franche-Comté
- Dr Julie VALLEE, Geographer, CNRS / University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne
Local Organizing Committee: UMR 6012 ESPACE
- Dr. Frédéric AUDARD, Aix-Marseille University
- Marion BORDERON, Aix-Marseille University
- Dr. Vincent LAPERRIERE, Aix-Marseille University
- Dr. Sébastien OLIVEAU, Aix-Marseille University
- Dr. Sandra PEREZ, University of Nice Sophia Antipolis
Submission Procedure:
Abstract must be sent in English.
It should contain a title, name of the author(s), their institution(s) and an abstract of about 2500 characters.
A specific abstract format is downloadable on the website : http://gsite.univ-provence.fr/gsite/Local/healthandspace/dir/user-3630/Text/TemplateH&S_abstract.doc
Contact
- Marion Borderon
courriel : marion [point] borderon (at) univ-provence [point] frAix-Marseille Université
29 avenue R. Schuman
Aix-en-Provence
13621 Cedex1
France - Vincent Laperrière
courriel : vincent [point] laperriere (at) univ-provence [point] frAix-Marseille Université
29 avenue R. Schuman
Aix-en-Provence
13621 Cedex1
France