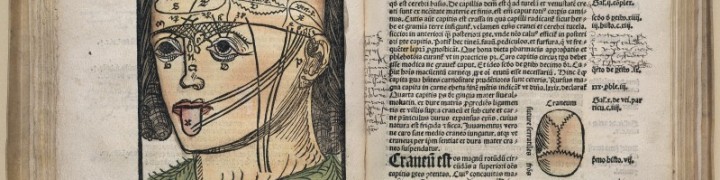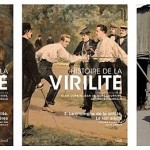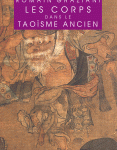You are currently browsing the archive for the Parutions category.
Tags: Histoire
Parution – The journal of medicine and philosophy
The journal of medicine and philosophy, vol 36, n°4, aout 2011, CHARLES TAYLOR AND THE PHILOSOPHY OF MEDICINE
Franco A. Carnevale and Daniel M. Weinstock, Questions in Contemporary Medicine and the Philosophy of Charles Taylor: An Introduction
Hubert L. Dreyfus, Medicine as Combining Natural and Human Science
Patricia Benner, Formation in Professional Education: An Examination of the Relationship between Theories of Meaning and Theories of the Self
Gilles Bibeau, What Is Human in Humans? Responses from Biology, Anthropology, and Philosophy
Carl Elliott, Enhancement Technologies and the Modern Self
Natalie Stoljar, Informed Consent and Relational Conceptions of Autonomy
Ronald A. Carson, On Metaphorical Concentration: Language and Meaning in Patient-Physician Relations
Dawson Stafford Schultz and Lydia Victoria Flasher, Charles Taylor, Phronesis, and Medicine: Ethics and Interpretation in Illness Narrative
Laurence J. Kirmayer, Multicultural Medicine and the Politics of Recognition
Daniel M. Weinstock, How Should Political Philosophers Think of Health?
Charles Taylor, Franco A. Carnevale, and Daniel M. Weinstock, Toward a Hermeneutical Conception of Medicine: A Conversation with Charles Taylor
Tags: Etudes des sciences, Philosophie
Parution – Histoire de la virilité
CORBIN Alain, VIGARELLO Georges et COURTINE Jean-Jacques (dir.), Histoire de la Virilité, 3 tomes, Paris, Seuil, 2011.
La virilité possède une tradition immémorielle : elle n’est pas simplement le masculin, mais sa nature même, sa part la plus « noble ».
La virilité serait vertu. Elle viserait le « parfait », fondant sur un idéal de domination masculine une des caractéristiques des sociétés occidentales. Une puissance a été inventée, de la force physique au courage moral, imposant ses codes, ses rituels, sa formation.
Tradition plus complexe pourtant, elle ne saurait en rien figer la virilité dans une histoire immobile. Les qualités se recomposent avec le temps. La société marchande ne saurait avoir le même idéal viril que la société militaire. Le courtisan ne saurait avoir le même idéal viril que le chevalier. La cour et la ville inventent des modèles décalés. Ce sont ces différences et ces changements que retrace ce premier volume, de l’Antiquité jusqu’aux Lumières, introduisant de l’histoire dans ce qui semble ne pas en avoir.
Tradition sévère aussi, la perfection serait toujours menacée de quelque insuffisance : la force ne peut ignorer la fragilité. Reste une rupture marquante avec les Lumières : celle visant la domination elle-même. Une virilité nouvelle s’y affirme. L’ancienne ascendance est condamnée, les pères peuvent apparaître en « tyrans », alors même que rien ne conteste encore la domination sur le féminin.
La période concernée par ce deuxième volume correspond à l’emprise maximale de la vertu de virilité. Le système de représentations, de valeurs et de normes qui la constitue s’impose alors avec une telle force qu’il ne saurait être véritablement contesté.
La multiplication des lieux de l’entre-soi masculin ? le collège, le pensionnat, le séminaire, le caveau de la société chantante, le bordel, la salle de garde, la salle d’armes, le fumoir, nombre d’ateliers et de cabarets, en attendant la réunion politique et la société de chasse ? constituent autant de théâtres de l’inculcation et de l’épanouissement des traits qui dessinent la figure de l’homme viril.
Au XIXe siècle, la virilité, qui a partie liée avec la mort ? mort héroïque sur le champ de bataille ou le pré carré du duel, mort provoquée par la fatigue du travailleur, mort d’épuisement de l’homme par la femme ? ne constitue pas une simple vertu individuelle. Elle ordonne, irrigue la société dont elle sous-tend les valeurs. Elle induit des effets de domination. Elle structure la représentation du monde.
En ce début de XXIe siècle, la rumeur enfle en Occident : les hommes ne seraient plus des hommes, des « vrais ». De ce malaise dans la part masculine de la civilisation, la virilité reste un indicateur crucial. Car c’est bien sur cet idéal de force physique et de puissance sexuelle, de maîtrise et de courage que s’est historiquement construit dans la culture ce qui passe pour la « nature » de l’homme. Et demeure le socle la domination masculine.
Or une crise se propage, semble-t-il, dans l’Empire du mâle : les carnages guerriers ont élimé l’étoffe des héros, le retour cyclique des dépressions économiques érodé la fierté du travailleur, la montée des conformismes tari les goûts d’aventure. L’éveil et les progrès de l’égalité entre les sexes, les avancées du féminisme sont venus contester d’anciens privilèges et d’inacceptables violences.
Il y a donc un paradoxe de la virilité contemporaine : comment comprendre que cette représentation hégémonique de la puissance masculine ait fini par apparaître aussi incertaine ? Les hommes d’aujourd’hui entendent-ils porter longtemps encore cette charge millénaire, ou vont-ils souhaiter sentir s’en alléger le poids ? Quitte à renoncer à ses avantages…
Tags: Anthropologie, Arts, Ethnologie, Etudes Genre, Histoire, Histoire de l'art, Littérature, Philosophie, Psychologie, Sociologie
Parution – Journal of the history of medicine and the allied science
 Journal of the history of medicine and the allied science, vol 66, n°4, octobre 2011
Journal of the history of medicine and the allied science, vol 66, n°4, octobre 2011
Justin Barr, A Short History of Dapsone, or an Alternative Model of Drug Development
Jeremy A. Greene, What’s in a Name? Generics and the Persistence of the Pharmaceutical Brand in American Medicine
Penelope Gouk and Ingrid Sykes, Hearing Science in Mid-Eighteenth-Century Britain and France
Laurence Esterle and Jean-François Picard, Between Clinical Medicine and the Laboratory: Medical Research Funding in France from 1945 to the Present
Tags: Histoire
Les textes du taoïsme ancien ne dissertent pas dans l’abstrait du corps humain. Sous la forme de fictions et de fables, ils mettent en scène ses usages possibles, ses ressorts et ses ressources : un ancien condamné, amputé d’un pied pour ses crimes, rudoie le Premier ministre au sortir de leur cours de méditation, et lui en remontrer sur la notion de vertu. Un ermite malicieux rembarre un aspirant à la sagesse, en se piquant de refuser les « gueules cassées » produite en série par l’éducation confucéenne. Le maussade et concupiscent seigneur de Wei retrouve soudain le sourire à l’écoute des propos d’un reclus des montagnes, venu l’entretenir de chiens et de chevaux galopant librement « dans les steppes du non-être ». Les prouesses de l’archer Lié-tseu sont réduites à rien par Comte Obscur, qui lui enseigne « le tir du non-archer ». On voit défiler dans les premiers écrits taoïstes, le Tchouang-tseu et le Lié-tseu, les figures les plus admirées et les plus détestées de la société chinoise, du gentleman plein de prestance, rompu aux civilités d’apparat, jusqu’au paria hideux et querelleur. Comment l’éthos taoïste parvient-il à discourir du sage en se dispensant de notions morales, en pensant la sagesse comme un régime de puissance, en l’associant à l’ampleur de l’espace, au travail de l’imagination, à l’œuvre du Ciel? Par une apparence de paradoxe, ce sont les corps infirmes, les créatures informes, les êtres les plus infâmes qui jouissent d’une affinité de fond avec le Tao, le Principe qui régit le cours des êtres et des choses.
Introduction
Convention de lecture
Chapitre 1 : Corps olympique, corps taoïste
L’apathie toute puissante du coq de combat
L’athlète ès insectes
Le despotisme occidental
L’archer sur la falaise
Nageur de piscine, nageur de cataractes
La fabrication industrielle des athlètes
Chapitre 2 : La complétude des amputés. Réflexions sur la loi, le rite et les parias en Chine ancienne
Quand les amputés empiètent
La protection vigilante de l’intégrité physique
L’exploitation politique de la valeur d’intégrité du corps
La mise à parité des corps dans le Tchouang-tseu
L’entorse au rituel de l’unipède
Dramatis personae
Au fond du conflit
Nouvelle scène de la vie des châtiés : Mont-Paisible Sans-orteils morigène Confucius
L’amputé de la face tenant tête à l’ermite
Conclusion : Mutation et Mutilation
Chapitre 3 : Persuasion à la pointe de l’épée : l’imagination thérapeutique en action
La trame du drame
Personnages en présence
La rêverie exaltante sur l’arme absolue
L’épée du seigneur et la puissance moralisée
Et le roi tomba des nues : de la séduction à la réduction
Le final tragi-comique
Un essai d’interprétation. Défense et illustration de la ruse
Le rôle thérapeutique de l’imagination
Deux modèles concurrents de persuasion
Conclusion
En guise de colophon
Chapitre 4 : Deux ermites en miroir ou la poétique au service du politique
De l’audience à l’écoute
Parade de chiens et de chevaux
Les vertus curatives de l’imagination
Le cogito imaginant
L’allégorie de l’exilé
Quatre leçons de ténèbres
Chasse aux démons, ruses poétiques
Apostille sur l’art des images et le storytelling.
Chapitre 5 : Chaos ou Cosmos
L’envol de la fiction
L’éloge de la libre échappée et son ressort éthique
Les vertus thérapeutiques de l’espace
L’orthodoxie confucéenne et les lettrés rebelles. Réflexions sur la descendance du Tchouang-tseu au cours de l’antiquité tardive
Épilogue
Annexe. Portrait de Confucius en taoïste
Bibliographie des œuvres en langues occidentales
Bibliographie des œuvres en langue chinoise, ancienne et moderne
Glossaire des termes et des noms mentionnés
Résumé des cinq chapitres et de l’annexe
Index des notions
Index des principales histoires du Tchouang-tseu et du Liè-tseu traduites et commentées
Index des principaux auteurs et personnages cités
Tags: Anthropologie, Ethnologie, Histoire, Littérature, Philosophie
Le colloque « Les cultures des sciences en Europe. Volet 2 : dispositifs, publics, acteurs et institutions » s’inscrit dans le cadre d’une manifestation à deux volets initiée dans le grand Est de la France par des laboratoires coopérant au même projet, le Centre de recherches sur les médiations (CREM – UPVM, Nancy 2, UHA) et le Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication (LISEC – UDS, Nancy 2, UHA). Ce colloque abordera les enjeux politiques de la culture scientifique, les volontés d’acteurs, la manière dont les institutions s’impliquent, les objectifs poursuivis. Une importance toute particulière sera accordée à l’équilibre qu’il s’agit de mettre en œuvre entre les programmatiques européennes et les spécificités des histoires, des traditions et des innovations en ce domaine.
ANNONCE
Colloque international « Les Cultures des Sciences en Europe. Volet 2 : dispositifs, publics, acteurs et institutions », Strasbourg, les 13, 14 et 15 octobre 2011.
Organisé par :
- Le Centre de recherche sur les médiations (CREM – EA 3476) (Université Paul Verlaine-Metz, Université Nancy 2, Université de Haute-Alsace)
- Le Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication (LISEC – EA 2310) (Université de Strasbourg, Université Nancy 2, Université de Haute-Alsace)
Le premier volet du colloque : « Dispositifs en pratique », s’est tenu à Nancy, au PRES de Lorraine, les 10-11 février 2011. Ces contributions et débats ont mis en lumière les caractéristiques pratiques des dispositifs de culture des sciences et des techniques sur le plan national, régional et européen (l’appel à communication concernant ce premier volet, ainsi que le programme détaillé sont consultables sur le site : http://culturesdessciences.fr). Des pistes fructueuses ont ainsi été ouvertes. La question des dispositifs a été illustrée et discutée, qu’il s’agisse des dispositifs de débats publics ou permettant l’engagement des citoyens, de l’émergence de dispositifs particuliers (spectacles, séries TV, serious games…) ouvrant sur des mises en scène originales de la science et des technologies : ces exemples démontrent la vivacité des cultures des sciences et la créativité en ce domaine. Par ailleurs, les confrontations de significations différentes, portées par divers acteurs (politiques, experts, scientifiques, praticiens, publics…) sont apparues comment autant d’enjeux dont il est, aujourd’hui plus que jamais, important de tenir compte.
Prenant appui sur ces résultats ainsi que sur le dossier consacré au même sujet dans la revue Questions de Communication (Vol. 17, « Les cultures des sciences en Europe »), Ce second volet du colloque désire à la fois ouvrir de nouvelles perspectives et approfondir certaines hypothèses. D’une part, la question des publics, de leurs positionnements dans les – et par rapport aux – dispositifs, de la manière dont ils se conçoivent comme acteurs (et non seulement la manière dont les initiateurs des dispositifs les conçoivent en tant que « citoyens scientifiques »), paraît cruciale. D’autre part, la dimension européenne et les problématiques qu’elle induit, doivent elles-aussi être creusées. Ainsi, le colloque de Strasbourg abordera les enjeux politiques de la culture scientifique, les volontés d’acteurs, la manière dont les institutions s’impliquent, les objectifs poursuivis.
Cette manifestation désire aller au-delà du simple état des lieux des pratiques de médiation en matière de cultures scientifiques en Europe, et adresser un certain nombre de questions relatives aux politiques, aux présupposés et aux pratiques en matière de culture des sciences et des techniques.
Lieux des conférences : Maison des Sciences de l’Homme Alsace (MISHA – Tram C, arrêt « Observatoire » – Allée du Gnl Rouvillois) / Palais Universitaire (Tram C, arrêt « Gallia » – Place de l’Université)
Programme du colloque
Jeudi 13 octobre 2011 – Maison des Sciences de l’Homme
8h30 – 9h / Accueil des participants
9h – 9h30 / Discours d’ouverture
9h30 – 10h15 / Conférence inaugurale
10h15 – 11h / Session de poster
- Blanka Jergović, University of Zagreb and Croatian Radio Television (Hr), Public Understanding of Science in Croatia.
- Anthony Tchekemian et Léo Casagrande, Laboratoire CERPA, Université de Lorraine (Fr), Gouvernance, innovation territoriale et aménagement durable : Living Lab et outils Open Source pour les acteurs des territoires de demain.
- Taïna Cluzeau, Observatoire de Paris (Fr), La situation des guides scientifiques en France et en Italie : Moins qu’un métier, une passion !
11h – 11h 30 / Pause café
11h30 – 13h / Session 1. Démocratiser les sciences : quels acteurs, quels enjeux, quels usages ?
- Mélissa Lieutenant-Gosselin, Université Laval (Ca), Pratiques de démocratisation des sciences : proposition d’un cadre d’analyse.
- Gloria Awad, Université d’Artois (Fr), Sciences et « durabilité » : logiques des représentations des acteurs.
- Frédéric Clément, CREIDD, Université de Technologie de Troyes (Fr), L’usage militant du savoir : développements théoriques fondés sur des aspects sociologiques et didactiques.
13h – 14 h / Pause déjeuner
14h – 15h30 / Session 2. Science et citoyens : les conditions d’un dialogue
- Philippe Solal, INSA Toulouse (Fr) et Béatrice Jalenques-Vigouroux, LASCO, Université Catholique de Louvain (Be), Etude des perceptions, des discours et des formes de médiation concernant les risques liés aux nanotechnologies.
- Alain Bovet, Institut Marcel Mauss, EHESS, Paris (Fr), Processes of depoliticisation in the controversies on nanotechnologies in the United Kingdom and France.
- Sylvie Bresson Gillet, UFR Ingémédia, Université du Sud Toulon Var (Fr), La citoyenneté scientifique sous tutelle de la Commission nationale du débat public ?
15h30 – 16h / Pause café
16h – 17h30 / Sessions parallèles
Session 3. Médecine et médias : quelles valeurs, quels repères pour les citoyens ?
- Anne Masseran, CREM, Université de Strasbourg et Philippe Chavot, LISEC, Université de Strasbourg (Fr), Lorsque la technomédecine change la vie : compatir, admirer… puis intégrer ? L’inscription des publics dans la mise en scène télévisuelle de la greffe de visage.
- Pilar Paricio Esteban, Francisco Núñez-Romero Olmo et Cristina Rodríguez Luque, Department of Audiovisual Communication, Advertisement and Public Relations, Cardinal Herrera University (Es), Health and scientific perspective in media coverage about drugs in the Spanish press. El País, El Mundo, Abc and La Razón (2010).
- Elisabeth Bacon, Inserm, Strasbourg (Fr), Les Benzodiazépines : outils thérapeutiques et/ou « monstres » médiatiques ?
Session 4. Sciences et cultures, regard historique
- Marie Musset, ENS de Lyon (Fr), Pluralités des rapports aux savoirs : place et rôle des manuels de littérature (1902-2007) dans la construction du rapport à la science.
- Guillaume Carnino, EHESS, Centre Alexandre Koyré, Paris (Fr), La Science pour tous. Culture savante et science populaire de 1850 à 1900.
- Alda Correia, Departament of Modern Languages, Literatures and Cultures, New University of Lisbon (Pt), Self comes to mind ‒ Interactions between science and culture.
20h / Soirée flamekeuche
Vendredi 14 octobre 2011 – Maison des Sciences de l’Homme
9h – 11h / Session 5. Autour des dispositifs d’hybridation des savoirs dans l’espace public
- Florence Rudolf, Equipe Architecture, Morphologie/Morphogenèse Urbaine et Projet, INSA Strasbourg (Fr), Un dispositif de démocratisation des œuvres architecturales et des projets urbains.
- Agnès Weill, CREM, Université de Nancy 2 (Fr), Le Comité local d’information et de suivi (CLIS) de Bure (Meuse) : un acteur original dans l’information sur la gestion des déchets nucléaires.
- Agnès d’Arripe, LASCO, Université Catholique de Louvain (Be) et Cédric Routier HaDePaS, Institut Catholique de Lille (Fr), Les chercheurs aux prises des règles communicationnelles des professionnels : enjeux de la collaboration au sein d’un SAMSAH.
- Irina Moglan, Agnès Alessandrin et Anne-Marie Houdebine, Faculté des Sciences humaines et sociales, Université Paris Descartes (Fr), De l’éthique participative: médiation dialogique entre SHS et consommateurs.
11h – 11h30 / Pause café
11h30 – 13h / Session 6. Des espaces publics européens pour la culture des sciences, hier et aujourd’hui
- Fernando Clara, Department of Modern Languages, Literatures and Cultures, New University of Lisbon (Pt), ‘German Science’ in Portugal 1933-45: Actors, Institutions, Policies.
- Monica Carvalho, Institut de Bioéthique, Université Catholique Portugaise (Pt), La construction des discours autour de l’engagement public dans la science: étude sur des projets de recherche européens en cours.
- Valentina Pricopie, Institut de Sociologie, Académie Roumaine (Ro), Concepts et acteurs de la communication communautaire pour un espace public européen émergent.
13h – 14h / Pause déjeuner
14h – 15h30 / Sessions parallèles
Session 7. Produire une culture scientifique et technique ? Nouveaux et anciens dispositifs
- Michael Palmer, CIM, Université Paris 3 (Fr), Publics, citoyens ou acteurs ? Définitions, auto-définitions et positionnements.
- Florence Riou, Centre François Viète d’Histoire des sciences et des techniques, Nantes (Fr), Le cinéma dans l’entre-deux-guerre : au coeur des enjeux d’une nouvelle culture scientifique.
- Pascal Robert, Université Paul-Valéry, Montpellier (Fr), Les revues de micro-informatique sont-elles porteuses d’une « culture technique » de l’informatique ?
Session 8. Déplacement d’expertise : lieux et acteurs
- Marc Bassoni, IRSIC, Ecole de Journalisme et de Communication, Marseille (Fr), Journalisme scientifique et public-expert contributeur. Une « nouvelle donne » dans les pratiques du journalisme spécialisé ?
- Aurélie Tavernier, CEMTI, Université Paris 8 (Fr), Demain, tous experts ? Dispositifs et figures des savoirs légitimes sur une scène d’information participative.
- Elsa Poupardin, LISEC, Université de Strasbourg (Fr), Vulgariser ses résultats et s’engager pour la Science ?
15h30 – 16h / Pause café
16h – 17h30 / Session 9. Disposer des publics ou engager les citoyens, quels possibles, quelles volontés ?
- Boris Urbas, Laboratoire CIMEOS, Université de Bourgogne (Fr), Toucher ou ne pas toucher ? L’oeuvre d’art dans une exposition scientifique: le public et la médiation autour de « Vous avez dit radioprotection? » .
- Marie Cambone, Laboratoire Culture et Communication, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse (Fr), L’évaluation de la participation de jeunes citoyens à une exposition sur les pratiques numériques.
- Daniel Schmitt, LISEC, Université de Strasbourg (Fr), Comment les enfants construisent leur expérience de visite dans un centre d’initiation aux sciences.
19h / Réception à l’Hôtel de Ville de Strasbourg
21h / Visite de Strasbourg en bateau-mouche
Samedi 15 octobre 2011 – Palais Universitaire
9h-10h30 / Débat. Les cultures des sciences en Europe: Impasses et perspectives
10h30 – 11h / Pause café
11h -12h30 / Table ronde ouverte au public. Politiques et recherches sur le nucléaire : Quels publics, quelles demandes, quelles participations ?
Lieu
- Strasbourg (67000) (Allée du Général Rouvillois (Maison des Sciences de l’Homme Alsace (MISHA – Tram C, arrêt « Observatoire ») et Palais Universitaire (Tram C, arrêt « Gallia » – Place de l’Université))
Contact
- Philippe Chavot
courriel : cultures [point] sciences (at) free [point] frLISEC – 7 rue de l’Université – 67000 Strasbourg - Anne Masseran
courriel : cultures [point] sciences (at) free [point] fr
Tags: Etudes des sciences
Parution – Le corps du chercheur. Une méthodologie immersive
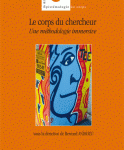 Bernard Andrieu (dir.), Le corps du chercheur. Une méthodologie immersive, Presses universitaires de Nancy, 2011.
Bernard Andrieu (dir.), Le corps du chercheur. Une méthodologie immersive, Presses universitaires de Nancy, 2011.
Ce livre établit que le corps du chercheur(euse) est à comprendre à la fois en 1er et en 3e personne sans pour autant prétendre réduire l’écart méthodologique entre les deux et plaide, en épistémologie du corps, pour une anthropologie engagée dans le monde des autres.
La stratégie immersive est ici décrite de manière théorique par le philosophe Bernard Andrieu et sur le terrain des pratiques corporelles par l’anthropologie sociale d’Eric Perera, Sylvain Rouanet et Éric de Léséleuc.
Les stratégies de visibilisation et de stigmatisation des acteurs et actrices, comme les décrivent par les sociologues Natacha Chetcuti et Maxime Cervulle démontrent comment les lesbiennes et les femmes sont également minorées du fait de leur appartenance ethnoraciale.
Le savant lui-même, dès l’interaction objet-sujet comme l’analyse l’historien des sciences Sébastien Poinat, écrit à travers sa corporéité. L’épistémologue des Staps Matthieu Quidu accomplit un pas supplémentaire en envisageant l’expérience corporelle vécue des scientifiques.
Première partie : stratégies d’immersion
Bernard ANDRIEU — Introduction
Bernard ANDRIEU — Mon corps, projecteur ou immerseur ?
Eric PERERA, Sylvain ROUANET, Eric DE LÉSÉLEUC — Comprendre par corps le phénomène étudié ? Stratégies d’immersion dans un groupe de body-builders
Deuxième partie : le corps du savant
Sébastien POINAT — Le corps du physicien et le savoir
Matthieu QUIDU — L’aventure du corps dans la philosophie des sciences au XXesiècle : trois thèses sur la valeur épistémologique de la corporéité du savant
Troisième partie : modes de subjectivation
Natacha CHETCUTI — La sexualité comme mode de subjectivation politisée du genre ?
Maxime CERVULLE — La couleur des épistémologies. Race, politique des savoirs et Critical White Studies
Tags: Anthropologie, Arts, Economie, Ethnologie, Etudes des sciences, Etudes Genre, Géographie, Histoire, Histoire de l'art, Littérature, Philosophie, Psychologie, Sociologie
Parution – Le Troisième sexe. Etre hermaphrodite aux XVIIe et XVIIIe siècles
Du XVIIe au XVIIIe siècle, période où la répression judiciaire côtoie l’aube de libérations sexuelles, l’hermaphrodite est perçu à l’image de sa dualité corporelle.
Pour les uns, il incarne la neutralité, la perfection, voire un idéal ; pour les autres, il figure l’altérité, la violation des bonnes moeurs, l’équivoque dans l’excès. Disséqué, au sens d’analyser minutieusement, du latin dissecare, couper en deux, cet être incertain engendre de nouveaux rapports aux fables du passé, d’insolites utopies inspirées d’Ovide ou de la Bible, ainsi que des textes scientifiques, souvent normalisateurs et moralisateurs, derrière lesquels sévit une législation coercitive, source d’éclatants procès. Entre savoirs et fantasmes, son » sexe paré d’ombre « , pour reprendre la formule d’Empédocle, offre ainsi le paradoxe d’affirmer et d’infirmer, de fissurer la raison de ces époques.
- AFFABULATIONS
- Salmacis et Hermaphrodite, ou la passion
- Adam sans Eve, ou l’autosuffisance
- Australiens et Mégamicres, ou la fantaisie
- MEDICALISATIONS
- La tranchante clarté
- L’irréductible ambiguïté
- Les oniriques possibilités
- INQUISITIONS
- L’histoire ancienne dévoilée
- Les procès Marcis, d’Apremont Rafanel et Malavre
- Anne-Jean-Baptiste Grandjean
Patrick Graille est enseignant aux universités de Vassar-Wesleyan (Paris) et historien des idées, ses recherches portent sur la marginalité et la monstruosité des corps, des esprits et des arts, de la Renaissance aux Lumières.
Tags: Anthropologie, Arts, Histoire, Histoire de l'art, Littérature
Au slogan des nanotechnologies : « manipuler les atomes », répond maintenant un projet encore plus ambitieux : « fabriquer du vivant ».
Après que la biologie moléculaire a permis de déchiffrer le code génétique et d’analyser les programmes génétiques, on envisage désormais de les réécrire pour obtenir des organismes « à façon ». Le projet fait rêver et stimule l’imagination des pionniers de la biologie de synthèse. Ils promettent de transformer le charbon en méthane grâce à des bactéries reprogrammées, de ressusciter les mammouths et pourquoi pas les humains… Après les industries mécaniques et les industries chimiques, verrons-nous un nouvel âge industriel, celui des machines biologiques ?
Ces promesses sont-elles crédibles ? Et si tel est le cas, que dire des dangers de ces nouvelles technologies et comment en maîtriser les risques ? Cette biologie est-elle bien conforme à nos valeurs culturelles et éthiques et est-ce celle que nous souhaitons pour notre société ?
Bernadette Bensaude-Vincent est professeure de philosophie des sciences et des techniques à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut universitaire de France et de l’Académie des technologies.
Dorothée Benoit-Browaeys est journaliste scientifique et déléguée générale de VivAgora, association pour l’engagement citoyen dans la gouvernance des technologies.
Tags: Anthropologie, Philosophie
Parution – Le corps du chercheur. Une méthodologie immersive
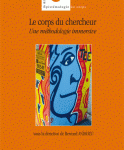 ANDRIEU Bernard (dir.), Le corps du chercheur. Une méthodologie immersive, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2001, 178 p.
ANDRIEU Bernard (dir.), Le corps du chercheur. Une méthodologie immersive, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2001, 178 p.
Ce livre établit que le corps du chercheur(euse) est à comprendre à la fois en 1er et en 3e personne sans pour autant prétendre réduire l’écart méthodologique entre les deux et plaide, en épistémologie du corps, pour une anthropologie engagée dans le monde des autres. La stratégie immersive est ici décrite de manière théorique par le philosophe Bernard Andrieu et sur le terrain des pratiques corporelles par l’anthropologie sociale d’Eric Perera, Sylvain Rouanet et Éric de Léséleuc. Les stratégies de visibilisation et de stigmatisation des acteurs et actrices, comme les décrivent par les sociologues Natacha Chetcuti et Maxime Cervulle démontrent comment les lesbiennes et les femmes sont également minorées du fait de leur appartenance ethnoraciale. Le savant lui-même, dès l’interaction objet-sujet comme l’analyse l’historien des sciences Sébastien Poinat, écrit à travers sa corporéité. L’épistémologue des Staps Matthieu Quidu accomplit un pas supplémentaire en envisageant l’expérience corporelle vécue des scientifiques.
Première partie : stratégies d’immersion
Bernard ANDRIEU — Introduction
Bernard ANDRIEU — Mon corps, projecteur ou immerseur ?
Eric PERERA, Sylvain ROUANET, Eric DE LÉSÉLEUC — Comprendre par corps le phénomène étudié ? Stratégies d’immersion dans un groupe de body-builders
Deuxième partie : le corps du savant
Sébastien POINAT — Le corps du physicien et le savoir
Matthieu QUIDU — L’aventure du corps dans la philosophie des sciences au XXe siècle : trois thèses sur la valeur épistémologique de la corporéité du savant
Troisième partie : modes de subjectivation
Natacha CHETCUTI — La sexualité comme mode de subjectivation politisée du genre ?
Maxime CERVULLE — La couleur des épistémologies. Race, politique des savoirs et Critical White Studies
Tags: Anthropologie, Ethnologie, Histoire, Philosophie