Comment le photojournalisme devient-il de l’activisme artistique ? A travers la défense des groupes minoritaires, le photojournalisme rend visible et permet l’empowerment de ceux que l’on passe sous silence.
Chicas Poderosas, représentation et égalité
Créé en 2013 par la portugaise Mariana Santos, le collectif Chicas Poderosas s’est construit afin de lutter pour une meilleure représentation des femmes et des personnes LGBT dans le domaine journalistique. La sur-représentation des auteurs masculins dans les médias amène un agenda éditorial très limité, qui exclut la voix des femmes et en général les voix dissidentes dans le débat politique. Les postes de leader leurs sont très souvent réservés, ce qui entraîne une forme de répétition des inégalités vis-à-vis du genre. Le collectif Chicas Poderosas lutte ainsi pour réduire l’écart lié au genre dans les organes de décision des médias et plus généralement du domaine journalistique. Il promeut de ce fait le leadership féminin et l’égalité des genres. Présent dans 16 pays d’Amérique latine, Chicas Poderosas estime représenter plus de 10 000 femmes dans ce processus de revendication égalitaire.
Pour ce faire, le collectif met en place des actions concrètes permettant l’expression et la production journalistique des femmes désireuses d’êtres entendus. Cela passe par des ateliers de partage, des enquêtes transfrontalières mais aussi des cours en ligne visant le partage de connaissances. Ce réseau d’échange permet ainsi l’empowerment professionnel via la création et l’acquisition de compétences journalistiques.
Territorios y Resistencias, une enquête à la rencontre des voix oubliées en Argentine
Menée dans les 5 grandes régions de l’Argentine (la Patagonie, la région Cuyo, la région centre, le nord-est et le nord-ouest), cette enquête fédérale s’attache à montrer l’impact du changement climatique sur la vie des femmes, les personnes LGBT et les communautés indigènes. Développée via le site Chicas Poderosas Argentina, cette enquête regroupe un bon nombre de femmes journalistes et photographes mobilisées pour aller à la rencontre des populations invisibilisées. Se battre contre l’indifférence que rencontrent ces personnes c’est se battre contre cet hégémonisme argentin qui considère l’homme blanc descendant d’européen comme étant le symbole inébranlable de la nation. Le but de cette enquête est aussi de décentrer l’attention qui est portée de façon constante vers la capitale argentine, Buenos Aires, au détriment des territoires de l’intérieur et du sud du pays.
La lutte des peuples indigènes pour la conservation de leurs terres
L’un de ces témoignages concerne la région de Santiago del Estero, qui se situe dans le nord-ouest du pays, à mi chemin entre la ville de Salta et de Cordoba. Originellement peuplé par des indigènes, cette région rurale de l’Argentine connaît des conditions climatiques assez rudes en été, avec des températures avoisinant quotidiennement les 40 degrés. La journaliste Marcela Alejandra Arce et la photographe Florencia Navarro sont allées à la rencontre d’Angélica Serrano, une femme indigène appartenant au peuple tonokoté Yaku Muchuna et habitante de la région de Santiago del Estero.

A travers une narration puissante et évocatrice, et une série de photographies, l’enquête nous emmène à découvrir le quotidien d’Angélica Serrano et sa lutte contre la déforestation et le mépris des grands investisseurs agricoles. En effet, cette région concentre de grandes plantations de soja, et est victime de déforestation dans le but d’accroître de façon expansive les plantations. Le combat de cette femme réside dans la reconnaissance des droits des populations indigènes et notamment vis-à-vis du droit à la terre. En rasant les forêts primaires qui se trouvent sur des territoires indigènes, les entreprises agricoles détruisent le patrimoine de ces peuples et renforcent ce rapport de force qui a longtemps été en place en Argentine. Historiquement, le pays a mené à la fin de XIXème siècle une politique de blanchiment et de « dé-indianisation » de la population dans le but de créer une nation blanche, à l’effigie de la population européenne. Si ces politiques sont bien révolues, elles ont laissé des traces et notamment vis-à-vis des rapports de domination dont les indigènes sont toujours victimes. En témoignant sur cette situation, Angélica Serrano souhaite changer cette image de victimisation qui est apposée aux peuples indigènes argentins et ainsi récupérer le contrôle sur celle-ci. Cette lutte s’affiche comme ayant un double objectif, une restitution et un respect des droits pour des populations longtemps subordonnées mais aussi un combat pour une meilleure considération à l’égard des peuples indigènes. La citation de cette femme à la fin de l’article résume parfaitement son combat :
“Queremos tener un lugar en esta sociedad y que se nos tome en cuenta. Que sepan que existimos, que tenemos una cultura y derechos también. Que no tenemos que andar con plumas o con las vestimentas que nuestros antepasados solían usar para ser identificados. Somos los indios de hoy. Somos aborígenes de hoy”.
Porter les voix à travers l’art
Grâce à ces rencontres et à ces investigations sur tout le territoire argentin, le média Chicas Poderosas met en lumière la diversité des acteurs activistes mais également des femmes productrices de contenus journalistiques. Les séries de photographies réalisées par les différentes photographes ont ainsi fait l’objet d’exposition dans les différentes régions d’Argentine, accompagnées d’extraits et de note rédigées par les journalistes liées aux enquêtes. A travers ces expositions nationales, le média en ligne Chicas Poderosas ainsi que les pages Instagram des journalistes et photographes exposent les productions artistiques qui donnent la voix à une partie de la population qui n’est souvent pas ou peu considérée. Cette mise en lumière permet l’expression de combats et de sujets de sociétés, sous un prisme bienveillant de visibilisation et non de victimisation comme beaucoup de médias hégémoniques peuvent parfois le faire.
Bibliographie :
Sabine Kradolfer, «Les autochtones invisibles ou comment l’Argentine s’est « blanchie »», Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 16 | 2008
Un article explicatif du projet Territorios y resistencias : https://www.chicaspoderosas.org/programas/chicas-poderosas-argentina-publica-la-investigacion-federal-territorios-y-resistencias/
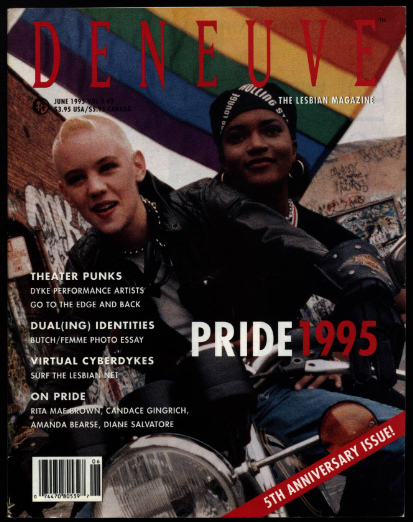

Derniers commentaires