subRosa est un collectif de chercheuses et chercheurs qui travaillent sur l’art, l’activisme et le politique. Il est fondé en 1998, à Pittsburg, au début de la deuxième vague féministe, par les artistes cyberféministes : Faith Wilding, Mariá Fernandez, Hyla Willis et Michelle M.Wright. Dans leur manifeste, Rosa fait référence aux femmes féministes qui ont lutté dans différents domaines tels que les sciences (Rosalind Franklin), la politique (Rosa Luxemburg), l’activisme (Rosa Parks) et l’art (Rosa Bonheur). Ce collectif produit des performances artistiques, des manifestations, des publications autour des questionnements que soulèvent les nouvelles technologies sur le corps des femmes. De ce fait, il regroupe les domaines des pionnières dont le groupe s’inspire. Il s’agit d’une critique de la rencontre entre les biotechnologies et le corps des femmes et de l’impact que cela a sur leur corps, leur travail et leur vie.
Continue readingÉtiquette : Femmes
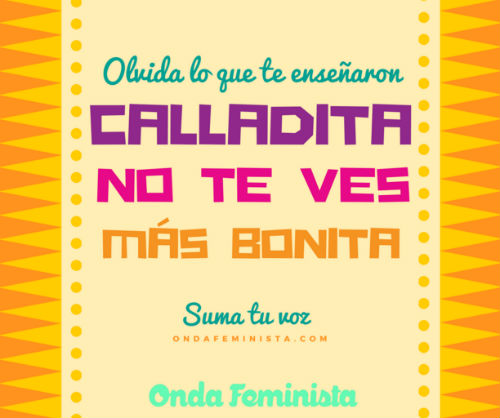
Des mots teints en rose : la lutte féministe au pays où la polarisation économique, politique et sociale règne.
Dans un pays où la crise économique, la polarisation politique et les tabous sociaux règnent, la lutte féministe semble être en arrière-plan des priorités des Vénézuéliens. La Constitution de 1999 se démarquait en tant que cadre juridique ayant pour but de visibiliser, protéger et honorer les femmes et leur participation politique. Cependant, 20 ans plus tard, le Venezuela reste un pays où les problématiques dont l’accès restreint aux contraceptifs, l’IVG clandestine, la violence conjugale et le machisme sont à l’ordre du jour, quoique la législation dicte. Certes, diverses initiatives ont été créés et suivies par le gouvernement dans le cadre de l’idéologie de Hugo Chávez, « le président féministe » pendant que d’autres ont surgit à l’écart du régime, indépendantes de la scène politique. Mais, aujourd’hui…
La réalité du pays et de ses femmes sont-elles reflétées dans la production médiatique vénézuélienne disponible en ligne ?
Le spectre politique se répand-il dans le champ médiatique ?
Les cybermédia ayant une perspective de genre sont-ils soumis à la censure gouvernementale ?
Le travail du collectif « És uma maluca » a été reproduit dans la rue à Rio, après être interdit par le gouvernement

Performance faite en janvier dans une rue du centre de Rio (Julio Cesar Guimarães/UOL)
Pendant deux mois, une recette indigeste de gâteau a résonné parmi les quatre murs de l’un des centres culturels les plus importants de Rio de Janeiro. Loin de stimuler les visiteurs de la Casa França Brasil dans les aventures gastronomiques, l’audio qui a été reproduit en boucle et qui énumérait les étapes nécessaires à la préparation du gâteau visait à accentuer une manifestation très familière au Brésil.
Nous nous permettons d’ouvrir une rapide parenthèse pour expliquer la raison de la recette présentée dans le musée : pendant la dictature militaire (1964-1985), chaque fois qu’un article était censuré par l’État, les journaux publiaient une recette culinaire. L’idée était de manifester contre l’interdiction.
Au fil des années, ce qui était une routine est devenue une anecdote du journalisme, et les brésiliens nés après les années 1980 se sont habitués à penser qu’ils jouissaient de toute la liberté d’expression du monde, en particulier à l’époque d’Internet. Continue reading
« Somos mujeres comunes con responsabilidades excepcionales »
« Nous sommes des femmes normales avec des responsabilités exceptionnelles »
En juin 2011 à Las Heras, le projet Cieneguita Cartonera voit le jour à l’initiative d’un groupe de femmes (Gabi, Rosi, Patricia, Raquel, Stella, Silvia, Nancy, Raquel, María, Fabiana, Lucy, Andrea et Adriana) inspiré par le mouvement cartonero déjà largement présent dans le paysage latino-américain. Cette maison d’édition alternative autogérée se donne pour but de proposer de nouvelles formes de communication au travers de la publication de livres artisanaux au contenu engagé socialement. Le local de la maison d’édition se transforme donc en centre culturel qui voit fleurir de nombreux projets sociaux, culturels et politiques au travers d’une expérience collaborative.
Dans les pas de ces femmes…
Une centaine de paires de chaussures rouges qui envahissent l’espace public, voici l’exposition d’art public proposée par Elina Chauvet depuis une dizaine d’années pour sensibiliser à la violence de genre et au féminicide.
L’art – illerie d’Elina Chauvet
Originaire de Ciudad Juarez (Mexique), alors étudiante en architecture, sa sœur décède sous les coups de son mari. Il ne sera jamais inculpé. Inconsolable, elle se réfugie dans l’art, essayant de trouver un moyen d’exprimer sa souffrance. Elle engage son art pour défendre la Femme et toucher l’opinion publique.
« Zapatos Rojos parte del amor y se despliega en la colectividad social…»
Elina Chauvet
Zapatos Rojos, part de l’amour et se déploie au sein de la collectivité sociale
D’inspiration surréaliste, l’exposition Zapatos Rojos née en 2009, dans sa ville natale de Ciudad Juarez. Dans une structure sociale machiste où la discrimination à l’égard des femmes est quotidienne, on assiste à une banalisation et à une normalisation de la violence de genre. À tel point que personne ne prête plus attention à l’amoncellement d’avis de disparition placardés dans les rues.
L’œuvre s’impose dans le quotidien, sur une place ou dans un parc. Par choix ou lors de déplacements, on se retrouve confronté à la réalité : on est impacté visuellement, heurté mentalement.
Le travail d’Elina Chauvet a la particularité d’aller à la rencontre des gens, sans distinction de sexe, âge, niveau de vie, nationalité… Sans un mot, chacun peut être touché.




Derniers commentaires